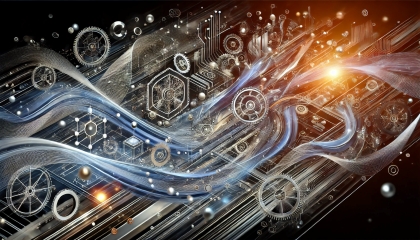Le devoir de conseil en assurance repose sur une démarche méthodologique rigoureuse, structurée de manière à garantir la parfaite adéquation entre les besoins identifiés du souscripteur et la solution assurantielle proposée. Bien plus qu’une simple obligation d’information, ce devoir constitue une véritable prestation intellectuelle individualisée.
Cette obligation, désormais explicitement énoncée à l’article L. 521-4 du Code des assurances, implique une approche méthodique que l’on peut décomposer en trois étapes fondamentales. Ainsi, le processus d’élaboration du conseil se déploie selon une logique séquentielle : le recueil préalable des besoins et exigences constitue le socle diagnostic, l’analyse de la situation du souscripteur permet l’évaluation des paramètres pertinents, tandis que la formulation du conseil matérialise la synthèse de cette démarche par une recommandation motivée. Cette progression méthodologique vise à transformer l’asymétrie informationnelle naturelle entre professionnel et consommateur en un dialogue structuré au service d’une décision éclairée.
1. Le recueil préalable des besoins et exigences
==>L’obligation légale de diagnostic
Le Code des assurances consacre, par son article L. 521-4, I, une obligation de diagnostic préalable à toute recommandation. Cette disposition contraint le distributeur à « préciser par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci ». Cette exigence légale révèle une démarche structurée en deux temps distincts : d’abord une collecte minutieuse des informations pertinentes, suivie de leur formalisation écrite.
Cette première phase dépasse très largement le cadre d’une simple formalité administrative. Il s’agit véritablement d’une analyse approfondie des besoins du client, comparable à celle que l’on retrouve dans d’autres domaines spécialisés du conseil professionnel, comme l’audit patrimonial en gestion de fortune ou encore l’analyse fonctionnelle pratiquée en ingénierie. Cette analogie n’est pas anodine : dans tous ces secteurs, la qualité finale du conseil délivré dépend étroitement de la précision du diagnostic réalisé en amont.
La doctrine contemporaine souligne que cette démarche diagnostique transforme fondamentalement la nature de l’acte de distribution. Celui-ci ne se limite plus à la simple présentation d’un produit standardisé, mais s’élève au rang d’une prestation intellectuelle personnalisée[14]. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement général de tertiarisation de l’économie, où la valeur ajoutée réside moins dans le produit lui-même que dans l’accompagnement qui l’entoure.
L’exigence d’un support écrit répond à plusieurs impératifs. D’un point de vue probatoire, elle permet d’établir la réalité et la consistance de la démarche diagnostique. La jurisprudence civile a en effet consacré le principe selon lequel c’est à celui qui est légalement tenu de fournir un conseil de prouver l’exécution de cette obligation (Cass. 2e civ., 17 nov. 2016, n° 15-14.820). Cette règle, initialement dégagée en matière bancaire, trouve une application particulièrement pertinente en assurance, secteur où les contentieux post-contractuels demeurent fréquents.
D’un point de vue pédagogique, l’écrit favorise la compréhension mutuelle entre distributeur et souscripteur. Il permet au professionnel de vérifier que son analyse correspond bien à la réalité vécue par le client, tandis qu’il offre à ce dernier une vision structurée de ses propres besoins, parfois initialement mal formalisés.
==>La délimitation des besoins exprimés
La phase de délimitation des besoins constitue le cœur de l’analyse préalable. Elle impose au distributeur une démarche active de questionnement et de reformulation, dépassant la simple réception passive des demandes du client.
Cette obligation de reformulation technique revêt une dimension particulièrement importante en assurance, secteur caractérisé par une forte asymétrie de connaissances entre professionnels et consommateurs. Le langage assurantiel, riche en concepts techniques et en références juridiques spécialisées, demeure largement inaccessible au public non initié. La mission du distributeur consiste dès lors à opérer une traduction entre l’expression spontanée des préoccupations du client et la terminologie précise des contrats d’assurance.
Cette fonction de traduction s’apparente à celle exercée par d’autres professions du conseil, notamment les architectes dans le domaine de la construction ou les notaires en matière successorale. Dans tous ces secteurs, le professionnel doit comprendre les attentes exprimées dans un langage profane pour les transposer dans un cadre technique et juridique approprié.
Le document de synthèse résultant de cette analyse acquiert une valeur contractuelle particulière. Bien que sa forme demeure libre, son contenu délimitera le périmètre dans lequel le conseil est attendu. Cette délimitation contractuelle du périmètre d’intervention protège tant le distributeur contre d’éventuelles réclamations ultérieures portant sur des aspects non couverts par sa mission, que le souscripteur contre des recommandations inadaptées à ses besoins réels.
L’ACPR a d’ailleurs souligné, dans ses recommandations sectorielles, l’importance de cette phase de cadrage préalable, qu’elle considère comme « déterminante pour la qualité de la relation commerciale ultérieure »[15]. Cette position de l’autorité de supervision confirme que l’obligation d’analyse ne relève pas de la seule technique juridique, mais s’inscrit dans une démarche plus large d’amélioration de la qualité de service dans le secteur assurantiel.
==>Les limites du devoir d’enquête
Le législateur a pris soin de délimiter précisément l’étendue des obligations pesant sur le distributeur lors de la phase de recueil d’informations. L’article L. 521-4, III du Code des assurances précise explicitement que les données relatives aux exigences et besoins du souscripteur « reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel ». Cette formulation n’est pas anodine : elle établit un équilibre entre l’exigence de conseil personnalisé et la praticabilité économique de la distribution d’assurance.
Cette limitation trouve sa justification dans la nature même de l’activité de distribution. Le distributeur n’est pas investi d’une mission d’audit ou d’investigation approfondie de la situation de son client. Son expertise porte sur la technique assurantielle et non sur l’évaluation patrimoniale ou l’analyse comptable. Comme l’a souligné la doctrine spécialisée, le professionnel de l’assurance demeure tenu de « poser les bonnes questions » mais ne saurait être contraint à « des investigations approfondies sur des données que le client ne souhaite pas révéler »[16].
La jurisprudence administrative elle-même a reconnu cette limitation en matière de marchés publics d’assurance, considérant que l’assistant à maîtrise d’ouvrage en assurance n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des informations transmises par la collectivité publique, dès lors que ces informations paraissaient cohérentes et vraisemblables (CE, 10 févr. 2014).
Cette approche pragmatique se justifie également par des considérations d’efficacité économique. Imposer au distributeur des obligations d’investigation trop étendues conduirait inévitablement à un renchérissement du coût de la distribution, répercuté in fine sur les primes d’assurance. Le législateur a ainsi privilégié un modèle fondé sur la coopération loyale entre les parties plutôt que sur la méfiance systématique.
Néanmoins, cette limitation ne saurait être comprise comme une exonération totale de vigilance. La jurisprudence civile a progressivement affiné les contours de cette obligation, distinguant entre l’investigation active – non exigée – et la vigilance passive – requise. Ainsi, le distributeur demeure tenu de relever les incohérences manifestes dans les déclarations de son client et de solliciter les clarifications nécessaires (Cass. 1ère civ. 7 mars 1989).
Cette obligation de vigilance trouve particulièrement à s’appliquer lorsque les déclarations du souscripteur paraissent manifestement incompatibles avec sa situation apparente ou avec les exigences du marché assurantiel. Dans de telles hypothèses, l’abstention du distributeur pourrait être qualifiée de négligence professionnelle.
L’équilibre ainsi établi respecte la logique contractuelle du droit français, fondée sur la bonne foi des parties. Il reconnaît que le souscripteur demeure le mieux placé pour connaître sa propre situation, tout en maintenant une exigence de professionnalisme du distributeur dans l’exploitation des informations qui lui sont communiquées.
Cette délimitation des responsabilités s’inscrit enfin dans une conception moderne de la relation de conseil, qui privilégie l’accompagnement personnalisé à partir d’informations fiables plutôt que l’investigation systématique potentiellement intrusive et économiquement inefficiente.
2. L’analyse de la situation du souscripteur
==>L’appréciation des compétences du souscripteur
La personnalisation du conseil impose une évaluation fine du profil du souscripteur, particulièrement de ses compétences en matière assurantielle. Cette approche différenciée s’inscrit dans une conception moderne de la protection contractuelle, qui privilégie l’adaptation aux situations concrètes plutôt que l’application uniforme de règles abstraites.
La jurisprudence a progressivement affiné cette grille d’analyse, distinguant plusieurs catégories de souscripteurs selon leur degré d’expertise. Les professionnels exerçant une activité en lien avec l’assurance bénéficient ainsi d’une présomption de compétence qui allège corrélativement les obligations du distributeur. Cette approche trouve son fondement dans la théorie générale des obligations, où l’intensité du devoir de conseil varie selon la qualité des parties au contrat[17].
À l’inverse, les consommateurs et les professionnels non spécialistes bénéficient d’une protection renforcée. La Cour de cassation a ainsi considéré qu’un entrepreneur du bâtiment, bien que professionnel dans son domaine, demeurait un profane en matière d’assurance et pouvait légitimement attendre de son distributeur une information complète sur les garanties essentielles (Cass. 2e civ. 29 mars 2018, n°17-14.975).
Cette modulation s’étend également aux personnes morales, dont la taille et l’organisation influent sur le niveau d’expertise présumé. Le régime des “grands risques”, défini à l’article L. 111-6 du Code des assurances, témoigne de cette différenciation : les entreprises dépassant certains seuils sont présumées disposer de l’expertise nécessaire pour évaluer leurs besoins d’assurance sans assistance particulière?.
L’appréciation concrète de ces compétences nécessite une analyse au cas par cas, tenant compte non seulement du statut du souscripteur, mais également de son expérience personnelle en matière d’assurance, de la complexité de son exposition aux risques, et des moyens dont il dispose pour s’informer.
==>L’évaluation de la complexité du contrat
Le législateur a expressément lié l’intensité du conseil à la complexité du produit proposé. L’article L. 521-4, III du Code des assurances dispose que les précisions fournies au souscripteur sont « adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé ». Cette exigence de proportionnalité évite un formalisme excessif de la distribution tout en maintenant un niveau de protection approprié.
Cette approche graduée trouve son inspiration dans la réglementation des services financiers, où la directive MiFID avait déjà consacré le principe d’une information proportionnée à la complexité des instruments proposés[18]. L’assurance, par sa technicité croissante et la diversification de ses produits, nécessitait une approche similaire.
L’ACPR a formalisé cette gradation en distinguant trois niveaux d’intervention : le conseil de base obligatoire, centré sur la cohérence entre besoins et produit proposé ; le service de recommandation personnalisée, impliquant une analyse comparative ; et enfin le conseil fondé sur une analyse de marché, supposant une expertise élargie?.
Cette classification en trois niveaux s’inspire directement des standards internationaux utilisés dans le secteur financier, où la distinction traditionnelle s’établit entre l’exécution simple d’ordres (« execution only »), le conseil en investissement (« investment advice ») et la gestion discrétionnaire (« portfolio management »)[19]. Son intégration dans le domaine assurantiel illustre la convergence croissante des cadres réglementaires applicables aux secteurs bancaire et assurantiel, témoignant ainsi d’une logique commune de structuration des offres de conseil financier.
La complexité du produit d’assurance se mesure à l’aune de plusieurs critères précis : le nombre et la diversité des garanties proposées, la présence éventuelle de mécanismes sophistiqués tels que la participation aux bénéfices, l’adossement à des supports financiers présentant une forte volatilité, ainsi que l’existence de clauses d’exclusion particulièrement techniques. L’appréciation rigoureuse de ces éléments exige une expertise à la fois actuarielle et juridique, compétence spécifique qui relève nécessairement des distributeurs professionnels.
==>La prise en compte des informations disponibles
Le périmètre du conseil est naturellement limité par l’étendue des informations effectivement disponibles. Cette limitation protège le distributeur contre des obligations d’investigation disproportionnées tout en maintenant une exigence de diligence raisonnable.
La jurisprudence a établi que l’information ne pouvant porter que sur des faits connus de l’intermédiaire, il incombe au preneur de prouver que celui-ci en avait connaissance (Cass. 1re civ., 18 mars 2003). Cette règle de preuve protège le distributeur contre des allégations invérifiables tout en incitant le souscripteur à une communication transparente.
Cette approche s’inspire de la théorie générale de l’information, développée notamment en droit des sociétés, où l’obligation d’information du dirigeant est limitée aux faits dont il a effectivement connaissance[20]. Elle trouve également écho en droit de la consommation, où l’obligation d’information du professionnel porte sur les caractéristiques essentielles du produit qu’il maîtrise naturellement[21].
Cependant, cette limitation ne dispense pas le distributeur d’une vigilance active face aux informations manifestement incohérentes ou incomplètes. La jurisprudence sanctionne ainsi le professionnel qui, face à des déclarations suspectes, s’abstiendrait de solliciter les clarifications nécessaires (Cass. 1ère civ. 7 mars 1989).
L’équilibre ainsi établi respecte la logique économique de la distribution d’assurance : le distributeur mobilise son expertise technique pour optimiser l’information fournie par le client, sans pour autant se substituer à celui-ci dans l’appréciation de sa propre situation. Cette répartition des rôles préserve l’efficacité du processus commercial tout en maintenant un niveau d’exigence professionnel approprié.
3. La formulation du conseil : simple proposition ou recommandation motivée
==>Le conseil obligatoire : la proposition cohérente
Le premier niveau de conseil, désormais imposé à tout distributeur par l’article L. 521-4, I du Code des assurances, établit un socle minimal d’exigences professionnelles. Cette obligation fondamentale contraint le distributeur à proposer « un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel » tout en précisant « les raisons qui motivent ce conseil ».
Cette exigence de cohérence constitue une véritable révolution conceptuelle dans l’approche de la distribution d’assurance. Elle substitue à la logique commerciale traditionnelle – centrée sur l’écoulement de produits – une logique de service personnalisé fondée sur l’adéquation entre l’offre et la demande[22]. Cette évolution s’inscrit dans le mouvement général de protection du consommateur qui caractérise le droit européen contemporain[23].
L’obligation d’information objective qui accompagne ce conseil revêt une importance particulière. L’article L. 521-4, I impose que le distributeur fournisse « des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse ». Cette formulation reprend la terminologie de la directive sur la distribution d’assurances, elle-même inspirée de la réglementation des services financiers[24].
Le caractère obligatoire de cette démarche marque une rupture avec l’ancien droit, où seule la jurisprudence imposait un devoir de conseil aux intermédiaires d’assurance[25]. La codification de cette obligation garantit une application uniforme sur l’ensemble du territoire et simplifie le contentieux en offrant un référentiel normatif précis.
La motivation du conseil constitue un élément central de cette obligation. Elle permet au souscripteur de comprendre les raisons qui sous-tendent la recommandation, favorisant ainsi une décision éclairée. Cette exigence s’inspire des standards développés en matière de conseil en investissement, où la justification des recommandations constitue depuis longtemps une obligation déontologique fondamentale[26].
==>Le service de recommandation personnalisée facultatif
Au-delà du conseil de base obligatoire, l’article L. 521-4, II du Code des assurances consacre un niveau supérieur d’intervention : le service de recommandation personnalisée. Cette prestation facultative « consiste à expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d’un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins».
Cette disposition s’inspire directement de l’approche développée par la directive MiFID II en matière de conseil en investissement[27]. L’analogie n’est pas fortuite : elle témoigne de la volonté du législateur européen d’harmoniser les standards de protection des consommateurs entre les différents secteurs financiers.
Le service de recommandation personnalisée suppose une analyse comparative préalable, impliquant l’examen de plusieurs solutions concurrentes. Cette exigence distingue fondamentalement ce service du conseil de base, qui peut se satisfaire de la présentation d’une solution unique dès lors qu’elle est cohérente avec les besoins identifiés.
Cette prestation s’inscrit dans une logique de différenciation concurrentielle, permettant aux distributeurs de valoriser leur expertise par une offre de service premium. L’ACPR a d’ailleurs souligné que ce service, dépassant les obligations légales minimales, pouvait justifier une rémunération spécifique[28].
La recommandation personnalisée implique également une responsabilité accrue du distributeur. Contrairement au conseil de base, qui se contente de vérifier la cohérence d’une solution, la recommandation engage le distributeur sur le caractère optimal de son choix parmi plusieurs alternatives. Cette différence d’engagement explique le caractère facultatif de cette prestation.
L’évolution vers ces services différenciés reflète la maturation du marché français de l’assurance, où la concurrence ne porte plus seulement sur les prix mais également sur la qualité du service. Cette tendance, observée dans d’autres secteurs de services financiers, transforme progressivement les distributeurs en véritables conseillers spécialisés[29].
- D. Langé, « Le devoir de conseil de l’intermédiaire en assurance après la loi du 15 décembre 2005 », Mélanges Bigot, p. 259 ?
- J. Bigot, « L’obligation de conseil des intermédiaires », RGDA 2018, p. 445 ?
- L. Mayaux, « Les assurances de personnes », Traité, t. IV, n° 435 ?
- H. Groutel, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, 2008, n° 298 ?
- P.-G. Marly, « Le mythe du devoir de conseil (à propos du conseil en investissement assurantiel) », Mél. Daigre, Lextenso, 2017, p. 561 ?
- A. Pélissier, « Devoir de conseil de l’assureur et de la banque », RGDA 2019, n° 1169, p. 7 ?
- I. Monin-Lafin, « Le nouveau régime du conseil en assurance », Trib. ass. 2018, p. 45 ?
- J. Kullmann, « L’interprétation systémique en droit des assurances », RGDA 2019, p. 234 ?
- J. Bigot, « Les niveaux de conseil : clarification ou complexification ? », RGDA 2018, p. 445 ?
- L. Mayaux, « Les assurances de personnes », Traité, t. IV, n° 435 ?
- H. Groutel, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, 2008, n° 298 ?
- D. Langé, « La gradation des obligations de conseil », RGDA 2019, p. 156 ?
- P. Mayaux, « L’économie du conseil en assurance », Rev. dr. bancaire et fin. 2019, p. 23 ?
- H. Groutel, “Le devoir de conseil en assurance”, Risques 1990, n° 2, p. 89 ?
- ACPR, Principes du conseil en assurance, juillet 2018 ?
- D. Lange, “Le devoir de conseil de l’intermédiaire en assurance après la loi du 15 décembre 2005”, Mélanges Bigot, p. 259. ?
- Y. Lequette, “L’obligation de renseignement et le droit commun du contrat”, in L’information en droit privé, LGDJ, 1978, p. 305 ?
- Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. ?
- Voir notamment A. Couret, H. Le Nabasque, “Valeurs mobilières”, Dalloz Action, 2020, n° 12.45 ?
- M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, “Droit des sociétés”, Litec, 31e éd., 2018, n° 452 ?
- Art. L. 111-1 du Code de la consommation ?
- H. Groutel, “L’évolution du devoir de conseil en assurance”, RCA 2019, étude 4 ?
- N. Reich, “Protection of Consumers’ Economic Interests by the EC”, Sydney Law Review, 1992, vol. 14, p. 23 ?
- Directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, considérant 31 ?
- Cass. 1re civ., 10 nov. 1964, RGAT 1965, p. 175, note A. Besson ?
- J. Lasserre Capdeville, “Le conseil en investissement”, Rev. dr. bancaire et fin. 2018, dossier 15 ?
- Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers ?
- ACPR, Principes du conseil en assurance, juillet 2018, p. 12 ?
- Ph. Storck, “La transformation de l’intermédiation financière”, Rev. économie financière 2017, n° 127, p. 45 ?
- H. Groutel, Traité du contrat d’assurance terrestre, Litec, 2008 ?
- Malaurie Ph., Aynès L., Stoffel-Munck Ph., Droit des obligations, LGDJ ?
- J. Bigot, « Missions non traditionnelles : la responsabilité professionnelle du producteur d’assurances », L’Assureur Conseil, oct. 1987, p. 3 ?
- Cass. 1?? civ., 6 nov. 1984, RGAT 1985, p. 313 ?
- H. Groutel, « Le devoir de conseil en assurance », Risques 1990, n° 2, p. 89. ?
- Cass. 1?? civ., 10 nov. 1964, JCP G 1965, II, 13981, note PP ?
- P.-G. Marly, « Le mythe du devoir de conseil », Mél. Daigre, Lextenso, 2017, p. 561 ?
- J.-C. Heydel, « L’agent général d’assurance », LGDJ, 2019, n° 156 ?
- Cass. 1?? civ., 28 oct. 1986, RGAT 1986, p. 610 ?
- L. Mayaux, Les assurances de personnes, Traité, t. IV, n° 835 ?
- D. Lange, « Les limites du devoir de conseil », RGDA 2019, p. 456 ?
- J. Kullmann, Le contrat d’assurance, Traité, t. 3, n° 1262 ?
- L. Mayaux, « Les grands risques et la protection du consommateur », RGDA 2018, p. 234 ?
- H. Groutel, « L’exclusion des grands risques », RCA 2019, comm. 156 ?
- J. Bigot, D. Langé, J. Moreau et J.-L. Respaud, La distribution d’assurance, éd. LGDJ, 2020, n°1257. ?
- P. Maystadt, « Les assurances affinitaires », Argus, 2020, p. 45 ?
- J. Bigot, « Les courtiers grossistes », in Traité de droit des assurances, t. 6, n° 234 ?
- Cass. com., 18 avr. 2019, n° 18-11108 ?
- CA Lyon, 18 févr. 2003, RGDA 2003, p. 371, obs. J. Kullmann ?
-
Cass. 1re civ., 31 mars 1981, Bull. civ. I, n° 108 ; D. 1982, IR, p. 97, note Berr et Groutel. ?