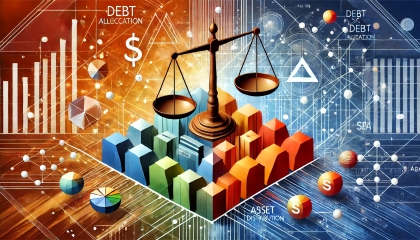Le rapport des dettes constitue un dispositif incontournable dans le cadre des opérations de partage, assurant une répartition équitable des charges entre les copartageants et préservant l’équilibre patrimonial de l’indivision. Consacré par le Code civil, ce dispositif impose à l’indivisaire débiteur d’une créance au profit de l’indivision d’en supporter la charge au moment du partage, par le biais d’une imputation sur ses droits dans la masse partageable. Il prévient ainsi toute dissymétrie entre les copartageants et garantit l’intégrité du patrimoine à répartir.
Toutefois, la mise en œuvre du rapport des dettes obéit à des règles qui distinguent la période antérieure au partage de celle où l’indivision prend fin. Tant que l’indivision perdure, le copartageant débiteur demeure libre de différer l’extinction de son obligation, le rapport des dettes ne revêtant alors qu’un caractère facultatif. En revanche, dès que le partage devient effectif, cette faculté se transforme en une obligation impérative, s’imposant de plein droit et se réalisant selon des modalités précises définies tant par la loi que par la jurisprudence.
La question du moment d’exécution du rapport des dettes revêt ainsi une importance décisive, tant pour la gestion patrimoniale des indivisaires que pour la liquidation de l’indivision. Il importe dès lors d’en préciser les règles, en distinguant les options ouvertes au copartageant débiteur avant le partage et les obligations qui lui incombent une fois la liquidation engagée.
A) Le moment d’exécution du rapport des dettes
Le rapport des dettes, qui constitue un mécanisme essentiel à l’équilibre des opérations de partage, se distingue par une exécution qui varie selon le moment où intervient son règlement. Tant que l’indivision subsiste, le rapport demeure une simple faculté, laissée à la discrétion du copartageant débiteur. Mais dès lors que le partage devient effectif, il se transforme en une obligation impérative, s’imposant à lui de plein droit.
1. Avant le partage : un règlement facultatif
Durant l’indivision, le copartageant débiteur n’est nullement contraint de procéder immédiatement au rapport de sa dette. Il jouit de la faculté d’en différer l’exécution, repoussant ainsi son règlement au moment du partage. Cette prérogative, désormais érigée en principe par l’article 865, alinéa 1??, du Code civil, trouve son fondement dans une jurisprudence bien établie, qui avait déjà consacré l’impossibilité, pour les créanciers de l’indivision, d’exiger un paiement anticipé des dettes rapportables (Cass. 1?? civ., 31 janv. 1989, n° 87-11.829).
Toutefois, ce principe ne saurait revêtir un caractère absolu, certaines dettes échappant au report d’exigibilité. Tel est le cas des créances relatives aux biens indivis, qui doivent être acquittées sans délai. Ainsi, lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation en raison d’une jouissance privative (art. 815-9, al. 2 C. civ.), du produit net de la gestion d’un bien indivis (art. 815-12 C. civ.) ou encore des fruits et revenus indivis qu’il aurait perçus sans y être fondé (art. 815-10 C. civ.), ces dettes ne sauraient faire l’objet d’un sursis. L’article 865 du Code civil opère ainsi un cantonnement du principe général, en soumettant ces créances au régime de l’exigibilité immédiate (Cass. 1?? civ., 14 avr. 2021, n°19-21.313).
D’un point de vue pratique, cette dualité de régime influe directement sur la gestion patrimoniale des indivisaires. Tant que l’indivision perdure, le copartageant débiteur dispose d’une marge de manœuvre : il peut soit s’acquitter immédiatement de sa dette, soit en différer le règlement jusqu’au partage. Cette latitude lui permet d’adapter son choix en fonction de sa situation financière, des contraintes économiques et des perspectives patrimoniales qui s’offrent à lui.
2. Au moment du partage : un règlement obligatoire
Si le copartageant débiteur a pu repousser l’exécution de sa dette tant que durait l’indivision, ce choix n’est plus envisageable une fois venu le temps du partage. L’article 864 du Code civil prévoit en effet que, lorsque le partage intervient, la dette doit impérativement être rapportée et intégrée aux opérations de liquidation. Dès lors, l’imputation devient automatique et aucun refus n’est possible.
Cette exécution forcée du rapport peut s’opérer sous trois formes distinctes :
- Le rapport en moins prenant, qui constitue la règle de principe : la dette est imputée directement sur la part du copartageant débiteur, réduisant ainsi l’actif qui lui revient.
- Le prélèvement sur la masse partageable, notamment lorsque l’imputation directe est impossible ou insuffisante.
- L’allotissement spécifique, qui consiste à attribuer au copartageant débiteur un lot correspondant à sa dette, lorsque l’équilibre du partage l’exige.
La jurisprudence a rappelé que cette obligation s’impose même lorsque la dette excède la part successorale du copartageant débiteur (Cass. 1?? civ., 14 déc. 1983, n°82-14.725). Dans ce cas, le solde restant dû demeure à la charge du débiteur, qui devra s’en acquitter selon les modalités prévues initialement par l’obligation.
B) Les modalités d’exécution du rapport des dettes
Le rapport des dettes répond à un régime spécifique visant à assurer l’équilibre entre les héritiers lors du partage successoral. Consacré par l’article 864 du Code civil, il repose sur le mécanisme du rapport en moins prenant, permettant à l’héritier débiteur d’être alloti de la créance dont il est redevable à due concurrence de ses droits dans la succession. Cette technique favorise un règlement simplifié des dettes successorales tout en évitant la nécessité d’un remboursement immédiat. Toutefois, plusieurs ajustements peuvent être nécessaires en fonction de la situation des copartageants et de la composition de la masse successorale.
1. Le principe du rapport en moins prenant
Lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la créance existant contre lui est intégrée dans la masse partageable et lui est allouée lors du partage. Ce mécanisme, qualifié de rapport en moins prenant, obéit à une logique comptable permettant au copartageant débiteur d’être rempli de ses droits à hauteur de sa dette tout en évitant un paiement immédiat (art. 864, al. 1er C. civ.).
a. Imputation de la dette dans la masse successorale
L’article 864, alinéa 1??, du Code civil prévoit que lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre d’un copartageant, celui-ci en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. Ce mécanisme repose sur une opération purement comptable, dans laquelle la dette du copartageant vient diminuer sa part successorale, sans nécessiter de transfert de fonds.
Ce mode de règlement présente plusieurs avantages :
- Il évite d’exiger un paiement immédiat du copartageant débiteur, ce qui pourrait parfois s’avérer difficile.
- Il simplifie le partage en intégrant la créance à la masse successorale, assurant une répartition équilibrée entre les héritiers.
- Il permet l’extinction automatique de la dette par confusion, évitant ainsi toute contestation ultérieure.
L’application de ce mécanisme peut être aisément comprise à travers un exemple chiffré.
Supposons une succession dans laquelle :
- L’actif successoral net s’élève à 400 000 €.
- Deux héritiers, A et B, héritent à parts égales, soit 200 000 € chacun.
- A est débiteur de la succession à hauteur de 50 000 € (par exemple, en raison d’un prêt que lui avait consenti le défunt).
Afin d’intégrer la dette dans la succession, on ajoute la créance de 50 000 € à l’actif successoral pour obtenir la masse partageable :
Masse partageable = 400 000 € + 50 000 € = 450 000 €
Ainsi, la masse à partager entre les deux héritiers est portée à 450 000 €, soit 225 000 € chacun.
Allotissement de l’héritier débiteur A
- A reçoit en priorité la créance dont il est débiteur : 50 000 € sont ainsi imputés sur ses droits successoraux.
- Ce montant s’éteint par confusion, conformément à l’article 864, alinéa 1??, du Code civil.
- Son droit successoral s’élevant à 225 000 €, il lui reste encore 175 000 € à recevoir en biens ou en liquidités.
Attribution de l’héritier B
- L’héritier B, non débiteur, se voit attribuer 225 000 € en biens ou en liquidités, correspondant intégralement à sa part successorale.
A l’analyse, l’imputation de la dette dans la masse partageable repose sur une opération équilibrée qui ne crée aucun enrichissement injustifié au profit des héritiers.
En effet, l’effet immédiat de cette technique est l’extinction de la dette de l’héritier débiteur. L’article 864, alinéa 1??, du Code civil précise expressément que la dette s’éteint par confusion dès lors qu’elle est allouée à l’héritier débiteur. Il s’agit d’un mécanisme proche de la confusion des qualités de créancier et de débiteur (Cass. 1ère civ., 26 déc. 1960).
Ainsi, A ne devra plus rien à la succession, et aucun paiement effectif n’est exigé. La dette est purement et simplement absorbée par l’imputation.
L’un des principaux intérêts de l’imputation de la dette est qu’elle évite toute liquidation forcée des biens successoraux.
- Si l’héritier débiteur était tenu de rembourser immédiatement sa dette en numéraire, il pourrait être contraint de vendre des actifs (notamment un bien immobilier familial).
- En procédant par imputation, on maintient la stabilité de l’actif successoral et on préserve l’unité des biens indivis.
Dans notre exemple, A ne subit aucun appauvrissement immédiat, et B n’a pas à attendre un remboursement qui pourrait s’avérer incertain.
En imputant la dette sur la part successorale de A, la répartition demeure strictement équitable :
- A perçoit bien 225 000 € en valeur, mais cette somme inclut les 50 000 € de dette dont il était redevable.
- B ne subit aucune perte et reçoit sa part intégrale de 225 000 €.
b. Limite de l’imputation : l’obligation de paiement du solde
==>L’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision pour éteindre la dette du copartageant
Si la dette du copartageant excède ses droits dans l’indivision, l’imputation ne suffit plus à assurer son extinction intégrale. L’article 864, alinéa 2, du Code civil prévoit ainsi que le copartageant reste tenu du paiement du solde, selon les conditions initiales de l’obligation.
Prenons une hypothèse où l’héritier A est redevable d’une somme plus importante :
- L’actif successoral est toujours de 400 000 €.
- A est débiteur de 250 000 € envers la succession.
- La masse partageable, incluant cette créance, est de 650 000 €, soit 325 000 € de droits pour chaque héritier.
Conséquence du dépassement de la part successorale :
- A reçoit en priorité la créance existant contre lui à hauteur de 325 000 €.
- Cependant, sa dette s’élève à 250 000 €, ce qui dépasse ses droits successoraux (225 000 €).
- L’imputation opère à hauteur de 225 000 €, mais il reste un solde de 25 000 € à payer.
L’héritier débiteur devra donc s’acquitter du reliquat auprès des cohéritiers, dans les conditions et délais initialement attachés à l’obligation.
==>L’incidence de l’insuffisance de la créance détenue contre l’indivision sur le droit au partage
Pour mémoire, l’article 815 du Code civil énonce le principe selon lequel « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision », consacrant ainsi le droit pour tout indivisaire de provoquer le partage à tout moment. Toutefois, lorsque l’un des héritiers se trouve débiteur à l’égard de la succession et que l’allotissement de sa dette épuise intégralement ses droits dans la masse successorale, se pose la question de savoir s’il demeure en mesure d’exercer ce droit.
Dans un arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a semblé exclure cette faculté pour un héritier dont la dette excédait sa part successorale (Cass. 1ère civ. 14 déc. 1983, n°82-14.725). En l’espèce, un défunt laissait à sa succession plusieurs enfants et une veuve usufruitière. L’un des héritiers, ayant été placé en règlement judiciaire, voyait son syndic solliciter le partage de la succession ainsi que la licitation des immeubles indivis. Or, il apparaissait que d’importantes sommes avaient été versées par le défunt et son épouse pour acquitter certaines dettes de cet héritier, créant ainsi une dette rapportable excédant largement ses droits successoraux.
La cour d’appel, statuant sur cette demande de partage, avait relevé que la dette rapportable dépassait très largement la part successorale de l’héritier débiteur. Dès lors, elle avait rejeté la demande en partage et en licitation, en estimant que cet héritier, n’ayant plus de droits résiduels dans la succession après imputation de sa dette, ne pouvait plus prétendre à une quelconque attribution et, partant, ne disposait plus du droit d’agir en partage.
La Cour de cassation valide cette solution et affirme que, lorsqu’un héritier est débiteur envers la succession d’une somme supérieure à sa part successorale, il ne peut lui être fait dans le partage aucune attribution. Dans ces conditions, ses créanciers personnels, agissant par voie oblique, ne sauraient avoir plus de droits que lui. En d’autres termes, non seulement l’héritier ne peut plus prétendre au partage, mais ses créanciers, qui n’ont vocation qu’à exercer par subrogation les droits de leur débiteur, ne peuvent davantage provoquer ce partage pour tenter d’en tirer profit.
La portée de cet arrêt ne saurait cependant être interprétée de manière absolue. Il convient en effet de distinguer l’existence du droit au partage et l’intérêt à agir dans un tel cadre.
D’un point de vue strictement juridique, l’héritier demeure indivisaire tant que le partage n’a pas été réalisé. Il conserve donc, en principe, son droit de provoquer le partage, indépendamment de sa situation patrimoniale. De surcroît, le rapport des dettes est lui-même une opération de partage, et lui refuser ce droit reviendrait à priver l’héritier débiteur d’un mode de règlement favorable de son obligation.
Cependant, l’arrêt du 14 décembre 1983 met en lumière une limite tenant à l’absence d’intérêt à agir en partage. Dès lors que l’héritier débiteur ne dispose plus d’aucun droit réel dans la masse successorale, le partage devient, pour lui, une opération dénuée d’effet : il ne saurait obtenir une attribution en biens ou en valeur, et ses créanciers ne pourraient espérer recouvrer une quelconque somme via cette voie. En ce sens, l’arrêt ne nie pas tant un droit abstrait au partage qu’il ne sanctionne une situation où l’héritier n’a rien à revendiquer dans l’indivision.
Ainsi, l’héritier débiteur peut en principe provoquer le partage, mais lorsque sa dette excède intégralement ses droits successoraux, cette faculté devient théorique et privée d’objet. Son intérêt à agir disparaît dès lors que son allotissement par imputation épuise la totalité de ses droits dans la succession.
L’autre enseignement majeur de cette décision réside dans l’impossibilité, pour les créanciers personnels de l’héritier débiteur, d’exercer l’action en partage par voie oblique (art. 1341-1 C. civ.).
L’action oblique, qui permet aux créanciers d’un débiteur inactif d’exercer ses droits afin de préserver leur gage, suppose que ce dernier dispose encore d’un droit effectif à faire valoir. Or, en l’absence de tout droit résiduel dans la succession après imputation de sa dette, le partage ne saurait produire pour l’héritier débiteur aucun effet utile. Dès lors, ses créanciers personnels ne sauraient obtenir, par l’exercice d’une action oblique, plus de droits que leur débiteur.
Dans l’arrêt du 14 décembre 1983, la Cour de cassation a expressément refusé aux créanciers d’un héritier débiteur la possibilité de provoquer le partage, au motif que ce dernier ne disposait plus d’aucun droit patrimonial dans la succession.
Il ne s’agit donc pas d’une interdiction de principe d’agir en partage pour un créancier oblique, mais d’une conséquence logique de l’absorption totale des droits successoraux par l’imputation de la dette. Le partage, dans une telle configuration, est dépourvu de substance, puisqu’aucune attribution ne peut être réalisée au profit du débiteur, et, par voie de conséquence, au bénéfice de ses créanciers.
L’équilibre successoral repose ainsi sur un double constat :
- Le partage suppose une répartition effective de l’actif indivis entre les héritiers, ce qui implique que chacun conserve des droits dans la masse successorale.
- Lorsqu’un héritier voit ses droits totalement absorbés par l’imputation de sa dette, il ne peut prétendre à aucune attribution et ne peut, en conséquence, procurer à ses créanciers aucune valeur issue de la succession.
Dans ce contexte, la Cour de cassation veille à éviter toute instrumentalisation de l’action en partage à des fins purement opportunistes. Le partage ne saurait être imposé aux cohéritiers dans un but purement artificiel, dès lors qu’il ne produirait aucun effet utile pour l’héritier débiteur et, par ricochet, pour ses créanciers.
Imaginons une succession comprenant :
- Un actif net de 500 000 €.
- Une dette rapportable de 300 000 €, dont l’héritier A est redevable.
- Une masse partageable portée à 800 000 € après intégration de cette créance (500 000 € + 300 000 €).
- Deux héritiers, A et B, disposant chacun, en théorie, de 400 000 € de droits successoraux.
Dans cette configuration :
- L’imputation en moins prenant absorbe les 400 000 € de droits de A, qui se trouve donc totalement privé de toute attribution effective dans la succession.
- Ses créanciers personnels tentent alors d’exercer son droit au partage par voie oblique, espérant recouvrer des fonds sur la masse successorale.
- Toutefois, comme A n’a plus aucun droit résiduel dans l’indivision, le partage ne leur apporterait rien.
Dès lors, en application de l’arrêt du 14 décembre 1983, ces créanciers ne peuvent obtenir le partage, car ils ne sauraient revendiquer plus de droits que leur débiteur. L’action oblique, qui vise normalement à pallier l’inertie du débiteur, se heurte ici à l’absence même de droit à faire valoir.
En refusant aux créanciers personnels de l’héritier débiteur la possibilité d’agir en partage, la Cour de cassation préserve la stabilité des opérations successorales. Une solution inverse aurait conduit à une immixtion excessive des créanciers dans le règlement des successions, au mépris des droits des autres cohéritiers.
Ce mécanisme permet ainsi d’éviter deux écueils majeurs :
- L’exploitation opportuniste du droit au partage par des créanciers extérieurs à la succession, qui chercheraient à imposer un partage sans que leur débiteur puisse en tirer le moindre bénéfice.
- L’instabilité successorale, qui pourrait résulter d’actions répétées des créanciers tentant de forcer un partage alors même qu’aucune valeur n’est recouvrable pour eux.
La portée de cet arrêt est donc claire : le droit au partage est un droit successoral attaché à la qualité d’héritier, et non un outil à la disposition des créanciers pour forcer un partage dénué d’objet. Dès lors que l’imputation de la dette épuise totalement les droits successoraux de l’héritier concerné, le partage perd toute finalité économique et ne peut être sollicité ni par lui, ni par ses créanciers.
c. Cas particulier des créances croisées entre copartageants
L’article 867 du Code civil prévoit que le mécanisme de la compensation joue lorsque le copartageant débiteur dispose lui-même d’une créance à faire valoir contre la succession. Avant toute imputation, un solde est établi, permettant d’opérer une neutralisation partielle des dettes et créances respectives.
Imaginons que A soit à la fois débiteur et créancier de la succession :
- A doit 50 000 € à la succession.
- A détient aussi une créance de 20 000 € contre la succession (par exemple, une somme qu’il avait avancée pour payer les frais funéraires).
Mise en œuvre de la compensation :
- La créance de 20 000 € est déduite de la dette de 50 000 €.
- Après compensation, A ne doit plus que 30 000 € à la succession.
- Cette somme sera alors intégrée dans la masse partageable et imputée sur ses droits successoraux.
Grâce à cette compensation préalable, A évite une double imputation, ce qui garantit une neutralité économique et une répartition fidèle à la réalité des obligations respectives.
2. L’alternative au rapport en moins prenant : les prélèvements
Si le rapport en moins prenant demeure la méthode privilégiée pour assurer l’exécution du rapport des dettes, il n’est pas toujours réalisable. En particulier, dans le cadre d’un partage judiciaire impliquant un tirage au sort des lots, l’attribution de la créance au copartageant débiteur devient impossible (art. 826 C. civ.). Dans une telle configuration, il est alors nécessaire d’avoir recours à une méthode alternative, celle des prélèvements, qui permet de rétablir l’égalité entre les copartageants tout en assurant la répartition des biens successoraux.
Contrairement au rapport en moins prenant, qui repose sur une imputation directe de la dette au sein du lot du débiteur, la technique des prélèvements repose sur une logique inverse : ce sont les autres héritiers qui prélèvent, sur la masse successorale, une valeur équivalente au montant de la dette rapportable avant toute répartition.
En d’autres termes, au lieu d’attribuer la créance au copartageant débiteur et de réduire son lot en conséquence, les cohéritiers non débiteurs effectuent un prélèvement compensatoire, ce qui diminue d’autant l’actif successoral disponible pour être partagé. Ce mécanisme permet ainsi d’intégrer la dette au processus de partage sans avoir à l’allouer directement au débiteur.
Imaginons une succession comprenant les éléments suivants :
- Un immeuble évalué à 300 000 € ;
- Des liquidités s’élevant à 60 000 € ;
- Une dette rapportable de 40 000 €, dont l’héritier A est débiteur.
En raison d’un désaccord entre les cohéritiers, le partage ne peut être réalisé à l’amiable et doit être effectué judiciairement par tirage au sort des lots. Or, dans ce cadre, l’imputation directe de la dette au sein du lot de A devient impossible, car un tel mécanisme supposerait que A puisse être alloti précisément du lot contenant la créance, ce qui n’est pas garanti lors d’un tirage au sort.
Solution retenue : le prélèvement compensatoire
- Masse successorale initiale : 360 000 € (300 000 € + 60 000 €).
- Prélèvement compensatoire réalisé par B : 40 000 €.
- Masse résiduelle à partager : 320 000 € (360 000 € – 40 000 €).
- Droits de chaque héritier après prélèvement : 160 000 € chacun.
- Constitution de deux lots équivalents à 160 000 € chacun, permettant ainsi le tirage au sort, conformément aux règles du partage judiciaire.
Ainsi, la dette de A a bien été neutralisée au sein de la succession, sans qu’il soit nécessaire de lui en allouer directement la charge. L’équilibre successoral est maintenu, chaque cohéritier recevant sa juste part, tandis que l’incertitude liée au tirage au sort est évitée.
Si le prélèvement constitue une solution technique efficace, il demeure rarement mis en œuvre en raison des nombreux inconvénients qu’il présente.
Le premier écueil de cette méthode tient à son effet réducteur sur l’actif successoral. En effet, en permettant aux cohéritiers non débiteurs d’opérer un prélèvement compensatoire, la technique diminue la masse des biens à partager, ce qui peut engendrer des difficultés de répartition.
Exemple :
Si la succession comprend un bien immobilier d’une valeur de 300 000 € et des liquidités de 60 000 €, un prélèvement de 40 000 € sur la masse successorale réduit la part disponible, risquant ainsi d’entraîner la vente forcée du bien pour assurer une égalité entre les héritiers.
En comparaison, le rapport en moins prenant évite cette difficulté en maintenant l’intégralité de la masse successorale intacte, puisque la dette est imputée directement sur le lot du débiteur.
Le prélèvement suppose nécessairement :
- Une évaluation précise des biens successoraux afin de déterminer la valeur exacte du prélèvement compensatoire.
- Un accord entre les héritiers sur la méthode de compensation.
Or, en pratique, la valorisation des biens peut être contestée, notamment lorsque la succession comporte des actifs immobiliers, dont la valeur fluctue selon les conditions du marché. L’absence de consensus sur le bien sur lequel doit porter le prélèvement risque alors de prolonger inutilement le règlement successoral.
Illustration :
Si la succession comprend deux immeubles d’une valeur estimée à 150 000 € chacun, un héritier pourrait contester l’attribution d’un immeuble entier en compensation du prélèvement, au motif que sa valeur réelle excède le montant de la dette rapportable.
Le prélèvement modifie l’équilibre initialement prévu par les règles successorales, en créant un déséquilibre dans la répartition des biens.
Ainsi, un héritier bénéficiant du prélèvement pourrait recevoir des biens de moindre valeur ou se voir contraint d’accepter un bien qu’il ne souhaitait pas initialement.
De plus, cette méthode introduit un risque de contentieux, les héritiers pouvant contester le bien-fondé du prélèvement ou la modalité de répartition des biens résiduels.
C) L’effet de l’exécution du rapport des dettes
1. L’impact sur la masse partageable
L’exécution du rapport des dettes entraîne une modification immédiate de la composition de la masse partageable. Conformément à l’article 864, alinéa 1??, du Code civil, lorsque la succession comprend une créance à l’encontre de l’un des héritiers, cette créance est réintégrée dans la masse successorale et attribuée au débiteur à concurrence de ses droits. Cette réintégration a une incidence purement comptable : elle majore artificiellement l’actif successoral sans pour autant entraîner un apport effectif de fonds.
L’objectif du mécanisme est double :
- Préserver l’égalité entre les cohéritiers en évitant qu’un héritier débiteur bénéficie d’un avantage indu en ne rapportant pas les sommes dont il a profité.
- Empêcher un appauvrissement de la succession qui résulterait d’un remboursement immédiat, lequel pourrait imposer une cession forcée de biens successoraux.
Cependant, il convient de noter que cette intégration comptable ne modifie pas la consistance des biens à partager. Elle se traduit par une augmentation arithmétique de la masse successorale, sans affecter la composition physique du patrimoine, sauf lorsque le solde de la dette excède les droits de l’héritier débiteur, auquel cas celui-ci demeure redevable du reliquat envers la succession.
2. L’application du principe du nominalisme monétaire
Le rapport des dettes est soumis au principe du nominalisme monétaire, consacré à l’article 1895 du Code civil, selon lequel « l’obligation qui résulte d’un prêt en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat ».
Ainsi, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, il ne doit rapporter que le montant nominal de sa dette, sans réévaluation en fonction de l’évolution monétaire ou de la valeur du bien acquis grâce aux fonds empruntés. Ce principe, consacré par la jurisprudence, a été renforcé par la loi du 23 juin 2006, qui a clairement distingué le rapport des dettes du rapport des libéralités.
==>L’application du nominalisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants
Bien que le nominalisme monétaire soit une règle de droit commun en matière d’obligations pécuniaires, il revêt une importance particulière dans le cadre de l’indivision. Lorsqu’un copartageant a une dette envers l’indivision, celle-ci doit être intégrée dans la masse partageable pour son montant nominal, sans que sa valeur puisse être réajustée en fonction d’événements postérieurs.
La réforme du 23 juin 2006 a permis de clarifier cette règle. Sous l’ancien régime, l’article 869 du Code civil prévoyait que le rapport d’une somme d’argent devait s’effectuer pour son montant nominal, sauf si cette somme avait servi à l’acquisition d’un bien. Dans ce cas, le rapport devait être effectué pour la valeur du bien acquis au jour du partage. Ce mécanisme, qui s’appliquait au rapport des libéralités, avait un temps été étendu au rapport des dettes, générant une confusion entre ces deux notions (Cass. 1?? civ. 18 janv. 1989).
Désormais, avec la suppression de l’ancien article 869 et son remplacement par l’article 860-1 du Code civil, seul le rapport des libéralités est susceptible de faire l’objet d’une revalorisation en fonction de la valeur du bien acquis grâce à la somme rapportable. Le rapport des dettes, quant à lui, demeure exclusivement régi par le nominalisme monétaire. Ainsi, même si les fonds empruntés ont permis d’acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué, le copartageant débiteur n’est tenu de rapporter que la somme nominale de la dette initiale.
La jurisprudence a confirmé l’application stricte du nominalisme monétaire au rapport des dettes à l’occasion d’un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 29 juin 1994 (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994, n°92-15.253). Cet arrêt a définitivement écarté l’application de l’ancien article 869 du Code civil, qui régissait le rapport des libéralités, au rapport des dettes entre copartageants. Désormais, aucune revalorisation des dettes rapportables n’est admise, quelle que soit la destination des fonds empruntés.
L’affaire soumise à la Haute juridiction illustre parfaitement cette nouvelle règle. Il s’agissait d’un prêt d’un million de francs consenti par un père à son fils pour l’acquisition d’un immeuble. Après le décès du prêteur, l’indivision successorale se retrouvait créancière de cette somme. Un litige s’éleva entre les cohéritiers quant aux modalités de rapport de cette dette : fallait-il l’imputer pour son montant nominal, ou devait-on, par analogie avec le rapport des libéralités d’argent, tenir compte de la valeur actuelle du bien acquis grâce aux fonds prêtés ?
La cour d’appel avait retenu que l’indivision était créancière de la somme nominale d’un million de francs, correspondant au montant initial du prêt, sans revalorisation. La Cour de cassation a censuré cette décision en affirmant que « si le rapport des dettes prévu par l’article 829 du Code civil n’est qu’une technique de règlement qui n’obéit pas aux règles de l’article 869 du même Code, lequel concerne exclusivement le rapport des libéralités, le cohéritier débiteur n’en doit pas moins réaliser le rapport de sa dette en moins prenant, par imputation sur sa part, et non en effectuer le paiement ».
Deux enseignements peuvent être tirés de cette décision :
- Premier enseignement
-
- Contrairement aux libéralités, dont le rapport peut être effectué en valeur, le rapport des dettes se fait uniquement pour son montant nominal.
- L’ancien article 869 du Code civil, qui prévoyait une exception pour les libéralités ayant servi à financer l’acquisition d’un bien, ne saurait s’appliquer aux dettes.
- Second enseignement
-
- L’héritier ou le copartageant débiteur ne doit pas effectuer un paiement, mais uniquement une imputation sur sa part dans l’indivision, à hauteur de la dette existante.
En d’autres termes, quelle que soit la finalité du prêt, celui-ci demeure soumis au principe du nominalisme monétaire. Ainsi, quand bien même l’immeuble acquis grâce aux fonds empruntés aurait vu sa valeur évoluer entre le moment du prêt et celui du partage, cette fluctuation ne saurait être prise en compte. La dette demeure rapportable pour son montant nominal, et non pour la valeur du bien acquis.
Par cette décision, la Cour de cassation a ainsi confirmé une jurisprudence constante, refusant toute assimilation entre prêt et libéralité, et affirmant que le rapport des dettes constitue une opération purement comptable, déconnectée de la variation de valeur des biens acquis grâce aux sommes prêtées.
==>L’exclusion de l’application du valorisme monétaire dans le rapport des dettes entre copartageants
L’indépendance du rapport des dettes à l’égard du rapport des libéralités s’explique par leur nature fondamentalement distincte. Tandis que le rapport des libéralités tend à rétablir l’égalité entre les copartageants en tenant compte de la valeur réelle des biens transmis, le rapport des dettes repose exclusivement sur une logique comptable. Il ne poursuit d’autre finalité que l’intégration des créances existantes contre l’un des copartageants dans la masse partageable, sans altérer la consistance des biens à répartir.
L’application du nominalisme monétaire à cette opération se justifie par plusieurs considérations. Tout d’abord, une dette ne saurait être assimilée à un avantage consenti à titre gratuit. Alors qu’une libéralité modifie de manière définitive la structure patrimoniale du gratifié, en augmentant son patrimoine sans contrepartie, une dette crée une obligation de remboursement, qui empêche de la considérer comme une libéralité. Il serait donc incohérent de soumettre ces deux mécanismes à une même règle d’évaluation, d’autant que le rapport des libéralités répond à une finalité d’équité entre les copartageants, tandis que le rapport des dettes vise simplement à organiser la répartition des droits successoraux ou indivis.
Le principe du nominalisme monétaire trouve également sa justification dans le fait que le copartageant débiteur conserve toujours la possibilité de s’exécuter par un paiement volontaire avant le partage. Tant que l’indivision subsiste, il peut solder sa dette en numéraire, ce qui lui permet de ne pas être alloti de sa créance dans le partage. Dès lors, il serait illogique que le montant de la dette rapportable varie selon qu’elle est réglée par paiement ou par imputation. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par la jurisprudence, qui a rappelé que la dette rapportable ne peut être réévaluée et qu’elle doit être imputée à son montant nominal, conformément au principe du nominalisme monétaire (Cass. 1?? civ. 13 janv. 1998, n°96-11.688).
Enfin, l’application stricte de ce principe implique que, même si les fonds empruntés ont été utilisés pour acquérir un bien dont la valeur a fortement évolué depuis l’octroi du prêt, le copartageant débiteur ne saurait être tenu de rapporter une somme supérieure à celle qu’il a initialement reçue. Peu importe l’appréciation ou la dépréciation éventuelle de l’actif financé, la dette demeure évaluée à sa valeur nominale, sans prise en compte de la destination des fonds. C’est ainsi que le rapport des dettes s’affirme comme une opération purement comptable, déconnectée de toute logique de réajustement patrimonial entre les copartageants.
==>L’exception des dettes de valeur
Si le principe du nominalisme monétaire constitue la règle générale en matière de rapport des dettes, certaines créances échappent par nature à cette logique et doivent être évaluées selon d’autres critères. Il s’agit de dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, qu’il s’agisse de leur libellé en monnaie étrangère, de leur indexation sur un indice ou encore de leur exécution en nature. Ces situations dérogatoires illustrent les limites du nominalisme monétaire et la nécessité d’adopter une approche plus souple pour garantir une évaluation conforme à la réalité économique du partage.
- Les dettes libellées en devises étrangères
-
- Lorsqu’une dette rapportable est contractée en monnaie étrangère, son évaluation ne saurait s’opérer en appliquant rigoureusement le nominalisme monétaire, sous peine d’introduire un décalage significatif entre la valeur initiale de l’obligation et son montant actualisé au moment du partage.
- Il est en effet admis que le règlement d’une telle dette doit tenir compte du taux de change en vigueur au jour du partage, et non de celui applicable au jour de la naissance de l’obligation.
- Cette solution a été consacrée par la jurisprudence, notamment par un arrêt du 10 juin 1976 aux termes duquel la Cour de cassation a jugé qu’une dette libellée en dollars devait être évaluée à la date de son règlement et non à sa valeur en francs français au moment de son octroi (Cass. 1ère civ. 10 juin 1976, n°75-10.798).
- Ainsi, un copartageant débiteur d’une somme en monnaie étrangère ne rapportera pas nécessairement l’équivalent en euros de ce qu’il devait lors de la naissance de l’obligation, mais la somme convertie sur la base du taux de change applicable au jour du partage.
- Cette exception se justifie par la nature fluctuante des devises, dont la valeur est susceptible d’évoluer de manière significative entre la date de contraction de la dette et celle de son règlement.
- En fixant l’évaluation au jour du partage, la jurisprudence entend assurer une équivalence économique entre les parties, en prenant en compte la réalité monétaire du moment où la dette est effectivement apurée.
- Les dettes indexées
-
- Certaines dettes rapportables sont assorties d’une clause d’indexation, prévoyant une revalorisation automatique en fonction d’un indice de référence, tel que l’inflation, le coût de la construction ou un indice sectoriel spécifique.
- Dans ces cas, l’application stricte du nominalisme monétaire serait contraire à la volonté des parties et à la nature même de l’obligation, qui a vocation à évoluer dans le temps afin de refléter une valeur actualisée.
- Ainsi, lorsqu’un copartageant est tenu de rapporter une dette indexée, son montant sera nécessairement ajusté en fonction de l’indice applicable au jour du partage.
- Loin d’être une remise en cause du principe du nominalisme monétaire, cette exception trouve son fondement dans la nature même de l’engagement souscrit, qui implique une réévaluation systématique et contractuellement prévue.
- L’application de cette règle se rencontre fréquemment dans les dettes résultant de contrats de prêt assortis d’une clause de révision du taux d’intérêt ou d’obligations financières indexées sur des indices économiques.
- Dans ces hypothèses, le copartageant débiteur ne pourra rapporter sa dette qu’à hauteur de son montant réévalué, conformément aux conditions initiales de l’obligation.
- Les obligations de restitution en nature
-
- Enfin, certaines dettes rapportables ne peuvent être réduites à une simple somme d’argent et impliquent une restitution en nature.
- Il en va ainsi lorsque l’obligation porte sur un bien déterminé, tel qu’un objet d’art, des titres financiers ou un actif dont la valeur intrinsèque est fluctuante.
- Dans ces cas, le principe du nominalisme monétaire cède nécessairement le pas au valorisme, l’évaluation devant tenir compte de la valeur réelle du bien au jour du partage.
- Prenons l’exemple d’un copartageant ayant reçu en prêt une collection de tableaux, dont il est tenu de restituer l’équivalent patrimonial lors du partage.
- Si ces œuvres ont vu leur valeur s’accroître de manière significative au fil des années, la dette ne pourra être évaluée à hauteur de la somme nominale initialement convenue.
- L’évaluation devra s’opérer en fonction de la valeur vénale des œuvres au jour du partage, afin d’assurer un règlement conforme à la consistance réelle de la masse successorale.
- De même, lorsqu’un copartageant est tenu de restituer des titres financiers ou des actifs soumis à une fluctuation de valeur, l’évaluation doit nécessairement tenir compte de la cotation en vigueur au moment du partage.
- L’application stricte du nominalisme monétaire conduirait à des distorsions manifestes, en obligeant le débiteur à rapporter une somme sans lien avec la valeur actuelle du bien concerné.
Ces exceptions, bien que résultant de cas très spécifiques, révèlent que le nominalisme monétaire n’est pas une règle absolue et qu’il peut céder dans certaines situations où l’évaluation monétaire stricte ne reflète pas la réalité patrimoniale du partage. Toutefois, ces tempéraments concernent uniquement des dettes dont l’objet présente une variabilité intrinsèque, et ne remettent aucunement en cause l’application du principe du nominalisme monétaire aux dettes de sommes d’argent.
En définitive, si les dettes libellées en devises étrangères, les obligations indexées et les restitutions en nature échappent au nominalisme monétaire, ce principe joue pour toutes les dettes strictement pécuniaires, qui restent soumises aux dispositions de l’article 1895 du Code civil. C’est ainsi que le droit positif maintient une distinction nette entre les dettes de sommes d’argent, qui restent évaluées à leur valeur nominale, et les dettes de valeur, dont l’évaluation doit tenir compte des fluctuations affectant leur objet.
3. La production d’intérêts sur les dettes rapportables
L’article 866 du Code civil instaure un régime autonome régissant la production d’intérêts sur les dettes rapportables. Il s’agit d’une évolution notable, car, sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence appliquait de manière indifférenciée aux dettes et aux libéralités rapportables les règles de l’article 856 du Code civil, lequel prévoit que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession. Désormais, les dettes rapportables obéissent à des règles propres, qui tiennent compte de leur origine et de leur nature.
==>Une production d’intérêts de plein droit, au taux légal ou conventionnel
L’alinéa premier de l’article 866 du Code civil dispose que les dettes rapportables produisent intérêt au taux légal, sauf stipulation contraire. Il en résulte que, même si l’obligation initiale n’était pas productrice d’intérêts avant l’ouverture de la succession, elle le devient de plein droit dès lors qu’elle est soumise au mécanisme du rapport.
Cette solution, appliquée de façon constante par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 15 mai 2001, n°99-10.286), a été expressément consacrée par le législateur. Les intérêts sont dus sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, ce qui distingue ces obligations des dettes civiles ordinaires.
Toutefois, les coïndivisaires conservent la faculté de convenir d’un taux distinct du taux légal, sous réserve du respect des limites fixées par les règles relatives au taux d’usure. Ainsi, si le de cujus avait prévu contractuellement un taux d’intérêt supérieur ou inférieur au taux légal pour la dette concernée, cette stipulation demeure applicable, conformément au principe de la force obligatoire du contrat.
==>Le point de départ des intérêts
L’article 866 du Code civil distingue selon que la dette rapportable est née avant la constitution de l’indivision ou qu’elle est survenue en cours d’indivision.
- Les dettes préexistantes à l’indivision
-
- Lorsque la dette existait avant l’ouverture de l’indivision – que celle-ci résulte d’un décès, d’un divorce, d’une dissolution de PACS ou de la cessation d’une indivision conventionnelle – les intérêts commencent à courir dès la constitution de l’indivision.
- Cette règle assure la continuité du régime juridique des créances détenues contre un copartageant et s’inscrit dans la lignée des solutions jurisprudentielles antérieures, qui admettaient déjà que les créances préexistantes à l’indivision produisent intérêts dès le jour de la naissance de celle-ci (Cass. 1ère civ, 8 juin 2004, n°01-15.044).
- Ainsi, un indivisaire débiteur d’une somme envers l’indivision au jour de sa constitution ne peut différer le cours des intérêts : la dette est réputée immédiatement exigible à l’égard des autres copartageants, ce qui justifie l’application du taux légal dès la naissance de l’indivision.
- Les dettes nées en cours d’indivision
-
- Lorsque la dette naît après la constitution de l’indivision, les intérêts ne courent qu’à compter du jour où elle devient exigible.
- Cette solution, désormais consacrée par l’article 866 du Code civil, rompt avec la jurisprudence antérieure, qui, dans certains cas, admettait que les intérêts puissent courir dès la constitution de l’indivision, même lorsque la dette lui était postérieure (Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n°01-12.810 et 01-15.367).
- Désormais, le texte met fin à cette incertitude en retenant une règle claire et sécurisante : tant qu’une dette contractée par un indivisaire dans le cadre de l’indivision n’est pas exigible, elle ne produit pas d’intérêts.
- Ce principe permet d’éviter qu’un copartageant se voie imposer des intérêts moratoires alors même qu’il n’a pas encore été mis en demeure d’exécuter son obligation.
Il peut être observé que lorsque le montant de la dette n’est pas déterminé au jour de la constitution de l’indivision, les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la fixation de son montant. Ce principe, dégagé par la jurisprudence (Cass. 1ère civ., 27 janv. 1987, n°85-15.336), repose sur une considération de bon sens : il serait manifestement inéquitable d’exiger des intérêts sur une obligation dont l’assiette demeure indéterminée.
Cette règle trouve notamment à s’appliquer dans les situations où le montant de la dette fait l’objet d’une contestation entre copartageants ou lorsque son évaluation nécessite un processus préalable (par exemple, lorsqu’il s’agit d’une dette de valeur liée à un actif dont la valorisation est fluctuante). Dans ces hypothèses, les intérêts ne commencent à courir qu’à compter du moment où la dette est définitivement liquidée, en cohérence avec la nature indemnitaire des intérêts moratoires.
==>L’anatocisme
Le mécanisme de l’anatocisme – c’est-à-dire la capitalisation des intérêts pour produire eux-mêmes des intérêts – est admis dans le cadre du rapport des dettes. Cette solution trouve son fondement dans l’ancien article 1154 du Code civil (devenu l’article 1343-2), ainsi que dans une jurisprudence bien établie (Cass. 1ère civ., 19 oct. 1983, n° 82-11.982).
Toutefois, l’anatocisme ne saurait s’appliquer automatiquement. Il suppose :
- Que les intérêts soient dus pendant au moins une année entière avant de pouvoir être capitalisés.
- Qu’une demande expresse soit formulée par l’un des copartageants pour obtenir la capitalisation des intérêts (Civ. 1??, 23 mars 1994, n° 92-13.345).
Ainsi, bien que le rapport des dettes puisse donner lieu à une production d’intérêts capitalisables, leur accumulation reste strictement encadrée et soumise à des conditions précises.
==>L’assiette des intérêts
Enfin, l’assiette des intérêts doit être précisément définie. Toutes les dettes rapportables ne produisent pas nécessairement intérêts sur l’intégralité de leur montant. Seules les sommes excédant les droits du copartageant débiteur dans la masse indivise génèrent des intérêts.
La jurisprudence a confirmé cette solution en jugeant que seules les dettes restant exigibles après imputation sur les droits dans l’indivision sont productives d’intérêts (CA Paris, 23 oct. 1986).
Autrement dit, lorsqu’un copartageant est débiteur envers l’indivision, la compensation entre sa dette et ses droits indivis s’opère en priorité. Ce n’est qu’à hauteur du solde demeurant exigible après compensation que des intérêts seront dus. Cette règle vise à éviter qu’un copartageant, bien que débiteur, ne soit excessivement pénalisé par une accumulation d’intérêts sur une dette qui, pour partie, s’impute naturellement sur ses droits dans l’indivision.