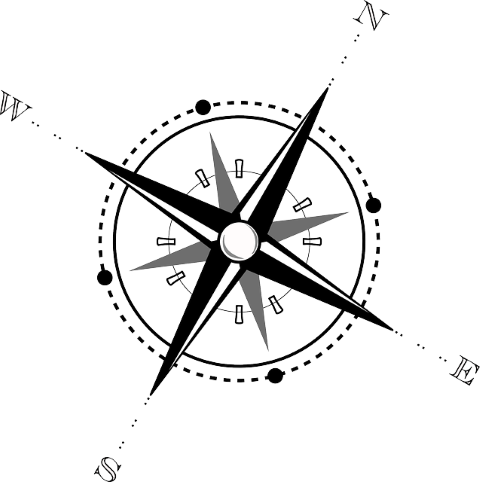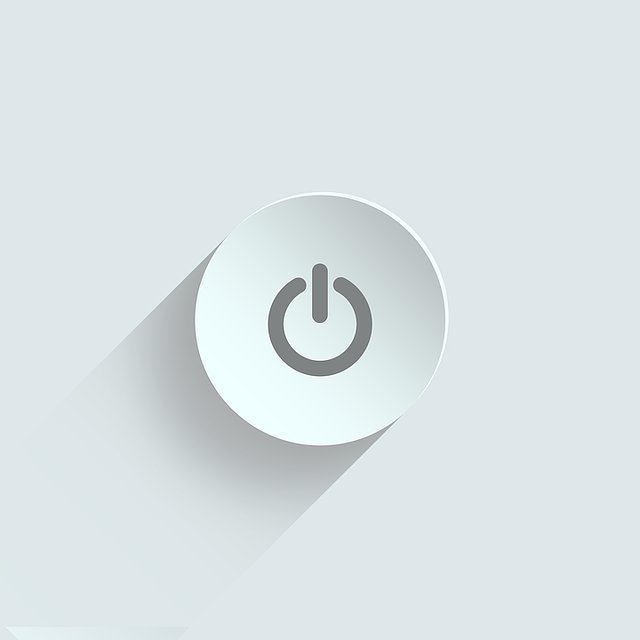Une fois le bail identifié (v. art “Le bail de droit commun : qualification juridique”), il faut envisager ses conditions de formation.
L’article 1128 nouv. c.civ. (art. 1108 anc.) énumère les trois conditions nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain. En somme, la loi pose, d’une part, des conditions relatives au parties au contrat (section 1) et, d’autre part, des conditions relatives au contenu du contrat (section 2).
Section 1.- Les conditions relatives aux parties au contrat
§1.- Le consentement
Contrat consensuel. – Le bail est un contrat consensuel. Il se forme aussitôt les éléments essentiels du contrat définis. Aucune forme particulière n’est requise pour la validité du bail de droit commun. Peu importe, à tout le moins en théorie, que le bail soit écrit ou verbal. Certes, l’article 1714 c.civ., dispose qu’il est possible de louer « par écrit ou verbalement ». Pris à la lettre, ce texte pourrait donner à penser que le bail est un contrat solennel. Attention aux apparences : ce n’est qu’une règle de preuve du contrat et non une condition de formation exigée à peine de nullité.
Contrats préparatoires. – Comme pour tout contrat, le bail peut faire l’objet d’un contrat préparatoire. Les parties peuvent donc décider de conclure préalablement au contrat définitif de bail un pacte de préférence engageant le promettant à proposer le bail au bénéficiaire le jour où il décidera de louer (art. 1123 nouv. c.civ.). Elles peuvent également stipuler une promesse unilatérale aux termes de laquelle le promettant s’engage à conclure le bail si le bénéficiaire lève l’option (art. 1124 nouv. c.civ.). A noter qu’une une promesse synallagmatique de bail peut être conclue. Dans ce cas, à l’image de la vente et par application analogique de l’article 1589 c.civ., la promesse de bail vaut bail.
§2.- La capacité
La condition de capacité des parties au bail présente quelques singularités. Pour cette raison, il importe de distinguer l’étude de la capacité de donner à bail (A) de celle de la capacité de prendre à bail (B).
A.- La capacité de donner à bail
Division. Le bail de sa propre chose (1). Le bail de la chose d’autrui (2).
1.- Bail de sa propre chose
Par nature, le bail est un acte d’administration, c’est à dire un acte de gestion normale et courante du patrimoine. La loi n’exige donc de son auteur aucune autre condition que la capacité de contracter (art. 1145 c.civ. in limine). Rien d’étonnant : le bailleur n’aliène pas la chose donnée à bail. C’est très vrai pour peu que la chose soit un meuble. Car, toutes les fois qu’un immeuble est loué, le droit est autrement plus exigeant. Même chose en droit du bail commercial. Il y a une raison à cela dans le cas particulier : la protection du preneur (locataire) est telle que la capacité du bailleur, qui souhaiterait qu’on lui restitue la jouissance de la chose, est notablement restreinte. Partant, la capacité de contracter de ce dernier est plus strictement appréciée.
Si le bailleur dispose de sa pleine capacité juridique : aucune difficulté. Dans le cas contraire, il faut avoir à l’esprit que les pouvoirs de l’incapable sont limités voire réduits à la portion congrue si le majeur est placé sous tutelle (art. 473, al. 1, c.civ. ensemble art. 474 c.civ.). Par voie de conséquence, il s’agira de vérifier si le tuteur pouvait procéder seul ou bien s’il importait qu’il soit autorisé à contracter (par le conseil de famille ou le juge des tutelles). L’annexe du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle établit plusieurs listes d’actes regardés tantôt comme des actes d’administration tantôt comme des actes de disposition.
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020017088
2.- Bail de la chose d’autrui
Le bail accorde au preneur un droit contre la personne du bailleur (droit personnel), certainement pas sur la chose donnée à bail (droit réel). Dit autrement : l’engagement du bailleur est de procurer à son cocontractant la (seule) jouissance de la chose.
La question se pose de savoir si l’on peut donner à bail la chose d’autrui ? La réponse n’est pas négative comme on pourrait le penser en raisonnant par analogie sur le droit de la vente. Il faut bien dire que ce dernier droit prohibe la vente de la chose d’autrui (art. 1599 c.civ.). La raison est la suivante : personne ne peut transférer à un autre plus de droit qu’il n’en a lui-même (nemo plus juris ad transfere potest quam ipse habet). Or, force est de le redire : le preneur à bail (locataire) n’a en principe aucun droit sur la chose. Le bail de la chose d’autrui peut donc être pratiqué…pour peu que le propriétaire bailleur ratifie la promesse qui aura été faite. En bref, le bail de la chose d’autrui est une promesse de porte-fort (art. 1204 nouv. c.civ. / art. 1120 anc.). Soit le promettant obtient la ratification du propriétaire bailleur est tout se passe pour le mieux. Soit il ne l’obtient pas et des dommages et intérêts auront vocation à être payés (art. 1231-1 nouv. c.civ.). Car l’obligation de délivrance n’aura pas pu être exécutée. Et si le bénéficiaire de la promesse a été mis en possession, par anticipation en quelque sorte, alors le légitime propriétaire sera fondé à revendiquer sa chose et à agir en expulsion… Quant à savoir si cette dernière action aura vocation à prospérer, l’incertitude gagne vite : application de la théorie de l’apparence oblige (voy. art. “L’apparence”). Car il est admis que l’inopposabilité du bail au propriétaire véritable cède lorsque « le preneur a conclu le bail de bonne foi sous l’empire de l’erreur commune » (Civ. 1ère, 2 nov. 1959, Bull. civ. I, n° 448. Art. 1132 nouv. c.civ.). Et voilà que le bail consenti par le propriétaire apparent (ex. acheteur dont la vente est résolue ; héritier qui perd la qualité de successible du fait de la révélation de l’existence d’un héritier mieux placé, etc…) est inattaquable.
D’ordinaire, le droit discipline les faits. Ponctuellement, l’apparence et sa théorie sont une construction méthodologique qui offre au juge un guide sûr pour motiver des décisions qui font prévaloir le fait sur le droit ; l’apparence va alors exceptionnellement inhiber la norme (voy. l’article “L’apparence”). Fondée sur le respect dû à la bonne foi et aux légitimes prévisions des tiers, on peut se demander si cette solution n’est pas un peu rude pour le verus dominus, surtout lorsque le bail en cause octroie au preneur de larges prérogatives sur le bien – ex. bail rural ou commercial.
B.- La capacité de prendre à bail
Acte d’administration pur et dur.- À l’égard du preneur, le bail est un acte d’administration. Ici, les problèmes rencontrés dans la personne du bailleur ne se posent pas. Toute personne disposant de la capacité d’administrer peut prendre à bail.
Preneur en couple.- Il faut simplement noter que la loi prévoit des cas de cotitularité qui sont importants lors de la vie du bail.
Époux et partenaires liés par un pacte civil de solidarité : art. 1751 c.civ. : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un PACS ».
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d’un droit exclusif sur celui-ci sauf s’il y renonce expressément. »
Ceci oblige en pratique à donner congé à chacun des deux époux.
Conjoint exploitant : sans aller jusqu’à la cotitularité, certains statuts spéciaux imposent que le conjoint exploitant donne son accord à la résiliation, à la cession ou au renouvellement du bail à peine de nullité (art. L. 121-5 c.com. ; art. L. 411-68 c.rur.).
Héritiers.- Le bail passe aux héritiers en cas de décès du preneur (art. 1742 c.civ. : « le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ; loi 6 juill. 1989, art. 14).
Section 2.- Les conditions relatives au contenu du contrat
Plan.- Le bail est un contrat synallagmatique, ce qui signifie que bailleur et preneur ont des obligations réciproques dont l’objet de chacune est la cause de l’autre. Pourquoi le bailleur s’engage-t-il à faire jouir le preneur de la chose louée pendant un certain temps ? parce que le preneur s’engage en retour à payer un loyer. Et pourquoi le preneur s’engage-t-il à payer ce loyer ? parce que le bailleur s’est engagé à le faire jouir de la chose louée pendant un certain temps. Dès lors, l’objet des obligations nées du bail et leur cause peuvent être étudiées d’un bloc. À cet égard, il faudra distinguer les conditions relatives à la chose louée (A), les conditions relatives au loyer (B) et les conditions relatives à la durée du bail (C).
Mais avant cela, il faut mentionner une autre approche de la cause : la cause mobile (cause lointaine), que l’on oppose à la cause contrepartie (cause proche), et qui sert à évaluer la licéité du bail. Elle n’a cependant rien de particulier : le bail a une cause illicite si le but de l’une ou l’autre des parties est illicite (ex. bail en vue d’ouvrir une maison close ou de stocker de la drogue). Certes, la notion a été formellement effacée consécutivement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Mais, chassée par la porte, le législateur l’a faite rentrer par la fenêtre tout “en préservant (au passage) l’application prétorienne la plus novatrice des vingt dernières années” (voy. article 1170 nouv. c.civ.) (not. en ce sens, G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2ème éd., Dalloz, 2018, p. 380) et . C’est dire…Les articles 1162 et s. c.civ. (in sous-section 3. – Le contenu du contrat) l’attestent.
§1.- Conditions relatives à la chose louée
La chose louée.- Aux termes de l’article 1713 c.civ., toute sorte de chose, mobilière ou immobilière, peut faire l’objet d’un bail. Au delà, les conditions sont celles de l’objet du contrat : la chose doit être déterminée, possible et licite. Atténuation : on admet que les choses consomptibles au premier usage ne peuvent faire l’objet d’un bail (qualification de prêt de consommation).
La destination de la chose louée.- La destination de la chose louée est importante en pratique. Elle détermine contractuellement ce à quoi doit servir la chose (fixe les limites de l’usage du preneur) et doit être respectée par le preneur. Par ex., les baux d’habitation comportent assez souvent une clause d’habitation bourgeoise (au clause de destination), par laquelle le preneur s’engage à ne pas se servir des lieux loués pour exercer une activité commerciale ou libérale.
§2.- Conditions relatives au loyer
Nécessité absolue.- Le bail est un contrat à titre onéreux. La présence d’un loyer est donc absolument nécessaire pour que le bail reste un bail : pas de loyer, pas de bail (voy. art. “Le bail : définition, intérêt, variétés”). Comprenez bien : la jouissance temporaire d’une chose sans contrepartie exclut la qualification sous étude. Elle s’apparente au contrat de prêt à usage, qui est un contrat à titre gratuit (art. 1876 c.civ.). Le bailleur qui mettrait à disposition d’un commerçant un local sans percevoir de loyer échapperait au régime du bail, spécialement au statut des baux commerciaux (à noter que le juge, via la théorie de la fraude, pourrait être autorisé à déployer les effets de tel ou tel statut spécialement écrit par le législateur nonobstant l’absence formelle de stipulation d’un loyer…Et les parties d’être priées consécutivement de suivre toutes les prescriptions de la loi – i.e. obligation pour le preneur de payer un loyer).
Cette idée est simple. Elle n’épuise pourtant pas toutes les difficultés.
Nécessité d’un loyer déterminé ou déterminable ?.- On sait que depuis les arrêts d’Assemblée plénière de 1995 (Cass. Ass. plén., 1er déc. 1995, Bull. civ., n° 9), la détermination préalable et objective du prix n’est pas exigée à peine de nullité du contrat pour défaut d’objet (exit l’article 1129 anc. c.civ.). Le principe est en effet que la détermination prix n’est pas, en droit commun, car la loi peut en disposer autrement, une condition de validité du contrat. Les parties peuvent très bien le fixer en cours d’exécution ou une fois celle-ci achevée, voire même laisser à l’une seule d’entre elles le soin de fixer le prix quand elle le souhaite (art. 1165 nouv. c.civ.).
Mais on sait également que ce principe posé en 1995 réserve le cas de l’existence de textes légaux portant exception explicite à cette règle. L’archétype de ces textes est l’article 1591 c.civ., relatif à la vente.
En matière de bail, la question est de savoir s’il existe une disposition comparable. La question est assez difficile. La loi est ne le dit pas explicitement. Quant à la jurisprudence, elle donne à penser.
Si l’on cherche dans le Code civil, il y a bien un texte qui parle de prix. Définissant le bail, l’article 1709 dispose que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
La majorité de la doctrine moderne (car ni Mourlon, Répétition écrites sur le Code civil, t. 3, 1883 ni Planiol – Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 5ème éd., 1909 – ne s’interrogent) en déduit, s’appuyant sur les conclusions de l’avocat général Jéol (D. 1996. 13), que la loi relative au bail contient, comme celle relative à la vente, une exception au principe posé en 1995 : la détermination du loyer est une condition de validité du bail (v. en ce sens : F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux ; A. Bénabent, Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux ; P.-H. Antonmattei et J. Raynard et J.-B. Seube, Droit des contrats spéciaux).
Mais en toute honnêteté, l’article 1709 c.civ. ne dit pas explicitement que la détermination du loyer est exigée ad validitatem (comp. art. 1591 : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties »), ce qui fait dire à une autre partie de la doctrine qu’un bail peut être conclu sans que le loyer ne soit déterminé (Malaurie, Aynès, Gautier, Droit des contrats spéciaux) pour peu qu’il soit déterminable.
Quant à la jurisprudence, elle est peu claire. Certains arrêts semblent admettre qu’un prix n’est pas nécessaire, mais, à bien y regarder, il semble qu’ils soient en réalité relatifs à des contrats complexes mêlant bail et entreprise [il faut dire dès maintenant que la détermination du prix n’est pas nécessaire dans le contrat d’entreprise et qu’en la matière, le juge est autorisé dans certaines conditions à se substituer aux parties pour fixer le loyer lui-même] (v. surtout : Ass. plén. 1er déc. 1995 [4 arrêts], JCP. 1995. II. 22565, concl. Jéol, note Ghestin, JCP, éd. E, 1996. II. 776, note Leveneur, D. 1996. 13, concl. Jeol, note Aynès, Petites affiches 27 déc. 1995, no 155, p. 11, obs. Bureau et Molfessis). En matière de promesse synallagmatique de bail, la jurisprudence décide qu’une promesse de bail vaut bail dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix (Civ. 3e, 20 mai 1992, D. 1993. Somm. 68, obs. Martine ; 28 mai 1997, Bull. civ. III, n° 116), ce dont il semble bien se déduire qu’elle considère, dans ce cas, le loyer comme un élément essentiel du bail.
Quelques vieux arrêts semblaient autoriser le juge à fixer lui-même le loyer en cas de défaillance des parties, ce qui va dans le sens de la position inverse (Civ., 14 nov. 1892, DP 1893. 1. 11 ; Civ. 3ème, 3 octobre 1968, RTD civ. 1969. 351, obs. Cornu). Mais des arrêts plus récents excluent résolument cette possibilité (Cass. 3e civ. 10 déc. 1975, Bull. civ. III, no 369 ; 8 févr. 2006, no 05-10.724, ibid. III, no 25). Le juge ne peut pas substituer à la commune intention des parties, qu’il doit rechercher, sa propre détermination (art. 1716 c.civ.).
Que penser de tout ceci ? Peut être qu’il serait plus opportun que la détermination du loyer soit une condition de validité du bail. On peut penser en effet que la solution de principe posée en 1995 ne se justifie véritablement que lorsqu’il est difficile pour les parties d’évaluer à l’avance la prestation à fournir (ex. de l’avocat à qui on soumet un dossier : comment pourrait-il savoir à l’avance combien d’heures il va passer dessus ?). Mais en matière de bail, la chose objet du contrat est connue dès sa formation. Les parties devraient donc déterminer dès à présent, et à peine d’un contentieux insurmontable, leurs obligations respectives.
On peut s’interroger pour finir sur la portée exacte du débat. Car une équivoque existe sur la sanction de l’absence de détermination du loyer :
– certaines décisions retiennent la nullité du bail (Cass. 3ème civ., 13 juillet 1994, Bull. civ. III, n° 144)
– d’autres optent pour une simple disqualification du contrat (Cass. soc., 16 juin 1951, RTD civ. 1952. 239, obs. Carbonnier ; commodat). Souvent juge varie, bien fol qui s’y fit ?
Liberté de principe quant à la fixation.- La fixation du loyer est en principe libre, mais les statuts spéciaux dérogent largement à cette liberté. C’est le cas en droit civil du bail d’habitation et à usage mixte (loi 6 juill. 1989, art. 17), en droit commercial ou encore en droit rural (art. L. 411-11, al. 3 c.rur. : les loyers sont fixés en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative).
En argent ou en nature ?.- En principe le loyer est en argent (car le loyer est un prix et qu’un prix s’entend normalement d’une somme d’argent contre laquelle s’échange un bien ou un service). Mais renvoi : on a vu que dans certains cas, et à condition que la prestation en nature ne soit pas la majeure partie du loyer, une partie du loyer peut être stipulée en nature. Ex. clause travaux ou de soins.
Indexation.- Les parties peuvent prévoir d’indexer le loyer pour lutter contre l’inflation monétaire. En droit commun, l’indexation est licite pourvu que l’indice choisi soit lié à l’objet du contrat ou à l’activité de l’une des parties (voy. art. 1167 nouv. c.civ.). Les statuts spéciaux imposent parfois l’indice (loi 6 juill. 1989, art. 17, d : Indice de Référence des Loyers publié par l’INSEE chaque trimestre).
§3.- Conditions relatives à la durée
Impérativité de la durée.- Le bail est un contrat à exécution successive (voy. pour la définition art. 1111-1, al. 2, nouv. c.civ.). Le bailleur s’oblige ainsi à faire jouir le preneur de la chose « pendant un certain temps », dit l’article 1709 c.civ. C’est une mise à disposition temporaire des utilités de la chose. Ce temps de jouissance fait partie de l’objet du contrat : ce que l’on vise, c’est l’interdiction faite au bailleur de reprendre sa chose ad nutum, c’est-à-dire à première demande (cmp. avec le déposant, qui lui le peut. art. 1944 in limine c.civ. : « le dépôt doit remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution (…) »). Dans ces conditions, il n’est pas possible que le contrat se forme à défaut d’accord des parties sur la durée du bail (Cass. 3ème civ., 5 déc. 2001, AJDI 2002. 129, obs. Dumont). Mais la durée doit être distinguée de la prise d’effets : la jurisprudence a décidé, à juste titre, que la date de prise d’effets n’était pas un élément essentiel (Cass. 3ème civ., 28 oct. 2009, Bull. civ. III, n° 237).
Détermination ou indétermination de la durée.- À partir de là, la volonté des parties est libre ; bailleur et preneur à bail peuvent convenir un terme ou n’en stipulé aucun. Dans ce second cas de figure, il importera à l’une quelconque des parties de mettre fin au contrat en adressant à l’autre un congé – prohibition des engagements perpétuels ou pactes conclus ad vitam aeternam i.e. au-delà de 99 ans par hypothèse puisque le bail emphytéotique est admis –, qui prendra effet dans le respect des délais fixés par l’usage des lieux (prohibition prescrite à l’article 1210 nouv. c.civ.).
Ces règles ne valent qu’autant qu’un statut spécial impératif n’en dispose pas autrement. Or, à l’expérience, nombre de statuts spéciaux de baux immobiliers contraignent les parties à l’observance d’une durée impérative. On justifie classiquement cet encadrement de la liberté contractuelle par la nécessité impérieuse de garantir une stabilité au locataire. Le droit de la reconduction comme le droit de préemption y participent grandement. Le bail d’habitation est nécessairement conclu au minimum pour 3 ans, voire 6 années si le bailleur est une personne morale (loi 6 juill. 1989, art. 10 s.). Les baux commercial et rural sont conclus pour une durée de 9 ans (c.com., art. L. 145-4 ; c.rur. art. L. 411-5). C’est d’ordre public de protection dont il est question. Aussi bien les parties sont-elles libres d’améliorer encore la stabilité du preneur en stipulant une durée plus grande que celle prescrite a minima par le législateur.
Ces cas mis à part, les parties peuvent très bien se mettre d’accord pour une durée déterminée (terme extinctif) ou indéterminée. Il est à noter au passage que le Code civil (art. 1736 et 1737) assimile, de façon discutable, les baux verbaux, qu’il nomme baux sans écrit (C.civ., art. 1736), à des baux à durée indéterminée et les baux écrits à des baux à durée déterminée. Ces affirmations sont douteuses.
Dans le premier cas, l’on justifie ordinairement l’assimilation de la façon suivante : si les parties avaient voulu pratiquer un terme extinctif, elles n’auraient pas manqué de le consigner par écrit (C.civ., art. 1736 et 1774). C’est peu dirimant. Au reste, le texte n’interdit pas de penser qu’un bail, quand même serait-il verbal, ait été prévu pour une certaine durée. Simplement, considérant que la preuve de la volonté des parties risque fort d’être diabolique, le législateur semble avoir recommandé que soient observés les délais fixés par l’usage des lieux. C’est de congé dont il s’agit. À défaut de durée conventionnelle, le contrat est indéterminé dans le temps ; on peut y mettre fin à tout moment pour peu que les circonstances de la résiliation ne soient pas dommageables, pour peu, en somme, qu’on observât les délais fixés par l’usage des lieux. La jurisprudence ne l’entend toutefois pas ainsi. Elle interprète l’article 1736 c.civ. comme s’il définissait la durée même du bail fait sans écrit. C’est quand même faire peu de cas de ce que les parties ont pu vouloir même verbalement. Il n’est pas impossible que les parties se soient entendues. Remplacer la durée négociée par celle prévue par les usages, c’est trahir leur intention. Un preneur à bail a bien tenté de produire en justice une lettre du bailleur lui ayant offert de renouveler le contrat pour la même période que le bail échu, mais rien n’y fait. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué…
Dans le second cas, les parties à un bail écrit ont très bien pu stipuler que la durée du contrat serait indéterminée, ou ne rien stipuler du tout. En la matière, l’effet produit est le même.
Baux perpétuels.- La seule véritable contrainte qui pèse sur les parties réside dans la prohibition des baux perpétuels, qui se déduit de l’art. 1709 c.civ., qui précise que le bailleur fait jouir « pendant un certain temps ». L’interdiction est fortement teintée d’anti-féodalisme. De tels baux étaient fréquents dans l’Ancien droit sous lequel on distinguait ordinairement le domaine éminent et le domaine utile. Le droit intermédiaire et le Code civil les ont prohibés. Pour mémoire, le seigneur concédait le « domaine utile », c’est-à-dire la faculté d’user du bien avec toutes les prérogatives aujourd’hui attachées au droit de propriété, y compris la faculté de l’aliéner ; il gardait en revanche le « domaine éminent », au nom duquel il percevait sur ces terres un certain nombre de redevances.
Le domaine de la prohibition doit être précisé.
Les baux à durée indéterminée ne sont pas concernés, puisque chacune des parties dispose d’une faculté de résiliation unilatérale qui lui permet de sortir du contrat lorsqu’elle le souhaite. L’article 1736 c.civ. précise en la matière que le congé ainsi adressé prendra effet dans le respect des « délais fixés par l’usage des lieux ».
Seuls les baux à durée déterminée sont en réalité visés. Le principe du respect du terme dans les contrats à durée déterminée permet en théorie que chaque partie reste engagée éternellement. C’est loin d’être un cas d’école. Les législations spéciales n’organisent-elles pas la reconduction du terme ou le renouvellement du contrat, et ce tant à l’égard du preneur à bail qu’à celui de ses héritiers ? En pratique, le bail peut tendre à s’exécuter perpétuellement. Ce qui est interdit, c’est de convenir de la perpétuité, qui est une interdiction sanctionnée par une nullité d’ordre public du bail, qui prive le juge d’un quelconque pouvoir d’appréciation et le contraint à la prononcer (Cass. civ., 20 mars 1929, DP 1930. 1. 13 ; Civ. 3e, 15 déc. 1999, JCP 2000. II. 10236, concl. Weber : pour une espèce désopilante dans laquelle l’action en nullité était prescrite, le bail étant conclu pour 99 ans et renouvelable au gré du preneur… [imprescriptibilité de l’exception de nullité… sauf si commencement d’exécution]). Au-delà, on peut hésiter : le bail est perpétuel si sa durée est supérieure à celle de la vie du preneur… mais on admet que certains baux (ex. bail à construction) soient conclus pour 99 ans.