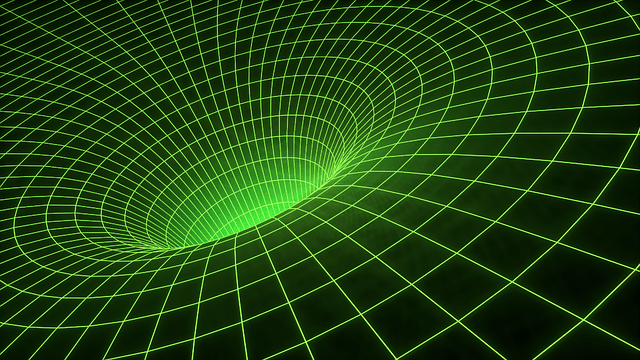Pour mémoire, l’article 1240 du Code civil dispose que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Au regard de cette disposition, le dommage apparaît comme la première condition de mise en œuvre de la responsabilité civile.
?Dommage ou préjudice ?
À titre de remarque liminaire, il peut être observé que l’utilisation du terme dommage ou de préjudice est indifférente. La plupart des auteurs les tiennent pour synonymes.
Pour certains, il convient néanmoins de les distinguer en ce que :
- Le dommage serait le fait brut originaire de la lésion affectant la victime
- Le préjudice constituerait, quant à lui, la conséquence de cette lésion
?Pas de responsabilité sans dommage
À la différence de la responsabilité pénale, la responsabilité civile ne se conçoit pas, du moins en principe, en dehors de l’existence d’un dommage, même si celui-ci est particulièrement difficile à évaluer et si sa réparation laisse, le cas échéant, au juge une très grande latitude pour éventuellement sanctionner un comportement qu’il juge répréhensible.
Manifestement, si toute réparation requiert la caractérisation d’un dommage, tous les dommages ne sont pas nécessairement réparables.
Aussi, afin de déterminer si l’auteur d’un fait illicite engage sa responsabilité civile, il conviendra toujours de se demander, avant l’examen de toute autre condition, si le préjudice occasionné à la victime est réparable.
?Qu’est-ce qu’un préjudice réparable ?
Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne définissent vraiment ce qu’est un dommage réparable. À la vérité le dommage est moins défini qu’il n’est décrit.
Dès lors, afin de savoir si un dommage est ou non réparable, cela suppose de se demander s’il répond aux critères posés par la jurisprudence.
Pour être réparable, un dommage doit, en effet, présenter un certain nombre de caractères (I), ce qui a conduit la jurisprudence à reconnaître, par une appréciation parfois audacieuse desdits caractères, de nombreuses variétés de dommages.
I) Les caractères du dommage
Classiquement on enseigne que, pour être réparable, le dommage doit être :
- Personnel
- Direct
- Actuel
- Certain
- Licite
Bien que reprise dans de nombreux manuels de droit, cette pentalogie est moins pertinente qu’il y paraît.
- En premier lieu, si l’on exige que le dommage soit direct, cela signifie qu’un lien de causalité doit exister entre le fait générateur de responsabilité et le dommage.
- Or cette question du caractère direct du dommage relève plus de la problématique relative au lien de causalité que du dommage en lui-même.
- En second lieu, si l’on exige que le dommage soit actuel, on saurait toutefois en déduire que le juge n’aurait pas le droit de se projeter dans l’avenir pour évaluer le préjudice ou qu’il ne peut faire état que de certitudes absolues.
- En effet, pour être réparable il faut une probabilité suffisante quant à la réalisation du préjudice.
- Aussi, cela renvoie-t-il à l’exigence de certitude du préjudice, de sorte que celui-ci doit moins être actuel que certain.
- En ce sens, un préjudice futur peut parfaitement être réparable
- Si sa réalisation est certains
- Si son évaluation est possible
On peut donc estimer que, pour être réparable, un préjudice doit, en réalité, présenter non pas 5 caractères, mais trois. Il doit être :
A) Le caractère certain du dommage
Pour être réparable, le préjudice subi par la victime doit être certain.
?Notion de dommage certain
Si l’on se reporte à la définition du dictionnaire, est certain ce qui ne fait pas de doute, ce qui est conforme aux critères de la vérité.
Ainsi, le dommage est certain lorsqu’il est établi et avéré.
Le dommage certain s’oppose, en ce sens, au préjudice éventuel, soit le préjudice dont on ne sait pas s’il se produira.
?Exceptions à l’exigence de certitude du dommage
Il peut être observé que l’exigence de certitude du dommage est écartée, partiellement voire totalement dans trois hypothèses :
- En matière d’atteinte au droit à la vie privée
- La Cour de cassation a estimé que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996, n°94-14.798).
- Ainsi, n’est-il pas nécessaire de justifier d’un dommage pour obtenir réparation sur le fondement de l’article 9 du Code civil.
- La seule violation du droit à la vie privée suffit à engager la responsabilité de l’auteur de la violation.
- En matière de troubles anormaux du voisinage
- Comme en matière d’atteinte à la vie privée, les troubles anormaux de voisinage constituent une source autonome de la responsabilité, en ce sens qu’elle est détachée de l’article 1240 du Code civil, soit de toute idée de faute.
- Aussi, cela signifie-t-il que cette responsabilité repose sur le seul constat de l’anormalité du trouble causé à la victime (V. en ce sens Cass. 3e civ., 21 juill. 1999, n°96-22.735).
- En matière de concurrence déloyale
- Dans l’hypothèse d’une action en concurrence déloyale diligentée par la victime, si l’existence d’un dommage certain est exigée, celui-ci est présumé dès lors qu’un comportement fautif est établi (Cass. com., 9 févr. 1983, n°91-12.258)
- Ainsi, en pareille situation, revient-il à l’auteur du dommage que l’action dirigée contre lui est infondée.
?L’étendue de la notion de certitude du dommage
Par certitude du dommage il faut entendre que le dommage s’est réalisé :
- Soit parce que la victime a éprouvé une perte
- Soit parce que la victime a manqué un gain
On peut ajouter, qu’il est indifférent que la victime ait ou non conscience de son dommage.
1. La victime a éprouvé une perte
La perte éprouvée par la victime peut être :
- Soit actuelle
- Soit future
a. Le préjudice actuel
Le dommage actuel est celui qui s’est déjà réalisé.
Aussi, la Cour de cassation estime-t-elle dans cette hypothèse que « le droit pour la victime d’un accident d’obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé ».
Ainsi, pour la haute juridiction le fait générateur de la créance de réparation se confond avec la date de réalisation du dommage (Cass. 2e civ., 21 mars 1983, n°82-10.770)
À la vérité, lorsque le dommage est déjà survenu, cette situation ne soulève guère de difficulté s’agissant de l’indemnisation de la victime.
Mais quid lorsque le dommage ne s’est pas encore réalisé ? Peut-on réparer un préjudice futur ?
b. Le préjudice futur
?Préjudice futur et préjudice actuel
Contrairement à une idée reçue, le préjudice futur ne s’oppose pas au préjudice actuel en ce qu’il ne serait pas réparable.
Ces deux sortes de préjudice s’opposent uniquement en raison de leur date de survenance.
Au vrai, dès lors que le préjudice futur et le préjudice actuel présentent un caractère certain, tous deux sont réparables.
?Préjudice futur et préjudice éventuel
En matière de responsabilité, le préjudice futur s’oppose, en réalité, au préjudice éventuel dont la réalisation n’est pas certaine.
Dès lors que l’éventualité du préjudice « ne s’est pas transformée en certitude », pour reprendre une expression de François Terré, le préjudice n’est pas réparable, contrairement au préjudice futur dont la réalisation est certaine.
?Le préjudice futur certain
Ce qui importe c’est donc que le préjudice futur soit certain pour être réparable.
La Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer ce principe en jugeant, dès 1932 que « s’il n’est pas possible d’allouer des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice purement éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît aux juges du fait comme la prolongation certaine et directe d’un état de choses actuel et comme étant susceptible d’estimation immédiate » (Cass. crim., 1er juin 1932).
Exemples :
- Dans un arrêt du 13 mars 1967, la Cour de cassation a estimé que la victime d’un accident de la circulation était fondée à obtenir réparation du préjudice futur occasionné par l’ablation de la rate, laquelle est de nature à raccourcir son espérance de vie (Cass. 2e civ., 13 mars 1967).
- Dans un arrêt du 3 mars 1993, la Cour de cassation a jugé que « des propriétaires d’immeubles justifiaient d’un préjudice certain du fait de la présence d’une ancienne carrière de calcaire asphaltique et du classement, à la suite d’effondrements du sol, comme zone de risque d’une partie du territoire de la commune, dès lors qu’elle relève que les tassements de sol se poursuivront de façon lente et irrégulière, avec parfois une accélération brutale, imprévisible et dangereuse, et que le sous-sol étant “déconsolidé” d’une manière irréversible, les immeubles seront soumis à plus ou moins brève échéance à de graves désordres voire à un effondrement qui les rendra inhabitables » (Cass. 2e civ., 3 mars 1993, n°91-17.200).
?L’aggravation du dommage
- Principe
- En cas d’aggravation du dommage, la Cour de cassation considère qu’il est toujours possible pour la victime d’engager une nouvelle action en réparation.
- Fondement
- L’idée sur laquelle s’appuie la Cour de cassation consiste à dire que « les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ».
- Autrement dit, c’est le principe de réparation intégrale qui préside à l’action en responsabilité, de sorte que tant que tous les préjudices, mêmes futurs, dès lors qu’ils sont certains doivent être réparés.
- Illustration
- Dans un arrêt du 19 février 2004, la Cour de cassation a ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas accédé à la demande en réparation formulée par une victime, suite à l’aggravation de son préjudice « alors que le préjudice dont Mme X… demandait réparation était constitué par l’augmentation, en raison de la présence de ses deux enfants, de l’aide-ménagère dont l’indemnisation lui avait été précédemment accordée à titre personnel en raison de son handicap, et que ce préjudice économique nouveau, indépendant de l’évolution de l’état séquellaire de la victime, n’avait pas été pris en compte par le jugement, antérieur à la naissance des enfants» (Cass. 2e Civ. 19 févr. 2004, n°02-17.954).
- Condition
- Une nouvelle action en réparation suppose néanmoins, nous dit la Cour de cassation « qu’une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés » (Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-30.086).
2. La victime a manqué un gain
Le dommage réparable ne consiste pas toujours en une perte pour la victime ; il peut également s’agir d’un manque à gagner.
La Cour de cassation qualifie ce manque à gagner, lorsqu’il est réparable, de perte d’une chance.
- Reconnaissance de la perte d’une chance comme préjudice réparable
- Dans un arrêt fondateur du 17 juillet 1989 la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, le caractère réparable de la perte de chance.
- En l’espèce, le client d’un huissier de justice est privé de la possibilité de faire appel d’un jugement et, par voie de conséquence, de gagner son procès en raison de la faute commise par l’officier ministériel, laquelle faute a entraîné la nullité de l’acte portant déclaration d’appel.
- La Cour de cassation reconnaît au client de l’étude un droit à réparation, sur le fondement de la perte de chance (Cass. req., 17 juill. 1889)
- Depuis lors, la Cour de cassation reconnaît de façon constante à la perte de chance le caractère de préjudice réparable (V. en ce sens Cass. 1re civ., 27 janv. 1970, n°68-12.782 ; Cass. 2e civ., 7 févr. 1996, n°94-12.965 ; Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n°12-14.439)
- Définition
- La Cour de cassation définit la perte de chance comme « la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que ; par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 18 mars 1975, n°74-92.118).
- Dans un arrêt du 4 décembre 1996, la Cour de cassation a sensiblement rectifié sa définition de la perte de chance en jugeant que « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de l’infraction, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 4 déc. 1996, n°96-81.163).
- Conditions
- Il ressort des définitions retenues par la Cour de cassation de la perte de chance que pour être réparable, elle doit satisfaire à plusieurs conditions :
- L’éventualité favorable doit exister
- Autrement dit, la victime doit avoir été en position de chance, position dont elle a été privée en raison de la production du fait dommageable.
- Exemple : la Cour de cassation a-t-elle refusé d’indemniser un ouvrier boulanger, victime d’un accident le privant de la possibilité d’ouvrir sa propre boulangerie, dans la mesure où il n’avait effectué aucune démarche en ce sens (Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n°96-11.816)
- Le critère utilisé par la Cour de cassation afin de déterminer si l’éventualité existe est, le plus souvent, le bref délai.
- Moins l’éventualité favorable espérée par la victime se réalisera à brève échéance et plus le juge sera réticent à reconnaître la perte de chance.
- La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle
- Autrement dit, la perte de chance ne doit pas être hypothétique.
- La disparition de l’événement favorable doit être acquise, certaine.
- En somme, la condition qui tient au caractère réel de la perte de chance n’est autre que la traduction de l’exigence d’un préjudice certain
- La victime ne doit pas avoir la possibilité de voir se représenter l’éventualité favorable espérée.
- En somme, la disparition de cette éventualité doit être irréversible.
- Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que le candidat qui a perdu la chance de se présenter à un concours ne peut obtenir réparation de son préjudice, dès lors qu’il a la possibilité de s’inscrire une nouvelle fois audit concours (Cass. 2e civ., 24 juin 1999, n°97-13.408).
- La chance perdue doit être sérieuse
- Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise (V. en ce sens Cass. 1er civ. 4 avr. 2001, n°98-23.157).
- On peut ainsi douter du caractère sérieux de la chance d’un étudiant de réussir un concours, s’il n’a pas été assidu en cours et s’il ne s’est livré à aucune révision.
- On peut également douter du sérieux de la chance d’un justiciable de gagner un procès, dans l’hypothèse où il ne dispose d’aucune preuve de ce qu’il avance.
- Présomption du préjudice
- Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de cassation a posé une présomption de certitude de la perte de chance, « chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable » (Cass. 1ère civ. 14 oct. 2010, n°09-69.195).
- Autrement dit, la haute juridiction estime que le préjudice est certain, et donc réparable, dès lors qu’est établie la disparition du gain espéré par la victime.
- Il s’agit d’une présomption simple, qui donc supporte la preuve du contraire.
- Réparation de la perte d’une chance
- Dans la mesure où la réalisation de l’événement favorable n’est, par définition, pas certaine, l’indemnité allouée à la victime ne saurait égaler le gain espéré.
- Ainsi, le montant de la réparation du préjudice sera-t-il toujours proportionnel à la probabilité que l’événement se réalise (Cass. 1ère civ., 27 mars 1973, n°71-14.587).
- Le juge devra donc toujours prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice.
- Est-ce à dire qu’il s’agit là d’une entorse au principe de réparation intégrale ?
- La réponse est non
- Deux choses doivent être distinguées :
- La disparition de l’événement favorable
- La réalisation de l’événement favorable
- Dans la mesure où seule la disparition de l’événement favorable est certaine, sa réalisation étant hypothétique, seul ce fait dommageable pourra donner lieu à réparation.
- Contrôle exercé par la Cour de cassation
- L’évaluation de la perte de chance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond
- La Cour de cassation ne contrôlera que la prise en compte de l’aléa dans l’indemnisation.
- Elle rappelle en ce sens régulièrement que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1er civ., 9 avr. 2002, n°00-13.314).
3. L’indifférence de l’état d’inconscience dans lequel se trouve la victime
Est-il nécessaire que la victime ait conscience de son dommage pour celui-ci puisse faire l’objet d’une indemnisation ?
Telle est la question qui s’est posée dans un arrêt rendu le 22 février 1995 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 22 févr. 1995, n°92-18.731).
|
Cass. 2e civ., 22 févr. 1995
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’auteur d’un délit ou d’un quasi-délit est tenu à la réparation intégrale du dommage qu’il a causé ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Annick X… qui circulait à bicyclette a été heurtée et blessée par l’automobile de M. Y…, que Mlle Catherine X… agissant tant en son nom qu’en celui de Mme Annick X… sa mère, a assigné M. Y… et son assureur, la compagnie Norwich Union, la caisse primaire d’assurance maladie d’Elbeuf et la société Transport agglomération Elbeuvienne en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour exclure Mme X… de la réparation de son préjudice personnel l’arrêt relève que, selon l’expert, la victime, réduite à l’état végétatif, n’est absolument pas apte à ressentir quoi que ce soit qu’il s’agisse d’une douleur, d’un sentiment de diminution du fait d’une disgrâce esthétique ou d’un phénomène de frustration des plaisirs comme des soucis de l’existence ; que la cour d’appel en déduit qu’il n’existe pas la preuve d’un préjudice certain ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice personnel de Mme X…, l’arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
|
La Cour de cassation répond, dans cet arrêt, sans ambiguïté à la question posée : « l’état végétatif d’une personne humaine n’excluant aucun chef d’indemnisation son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments »
Ainsi, la deuxième chambre civile se rallie-t-elle à la position de la chambre criminelle qui, dès 1978, avait estimé que « l’indemnisation d’un dommage n’est pas fonction de la représentation que s’en fait la victime, mais de sa constatation par le juge et de son évaluation objective » (Cass. crim., 3 avr. 1978).
Le préjudice doit ainsi être appréhendé de façon objective, sans considération de la capacité de la victime à se représenter son propre dommage.
B) Le caractère personnel du dommage
?Notion
- En plus de devoir remplir la condition de certitude pour être réparable, le préjudice doit être personnel.
- Par personnel, il faut entendre que, seule la victime qui a souffert du fait dommageable, est fondée à agir en responsabilité.
- A contrario, cela signifie que l’on ne saurait agir en responsabilité, en vue être indemnisé pour le préjudice subi par un tiers
?Fondement
- L’exigence du caractère personnel du préjudice est formulée à l’article 31 du Code de procédure civile
- Cette disposition prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
- L’intérêt à agir ne peut se comprendre en matière de responsabilité, que si l’on a personnellement souffert du dommage.
?Préjudice immédiat/médiat
- Une distinction est faite en jurisprudence et en doctrine entre le préjudice immédiat et le préjudice médiat
- Le préjudice est immédiat lorsque, selon Ph. Malinvaud, « il atteint la victime dans sa personne ou dans ses biens, sans intermédiaire »
- Exemple : le motard victime d’un accident de la circulation
- Le préjudice est médiat lorsque, à l’inverse, il « est la conséquence d’un préjudice immédiat frappant une première personne » (Ph. Malinvaud).
- On parle plus couramment, dans cette hypothèse, de préjudice par ricochet.
- Exemple : l’épouse du motard victime d’un accident de la circulation
- Son préjudice ne sera, certes, pas d’ordre matériel.
- Elle pourra néanmoins faire état d’un préjudice moral.
- Au total, il peut être observé que, si le préjudice immédiat et médiat se distinguent sur le plan notionnel, ils se rejoignent néanmoins en ce que, pour être réparables, la victime doit, dans les deux cas, justifier d’un préjudice personnel.
- Le caractère médiat du préjudice ne fait ainsi nullement obstacle à sa réparation, dès lors que la victime est en mesure d’établir qu’elle souffre personnellement du dommage.
?Le préjudice par ricochet
- Notion
- Le préjudice par ricochet ou médiat, n’est autre que la conséquence du préjudice subi par la victime immédiate.
- Autrement dit, il s’agit du préjudice causé aux proches de la victime
- Le préjudice par ricochet suppose donc, pour être réparable, l’existence d’une victime immédiate, à défaut de quoi l’on sort du cadre du préjudice par ricochet.
- Reconnaissance du préjudice par ricochet
- Très tôt la Cour de cassation a estimé que le préjudice par ricochet pouvait faire l’objet d’une réparation.
- Dans un arrêt du 20 février 1863, elle a ainsi jugé que « l’article 1382, en ordonnant en termes absolus la réparation de tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, ne limite en rien la nature du fait dommageable, ni la nature du lien qui doit unir, en cas de décès, la victime du fait avec celui de ses ayants droit qui en demanderait réparation » (Cass. crim., 20 févr. 1863).
- On devine que la Cour de cassation fonde, en l’espèce, sa décision sur l’adage ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus : là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer.
- Autrement dit, pour la Cour de cassation, l’article 1382 n’opère aucune distinction entre les victimes.
- Il en résulte que dès lors qu’elles sont en mesure de justifier d’un préjudice certain et personnel, leur dommage doit être réparé.
- Malgré la grande libéralité dont a fait preuve la Cour de cassation dans cette décision, elle n’en a pas moins subordonné, par la suite, la réparation du préjudice par ricochet à un certain nombre de conditions.
- Ces conditions se sont tantôt durcies, tantôt assouplies au fil du temps.
- Conditions
- L’exigence d’une victime immédiate
- Pour obtenir réparation de son préjudice par ricochet, la victime médiate doit être en mesure de démontrer l’existence d’une victime immédiate
- À défaut, on ne saurait parler de préjudice par ricochet, dans la mesure où il serait privé de sa cause : le préjudice immédiat
- Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle validé la décision d’une Cour d’appel ayant jugé qu’une société « était sans droit à invoquer le préjudice par ricochet qui aurait résulté pour elle d’un abus de dépendance économique dont [une autre société] n’a pas été reconnue victime par cette sentence, a statué à bon droit » (Cass. com., 7 janv. 2004, n°02-11.014).
- Un préjudice certain et personnel
- Pour être réparable, le préjudice par ricochet doit présenter les mêmes attributs que le préjudice immédiat.
- Autrement dit, il doit être certain et personnel
- Il peut être observé que le préjudice par ricochet est autonome, en ce sens qu’il ne constitue pas le reflet du préjudice immédiat.
- Tandis que le préjudice immédiat sera, le plus souvent, d’ordre corporel ou matériel, le préjudice par ricochet sera moral.
- Le seul lien qui lie le préjudice par ricochet au préjudice immédiat n’est autre que la personne par l’entreprise de laquelle il s’est produit.
- L’exigence d’un lien de droit
- Après avoir estimé en 1863 qu’il n’était pas nécessaire que la victime immédiate et la victime médiate soit unies par un lien de droit pour que le préjudice par ricochet soit réparable, la chambre criminelle a radicalement changé de position dans un arrêt du 13 février 1937 (Cass. crim. 13 févr. 1937). La chambre civile s’est ralliée à cette solution dans un arrêt du 28 juillet 1937 (Cass. civ. 28 juill. 1937).
- Dans cette dernière décision, la Cour de cassation a jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé ».
- L’adoption de cette position par la Cour de cassation a conduit les juges du fond à débouter systématiquement les victimes par ricochet de leur demande de réparation, dès lors qu’elle ne justifiait pas d’un lien droit (filiation, mariage) avec la victime immédiate.
- L’abandon de l’exigence du lien de droit : l’arrêt Dangereux
- La position adoptée par la Cour de cassation en 1937 a finalement été abandonnée dans un célèbre arrêt Dangereux rendu en date du 27 février 1970 par la chambre mixte (Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970, n°68-10.276).
- Dans cet arrêt, la Cour de cassation censure la Cour d’appel qui avait débouté une demanderesse de son action en réparation du préjudice subi suite au décès de son concubin.
- La haute juridiction rompt avec la jurisprudence antérieure en jugeant que, « en subordonnant ainsi l’application de l’article 1382 à une condition qu’il ne contient pas, la Cour d’appel a violé le texte susvisé ».
- Dorénavant, il n’est donc plus nécessaire pour la victime par ricochet de justifier d’un lien de droit avec la victime immédiate afin d’obtenir réparation de son préjudice.
- La restriction posée par l’arrêt Dangereux
- La Cour de cassation a, certes, dans l’arrêt Dangereux abandonné l’exigence du lien droit entre la victime immédiate et la victime médiate.
- Elle a néanmoins subordonné la réparation du préjudice par ricochet subi par la concubine à deux conditions :
- Le concubinage doit être stable
- Le concubinage ne doit pas être délictueux
- Ainsi, au regard de l’arrêt Dangereux, si la concubine avait entretenu une relation adultère avec la victime immédiate, le caractère délictueux de cette relation aurait fait obstacle à la réparation de son préjudice
- L’assouplissement de la jurisprudence Dangereux
- La Cour de cassation a très vite infléchi sa position en jugeant que l’existence d’une relation adultère entre la victime immédiate et la victime médiate ne faisait pas obstacle à la réparation du préjudice par ricochet (Cass. crim. 20 avr. 1972, n°71-91.750).
- Le cas particulier de la victime par ricochet d’un accident de la circulation
- La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit en son article 6 que « le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. »
- Cela signifie, autrement dit, que si la victime immédiate d’un accident de la circulation est fautive, la victime par ricochet pourra voir son indemnisation limitée dans les mêmes proportions que la victime immédiate.
- Ainsi, dans l’hypothèse où une cause d’exonération serait opposable à cette dernière, elle le serait aussi à la victime par ricochet.
C) La licéité de l’intérêt lésé
Il ne suffit pas que le préjudice soit certain et personnel pour être réparable, encore faut-il que l’intérêt lésé soit licite.
?Évolution de la condition de licéité
L’exigence de licéité du préjudice est une condition qui a manifestement évolué dans le temps.
- L’exigence d’un intérêt légitime juridiquement protégé
- Pour mémoire, dans l’arrêt du 28 juillet 1937 précité, la Cour de cassation avait jugé que « le demandeur d’une indemnité délictuelle ou quasi délictuelle doit justifier, non d’un dommage quelconque, mais de la lésion certaine d’un intérêt légitime juridiquement protégé » (Cass. civ. 28 juill. 1937).
- Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle d’abord fait référence à « l’intérêt légitime juridiquement protégé ».
- Pendant, longtemps la haute juridiction s’est abritée derrière cette formule notamment afin de refuser à la concubine d’une victime la réparation de son préjudice par ricochet.
- L’arrêt Dangereux a, certes, mis un terme à cette jurisprudence. La condition tenant à l’intérêt légitime juridiquement protégé n’a pas pour autant disparu, bien que plusieurs arrêts nous incitent à le penser :
- Dans un arrêt du 19 février 1992, la Cour de cassation a, par exemple, estimé qu’un voyeur sans titre de transport était fondé à agir en responsabilité, les juges du fond n’établissant pas, selon elle, « l’illégitimité de l’intérêt [de la victime] à demander réparation de son dommage » (Cass. 2e civ., 19 févr. 1992, n°90-19.237).
- Dans un arrêt du 7 juillet 1993, une prostituée victime d’un accident sur son lieu de travail a également été entendue par la Cour de cassation, laquelle a estimé que le préjudice subi par la victime ne revêtait aucun caractère illégitime (Cass. 2e civ., 7 juill. 1993, n°92-10.447).
- On peut encore signaler un arrêt du 2 février 1994 dans lequel la Cour de cassation a fait droit à la demande d’une victime qui se livrait à un commerce de stupéfiants (Cass. 2e civ., 2 févr. 1994, n°92-14.005).
- Au regard de ces arrêts, tout porte à croire que la condition de légitimité a bel et bien été abandonnée par la Cour de cassation, ce qui a conduit certains auteurs à s’interroger.
- Cependant, plusieurs autres décisions ont jeté le trouble sur cette analyse.
- En témoigne un arrêt du 30 novembre 1999 par lequel la Cour de cassation valide la décision d’une Cour d’appel qui avait débouté une victime de sa demande d’indemnisation, au motif qu’elle avait été convaincue du délit d’escroquerie (Cass. com., 30 nov. 1999, n°97-15.978).
- À la vérité, la condition tenant à la légitimité du préjudice n’a jamais totalement été abandonnée par la haute juridiction, elle est simplement réapparue sous une autre forme : l’exigence de licéité de l’intérêt lésé.
- L’exigence de licéité de l’intérêt lésé
- Dans un arrêt notable du 24 janvier 2002, la deuxième chambre civile a estimé que « une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites » (Cass. 2e civ., 24 janv. 2002, n°99-16.576).
- Comment interpréter cet arrêt au regard de la jurisprudence antérieure ?
- Comment justifier qu’un voyageur sans titre de transport puisse obtenir réparation de son préjudice, tandis qu’un travailleur non-déclaré n’est pas fondé à agir en responsabilité ?
- Pour certains auteurs, l’exigence tenant à la licéité de l’intérêt lésé dépendrait de la nature du préjudice subi par la victime.
- Ainsi, l’indemnisation du préjudice corporel primerait sur toute autre considération de légitimité, tandis que la réparation du préjudice seulement matériel serait subordonnée à la licéité de l’intérêt lésé.
Pour conclure, il peut être observé que la Cour de cassation aime à rappeler régulièrement que l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes) « est étranger aux règles de la responsabilité délictuelle » (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, n°91-15.867).
Aussi, cela signifie-t-il, en somme, que l’illicéité d’un préjudice ne fait pas nécessairement obstacle à sa réparation.
II) Les variétés de dommages
Classiquement, on distingue deux grandes catégories de préjudices :
- Les préjudices patrimoniaux
- Les préjudices extrapatrimoniaux
Il conviendra également de s’interroger sur le sort des préjudices qui ne relèvent d’aucune catégorie (C).
A) Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui sont consécutifs
- Soit à une atteinte aux biens
- Soit à une atteinte aux personnes
- Soit à l’atteinte d’un intérêt purement économique
1. Le préjudice consécutif à une atteinte aux biens
- Définition
- Le dommage aux biens peut se définir comme « la destruction ou la détérioration de choses appartenant à la victime ».
- Le dommage consécutif à l’atteinte aux biens peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir :
- d’une destruction
- d’une détérioration
- d’une perte
- d’une dépréciation
- Il peut s’agir, tant d’une atteinte à des biens corporels qu’à des biens incorporels
- Le juge ne distingue pas non plus entre les biens mobiliers et les biens immobiliers
- Réparation
- En vertu du principe de réparation intégrale, le dommage aux biens fait l’objet, lorsqu’il est établi, d’une indemnisation à la faveur de la victime en considération de la valeur vénale du bien détérioré ou détruit
- La Cour de cassation a, par ailleurs, admis d’assortir la réparation du préjudice purement matériel d’une réparation du préjudice moral occasionné par la perte du bien en lui-même (V. en ce sens Cass. 1re civ., 16 janv. 1962).
2. Le préjudice consécutif à une atteinte aux personnes
- Notion
- Il s’agit de réparer ici le préjudice matériel d’une victime consécutif à un dommage corporel
- Les implications patrimoniales peuvent être nombreuses :
- Frais médicaux et paramédicaux
- Frais d’hospitalisation à domicile
- Appareillage
- Rééducation
- Frais résultant de l’incapacité professionnelle
- Nomenclature Dintilhac
- La Nomenclature Dintilhac, du nom de son auteur, Jean-Pierre Dintilhac, ancien président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, est une sorte de cartographie des chefs de préjudices.
- Elle est utilisée par les praticiens du droit comme un outil d’évaluation de l’indemnisation des victimes de préjudices corporels.
- L’objectif affiché par le groupe de travail Dintilhac est, selon les termes de son rapport, de « bâtir une classification méthodique rassemblant différents chefs de préjudice selon un ordonnancement rationnel tenant compte de leur nature propre » en vue de garantir « le droit des victimes de préjudices corporels à une juste indemnisation ».
- Bien que la Cour de cassation s’y soit déjà référée dans plusieurs décisions (V. notamment Cass. avis, 29 oct. 2007, n° 07-00.015), la nomenclature Dintilhac ne revêt aucun caractère obligatoire.
- Ainsi, le Conseil d’État a-t-il préféré conserver sa propre grille d’évaluation des préjudices (CE, 5 mars 2008, n° 272447).
- Identification des principaux postes de préjudices
- S’agissant du dommage consécutif à l’atteinte aux personnes, la nomenclature dintilhac distingue deux principaux postes de préjudices
- Les préjudices patrimoniaux temporaires nés avant la consolidation de l’atteinte à l’intégrité physique :
- Les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation etc…
- Les préjudices patrimoniaux permanents, soit ceux qui persistent après la consolidation de l’atteinte à l’intégrité physique :
- Les dépenses de santé futures, la perte de gains professionnels futurs, les incidences professionnelles, les frais d’aménagement du logement, les frais de véhicule adapté etc.
3. Le préjudice consécutif à l’atteinte d’un intérêt purement économique
- Notion
- Le préjudice économique est défini par Ph. Brun comme « le préjudice de nature patrimoniale consistant dans la perte d’un profit ou d’une espérance de gain qui ne résulte pas d’une atteinte aux biens ou à la personne de la victime ».
- Exemples : le préjudice résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de l’inexécution d’un contrat de fourniture ou de service, le préjudice résultant de la violation d’une règle de droit de la concurrence etc…
- Réparation
- En tant que tel, le préjudice économique pur (pure economic loss en droit anglo-saxon) ne donne pas lieu à réparation en droit français.
- L’article 1245-1 du Code civil (ancien article 1386-2) prévoit que seul le préjudice qui « résulte d’une atteinte à un bien » de la victime est réparable.
- Pourtant, la Cour de cassation rappelle régulièrement que « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de remplacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » (Cass. civ. 2, 28 oct. 1954, JCP 1955, II, 876).
- Ainsi, dès lors qu’une victime fait état d’une perte ou d’un manque à gagner, elle devrait obtenir réparation de son préjudice.
- Dans ces conditions, comme le relève un auteur, « au regard de l’orientation du droit français de la responsabilité civile, il est […] possible que la Cour de cassation ne laisse pas un tel dommage sans réparation. Parce qu’il est naturellement porté à n’opérer aucune distinction entre les chefs de préjudice lorsqu’il s’agit de définir ce qui est réparable, le juge français pourrait considérer que la notion de « dommages aux biens » évoquée dans la responsabilité du fait des produits doit être interprétée de façon particulièrement extensive. ».
- Reste, néanmoins, en suspens la question de l’évaluation du préjudice économique qui se posera nécessairement au juge.
B) Les préjudices extrapatrimoniaux
?Notion
S’ils donnent lieu à une réparation pécuniaire, les préjudices extrapatrimoniaux consistent en la lésion d’un intérêt de nature extrapatrimoniale
Le préjudice extrapatrimonial est, de par sa nature, difficilement évaluable en argent.
Comment, en effet, évaluer le préjudice moral d’une mère qui vient de perdre son enfant dans un accident de voiture ? Pareille douleur a-t-elle un prix ? Si oui, comment l’évaluer ?
Aussi, compte-tenu de la particularité du préjudice extrapatrimonial, une partie de la doctrine s’est montrée pour le moins hostile quant à la réparation du préjudice moral
La jurisprudence a, de son côté, très tôt estimé que le préjudice moral constituait un préjudice réparable
En témoigne cet arrêt du 13 février 1923 rendu par la chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ., 13 févr.1923).
|
Cass. civ., 13 févr.1923
LA COUR ; – Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que Templier ayant été mortellement blessé par un cheval qui appartenait à Lejars, l’arrêt attaqué a condamné celui-ci, par confirmation du jugement, à payer aux trois fils et à la fille de Templier une indemnité comprenant, en outre du préjudice matériel, le dommage moral résultant de la douleur qu’éprouvent les enfants par la mort de leur père ; qu’en statuant ainsi, il n’a pas violé l’article 1382 c.civ. visé au moyen ; qu’en effet, cet article, d’après lequel quiconque par sa faute cause à autrui un dommage est obligé de le réparer, s’applique, par la généralité de ses termes, aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel ; que, dès lors, la première branche du moyen n’est pas fondée;
Sur la seconde branche : – Attendu que l’arrêt attaqué déclare que les enfants de Templier ont été atteints dans leurs plus légimes et plus chères affections et que les éléments de la cause permettent de déterminer l’importance de l’indemnité ; que ces déclarations sont souveraines ;
Par ces motifs, rejette.
|
? Identifications des différentes postes de préjudices extrapatrimoniaux
Selon la nomenclature Dindilhac (V. en ce sens le rapport Dindilhac dont sont issus les développements qui suivent), il convient de distinguer les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation), des préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs :
- Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Le Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
- Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
- Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
- Les souffrances endurées (SE)
- Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
- Le préjudice esthétique temporaire (PET)
- Il a été observé que, durant la maladie traumatique, la victime subissait bien souvent des atteintes physiques, voire une altération de son apparence physique, certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
- Or ce type de préjudice est souvent pris en compte au stade des préjudices extrapatrimoniaux permanents, mais curieusement omis de toute indemnisation au titre de la maladie traumatique où il est pourtant présent, notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face.
- Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
- Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extrapatrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
- Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime.
- Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
- Ce poste peut être défini, selon la Commission européenne à la suite des travaux de Trèves de juin 2000, comme correspondant à « la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomenes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
- Le préjudice d’agrément (PA)
- Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
- Ce poste de préjudice doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc.).
- Le préjudice esthétique permanent (PEP)
- Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.
- Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
- Le préjudice sexuel (PS)
- Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
- Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir)
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
- Là encore, ce préjudice doit être apprécié in concreto en prenant en considération les paramètres personnels de chaque victime.
- Le préjudice d’établissement (PE)
- Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation :
- Il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
- Il convient ici de le définir par référence à la définition retenue par le Conseil national de l’aide aux victimes comme la “perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap”.
- Ce type de préjudice doit être apprécié in concreto pour chaque individu en tenant compte notamment de son âge.
- Les préjudices permanents exceptionnels (PPE)
- Lors de ses travaux, le groupe de travail a pu constater combien il était nécessaire de ne pas retenir une nomenclature trop rigide de la liste des postes de préjudice corporel.
- Ainsi, il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteint la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.
- À cette fin, dans un souci de pragmatisme – qui a animé le groupe de travail durant ses travaux -, il semble important de prévoir un poste “préjudices permanents exceptionnels” qui permettra, le cas échéant, d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extrapatrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais.
- Ainsi, il existe des préjudices extrapatrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage’.
- Il s’agit ici des préjudices spécifiques liés à des événements exceptionnels comme des attentats, des catastrophes collectives naturelles ou industrielles de type “A.Z.F., ou sinistres collectifs, tels une catastrophe aérienne.
- Les préjudices extrapatrimoniaux évolutifs
- Préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV)
- Il s’agit d’un poste de préjudice relativement récent qui concerne toutes les pathologies évolutives.
- Il s’agit notamment de maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé en tant que tel.
- C’est un chef de préjudice qui existe en dehors de toute consolidation des blessures, puisqu’il se présente pendant et après la maladie traumatique.
- Tel est le cas du préjudice lié à la contamination d’une personne par le virus de l’hépatite C, celui du V.I.H., la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou l’amiante, etc.
- Il s’agit ici d’indemniser “le préjudice résultant pour une victime de la connaissance de sa contamination par un agent exogène, quelle que soit sa nature (biologique, physique ou chimique), qui comporte le risque d’apparition à plus ou moins brève échéance, d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
- Bien évidemment, la liste de ce type de préjudice est susceptible de s’allonger dans l’avenir au regard des progrès de la médecine qui mettent de plus en plus en évidence ce type de pathologie virale ou autre jusque-là inexistante ou non détectée.
C) Les préjudices ne relevant d’aucune catégorie
Quid lorsqu’un dommage ne s’insère pas dans l’une des catégories sus-énoncées ?
En principe, dès lors qu’un préjudice est certain, personnel et licite, il est réparable. Est-ce à dire que dès lors qu’un préjudice revêt ces caractères, la victime est fondée à agir en réparation ?
Comme le relève Bertrand Fages, si « le droit français de la responsabilité extracontractuelle se caractérise par sa tendance naturelle à considérer que tous les types de préjudice doivent être réparés intégralement, il ne propose aucun élément précis de définition de ce qu’est un préjudice et n’opère pas, au sein des différents intérêts pouvant être lésés par un fait dommageable, de sélection entre ceux qui sont susceptibles d’être indemnisés par le biais de la responsabilité extracontractuelle et ceux qui ne le sont pas »
Lorsque le préjudice est d’ordre corporel ou matériel, la question de sa réparation ne soulève guère de difficultés,
Quid, lorsque le préjudice invoqué par la victime ne consiste, ni en une perte, ni en un manque à gagner ?
La question s’est ainsi posée de savoir si la naissance d’un enfant handicapé pouvait constituer, en elle-même, un préjudice réparable.
Saisie de cette question, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, y a apporté une réponse positive dans un arrêt Perruche du 17 novembre 2000 (Cass., ass. plén., 17 nov. 2000, n°99-13.701).
Indépendamment de la véritable onde de choc provoquée par cette affaire – dont l’issue judiciaire a contraint le législateur à intervenir – la solution adoptée par la Cour de cassation a mis en exergue le besoin, ô combien impérieux, de définir la notion de préjudice réparable.
| Focus sur l’affaire Perruche |
?Première étape : l’arrêt Perruche du 17 novembre 2000
|
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
Attendu qu’un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d’appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y…, médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A…, avaient commis des fautes contractuelles à l’occasion de recherches d’anticorps de la rubéole chez Mme X… alors qu’elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l’enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu’elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d’atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu’elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l’enfant n’était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant, l’arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que ” l’enfant Nicolas X… ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises ” par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu’il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ;
Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec Mme X… avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l’un et l’autre des pourvois:
CASSE ET ANNULE, en son entier, l’arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée que lors de l’audience du 17 décembre 1993
|
Faits :
Un enfant naît lourdement handicapé à la suite d’une erreur médicale commise par un médecin. Aussi, cette erreur a-t-elle privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Demande :
Les parents introduisent une action en justice pour obtenir réparation :
- D’une part, du préjudice occasionné par l’erreur de diagnostic du médecin, cette erreur les ayant privés de la possibilité de recourir à une IVG
- D’autre part, du préjudice de leur enfant, né handicapé
Procédure :
- Dispositif de la Cour d’appel :
- Par un arrêt du 17 décembre 1993, la Cour d’appel de Paris déboute partiellement les parents de leur demande de réparation
- Motivation de la Cour d’appel :
- Les juges du fond estiment, en effet, que les parents étaient parfaitement fondés à obtenir réparation du préjudice personnellement subi par eux du fait de l’erreur de diagnostic commise par le médecin.
- Les juges du fond estiment, néanmoins, que le préjudice subi par leur enfant du fait de son handicap ne saurait faire l’objet d’une réparation dans la mesure où il n’existerait aucun lien de causalité entre la faute du médecin et le handicap de l’enfant.
Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si un enfant né handicapé à la suite d’une erreur de diagnostic d’un médecin pouvait obtenir réparation du fait de sa naissance ?
Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt :
- Par un arrêt du 17 novembre 2000, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
- Visa : art. 1165 et 1382 du Code civil
- Cas d’ouverture à cassation : violation de la loi
Sens de l’arrêt
La Cour de cassation reproche, en l’espèce, à la Cour d’appel d’avoir estimé qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’erreur de diagnostic du médecin et le handicap de l’enfant.
Pour l’assemblée plénière, dès lors que les parents de l’enfant ont été « empêchés » de recourir à une IVG, il existe un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice résultant pour l’enfant de son handicap.
Analyse de l’arrêt
La solution adoptée par la Cour de cassation interroge manifestement sur deux points :
- L’existence d’un lien de causalité entre la faute du médecin et le préjudice de l’enfant
- La réparation du préjudice de l’enfant résultant de son handicap
- Sur le lien de causalité
Une lecture attentive de l’attendu de principe de l’arrêt Perruche nous révèle que l’Assemblée plénière ne s’est pas arrêtée aux constatations des juges du fond qui attribuaient les troubles dont souffrait l’enfant à la rubéole contractée pendant sa vie intra-utérine
Elle déduit la responsabilité des praticiens vis-à-vis de l’enfant de l’existence d’une faute à l’égard de la mère : « dès lors que la mère a été empêchée »
La causalité retenue est, par conséquent, indirecte et non directe, comme l’exige pourtant l’article 1382 du Code civil.
De toute évidence, les juges du fond ne se sont guère expliqués, en l’espèce, sur le lien causal, tant il leur a paru évident que les fautes constatées n’étaient pas en corrélation avec les malformations.
Ces malformations préexistaient à leur intervention. La naissance n’a fait que les révéler, comme le thermomètre révèle la température sans en être la cause.
En clair, les échographies n’ont pas suscité de malformations sur un enfant précédemment sain.
Dans ces conditions, comment est-il possible d’affirmer que le handicap dont souffrait Nicolas Perruche a été causé par une faute consistant précisément à ne pas déceler ce handicap ?
On a soutenu que les fautes étaient bien causales, dès lors que, sans leur commission, le dommage aurait pu être évité.
Toutefois s ces fautes ont eu pour seule conséquence de priver la mère de la possibilité de recourir à l’interruption de grossesse, laquelle n’aurait alors pu faire obstacle qu’à la naissance.
De même, on a pu invoquer l’inexécution fautive du contrat médical qui cause un préjudice à un tiers, en l’occurrence l’enfant, argument en trompe-l’œil, car il ne s’agit de rien d’autre que du manquement au devoir d’information envers la mère dont celle-ci est la seule victime.
D’évidence, seule la naissance de l’enfant est en lien directe avec le handicap.
Si l’on veut découvrir un préjudice causé à l’enfant, on est contraint d’en déduire que c’est la naissance car, même informée, la mère n’aurait pu empêcher le handicap.
Elle aurait seulement pu empêcher la naissance, ce qui, par l’absurde, aurait empêché le handicap.
Le handicap étant consubstantiel à la personne de l’enfant, la tentation était donc forte pour la Cour de cassation d’amalgamer naissance et handicap.
C’est, en réalité, le préjudice consécutif au fait d’être né handicapé que l’Assemblée plénière a accepté d’indemniser.
Mais, l’enfant, en l’absence de traitement connu, aurait pareillement été atteint de malformations sans les fautes médicales.
Dans cette hypothèse, l’enfant aurait peut-être été avorté et il serait mort avec son handicap.
De nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la décision rendue par la Cour de cassation : la cause du handicap de l’enfant, ce n’est pas la faute du médecin, mais la maladie génétique contractée par l’enfant lui-même !
Plusieurs remarques toutefois s’imposent :
- Il faut remarquer qu’en matière de causalité, les règles sont particulièrement souples.
- Il est donc un peu hypocrite de relever dans l’arrêt en l’espèce un problème de causalité, alors que de façon générale la jurisprudence est peu regardante sur la question.
- Surtout, s’il n’y a pas de causalité entre le dommage de l’enfant – son handicap – et la faute du médecin, il n’y en a pas plus entre le dommage des parents et la faute du médecin, car la véritable cause du dommage c’est la maladie génétique de l’enfant.
- Si, dès lors, on refuse de voir un lien de causalité entre le dommage de l’enfant et la faute du médecin on doit également refuser de le voir entre le dommage des parents et l’erreur de diagnostic.
- La causalité n’est donc sans doute pas la principale problématique dans l’arrêt en l’espèce.
On peut d’ailleurs tenir la même réflexion à propos d’un arrêt du 24 février 2005 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dont la problématique interroge, une nouvelle fois sur la notion de préjudice (Cass. 2e civ., 24 févr. 2005 : n°02-11.999)
|
Cass. 2e civ., 24 févr. 2005
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X… a été victime en 1974 d’un accident de la circulation dont M. Y…, assuré par la compagnie L’Alsacienne, aux droits de laquelle vient la société Azur assurances (Azur), a été reconnu responsable ; que M. X…, qui a conservé un handicap, a eu des enfants nés en 1977, 1985 et 1987 ; que ceux-ci ont estimé n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap ; que Mme X…, en qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, et les enfants majeurs, ont assigné l’assureur du responsable en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que, pour condamner la société Azur à indemniser le préjudice moral subi par les enfants de M. X…, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le handicap de M. X… a empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE,
|
Les faits étaient les suivants :
Les enfants d’un homme handicap agissent sur le fondement de l’article 1382 pour obtenir réparation de leur préjudice moral : ils estimaient n’avoir jamais pu établir des relations ludiques et affectives normales avec leur père dont ils vivaient au quotidien la souffrance du fait de son handicap.
Parce que ce handicap était consécutif à un accident de la circulation, ils demandent réparation à celui qui avait été considéré comme responsable de l’accident.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait décidé de les indemniser.
Selon la deuxième chambre civile, il n’y aurait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué, car, selon elle, les enfants sont nés après l’accident de leur père : le fait de leur naissance viendrait donc briser la chaîne des causalités.
Cette affirmation est cependant très contestable.
En effet, les privations des enfants consécutives au handicap de leur père sont bien une conséquence de l’accident.
On aurait donc pu trouver un lien de causalité, si l’on avait voulu. Mais on ne l’a pas fait.
Pourquoi ?
Très certainement parce que cela serait revenu à admettre qu’être élevé par un parent handicapé était un préjudice réparable, ce qui laissait entendre que les enfants estimaient qu’il eût été préférable pour eux d’être élevés par une personne valide…
C’est, en réalité ce type de question qui est au cœur de la controverse née de l’arrêt Perruche : peut-on considérer qu’être né, certes handicapé, constitue un préjudice en soi ?
- Sur la question du préjudice
La véritable question que pose l’arrêt Perruche a trait à l’association de deux mots : « né handicapé ».
La Cour de cassation affirme dans cet arrêt que l’enfant peut obtenir réparation « du préjudice résultant de son handicap ».
Par cette formule habile, la Cour de cassation tente ici de nier qu’elle répare la naissance : comment peut-on dissocier le handicap de Nicolas Perruche et sa naissance ?
Le raisonnement tenu par la Cour de cassation est exact, mais fait l’impasse sur cette question de la réparation du préjudice que constitue la naissance !
En temps normal, pour savoir s’il y a préjudice, on se demande quelle serait la situation de la victime si le fait dommageable ne s’était pas produit.
On compare cette situation à la situation actuelle : la différence entre les deux constitue le préjudice.
- Du point de vue de la mère, si aucune faute du médecin n’avait été commise, alors il y aurait probablement eu avortement.
- Mais comme il y a eu une faute, la conséquence en est la naissance d’un enfant handicapé.
- Le préjudice serait donc, non seulement le handicap, mais également la naissance de l’enfant !
- Du point de vue de l’enfant, s’il n’y a pas eu de faute, la mère procède à l’IVG et donc il n’existe pas.
- Il n’y aurait donc aucun préjudice pour lui : il ne saurait se plaindre d’exister.
- Or s’il n’y a pas faute, il n’existe pas.
L’argument est ici extrêmement fort. On peut néanmoins se demander si la négation de l’existence d’un préjudice est opportune.
C’est donc là une question d’éthique qui se pose à la Cour de cassation.
Ne peut-on pas, en effet, se contenter de constater l’existence la charge financière et matérielle que représente la vie de l’enfant né handicapé ? L’enfant né handicapé ne vit pas comme les autres. Sa vie sera bien plus coûteuse que celle d’enfants valides.
Dans cette perspective, une définition du préjudice se fait sentir, ne serait-ce que pour pouvoir échapper à la question posée par l’arrêt Perruche à savoir : peut-on indemniser un enfant du fait d’être né handicapé ?
Au nom de la dignité de l’enfant, faut-il estimer qu’il est plus respectueux d’indemniser ou de ne pas indemniser ? Telle est la question qu’il faudrait se poser.
La solution à cette problématique résiderait peut-être dans la reconnaissance de dommages et intérêts punitifs.
De tels dommages et intérêt sont alloués à la victime en considération, non pas de l’existence d’un dommage, mais de la caractérisation d’une faute de l’auteur du fait dommageable.
Ces dommages et intérêts punitifs seraient donc une porte de sortie intéressante dans l’affaire Perruche.
Car en vérité, qu’est-ce que l’assemblée plénière a cherché à faire dans cette décision ?
La Cour de cassation a simplement souhaité indemniser Nicolas Perruche afin de permettre à ses parents de subvenir aux très lourdes dépenses auxquelles ils vont devoir faire face pour l’élever et l’assister dans son quotidien.
En consacrant les dommages et intérêts punitifs, il aurait été possible de retenir la responsabilité des médecins qui ont incontestablement commis une faute, sans pour autant être contraint de caractériser un préjudice qui, en l’espèce, est pour le moins difficilement caractérisable !
On échapperait ainsi au débat éthique !
?Deuxième étape : l’intervention du législateur.
Manifestement, telle n’est pas la voie qui a été empruntée par le législateur, lequel est intervenu à la suite de l’affaire Perruche, sous la pression des associations de personnes handicapées.
C’est dans ce contexte que la loi du 4 mars 2002 a été adoptée. Elle prévoit en son article 1er que « nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ».
Ainsi, le législateur a-t-il choisi d’exclure l’indemnisation de l’enfant ainsi que celle des parents pour leur préjudice autre que moral. Il s’agit là, indéniablement, d’une double sanction : et pour les parents et pour l’enfant !
A cet égard, le 3e paragraphe du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 prévoyait que « les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. »
Ce paragraphe a par suite été repris par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Le texte prévoit que « Les dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles tel qu’il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation. »
?Troisième étape : condamnation de la France par la CEDH.
La loi du 4 mars 2002 était applicable aux litiges en cours, de sorte que l’on était en présence d’une loi rétroactive.
Cette application rétroactive de la loi a, cependant, été censurée par la CEDH dans deux arrêts relatifs à des demandes d’indemnisation à l’encontre d’hôpitaux et donc formée devant le juge administratif français (CEDH, 21 juin 2006, Maurice c/ France et CEDH, 6 octobre 2005, Draon c/ France et Maurice c/ France)
La CEDH a construit son raisonnement sur l’existence d’un bien, en l’occurrence une créance de réparation d’un préjudice.
Car pour les juges strasbourgeois, les requérants ont été privés de ce bien (la créance de réparation) par l’intervention du législateur français.
Pour la CEDH il y a, en effet, eu atteinte par le législateur français au droit au respect de ses biens.
Or cette atteinte est, selon la CEDH, disproportionnée, bien qu’elle poursuive un but d’intérêt général.
?Quatrième étape : application par le juge français de la décision rendue par la CEDH
Ce raisonnement soutenu par la CEDH va être repris par la Cour de cassation dans trois arrêts du 24 janvier 2006 (Cass. 1re civ., 24 janv. 2006, n° 02-13.775 ; 01-16.684 et 02-12.260) et par le Conseil d’État dans un arrêt du 24 février 2006 (CE, 24 févr. 2006, n° 250704, CHU Brest).
Ainsi, la solution de la Cour de cassation dégagée dans l’affaire Perruche s’impose-t-elle, désormais, au législateur interne.
?Cinquième étape : reconduite de la position de la Cour de cassation pour des affaires portant sur des naissances antérieures à la loi du 4 mars 2002
La Cour de cassation a eu à connaître, par suite, d’affaires portant sur des naissances antérieures à l’entrée en vigueur de loi du 4 mars 2002 mais avec des instances introduites ultérieurement.
Dans un arrêt rendu le 30 octobre 2007, la Cour de cassation a appliqué sa jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 au dommage dont la « révélation (…) était nécessairement antérieure à l’entrée en vigueur de la loi » du 4 mars 2002 (Cass. 1ère civ. 30 oct. 2007, n°06-17.325).
Cette même solution a été reprise par un arrêt de la première chambre civile du 8 juillet 2008. La Cour de cassation a jugé dans cette décision que « les intéressés pouvaient, en l’état de la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur de cette loi, légitimement espérer que leur préjudice inclurait toutes les charges particulières invoquées, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi […], indépendamment de la date d’introduction de la demande en justice. » (Cass. 1ère civ. 8 juill. 2008, n°07-12.159).
La Cour de cassation a suivi ici les vœux de certains civilistes, qui faisaient remarquer que « l’atteinte au droit de créance semble caractérisée de façon parfaitement égale qu’une action en justice ait été ou non formée avant l’adoption de la loi » et non pas ceux qui estimaient que le raisonnement de la CEDH n’était pas fondé sur les règles du droit civil français.
La jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002 a donc été maintenue pour tous les dommages antérieurs au 7 mars 2002, sous la seule réserve des décisions ayant force de chose jugée.
?Sixième étape : censure par le Conseil constitutionnel de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002
Par suite, le Conseil constitutionnel le 14 avril 2010 d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Conseil d’État à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé devant lui a, à son tour, écarté la rétroactivité de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002, en abrogeant la disposition de la loi du 11 février 2005 qui la prévoyait, en jugeant notamment que « si les motifs d’intérêt général précités pouvaient justifier que les nouvelles règles fussent rendues applicables aux instances à venir relatives aux situations juridiques nées antérieurement, ils ne pouvaient justifier des modifications aussi importantes aux droits des personnes qui avaient, antérieurement à cette date, engagé une procédure en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice » (Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010).
Comme l’écrit un auteur « l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 a été vaincu par l’union des juges » !
Restait toutefois à déterminer quel sort réserver aux actions concernant des enfants nés avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 mais engagées postérieurement.
?Septième étape : réception de la décision du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État et la Cour de cassation
Par un arrêt du 13 mai 2011, le Conseil d’État a jugé que l’effet rétroactif de la loi du 4 mars 2002 ne pouvait être neutralisé que pour les seules instances en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Pour celles introduites postérieurement, la juridiction administrative estime qu’il y a lieu de faire rétroagir les effets de la loi (CE, ass., 13 mai 2011, n°329290).
La Cour de cassation, saisie la même année, a retenu une solution radicalement opposée à celle adoptée par le Conseil d’État.
Par un arrêt du 15 décembre 2011, elle a jugé que la loi du 4 mars 2002 n’avait pas vocation à s’appliquer aux dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur, soit aux naissances survenues avant le 7 mars 2002, quand bien même la demande en justice était postérieure (Cass. 1ère civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.473).
Trois ans plus tard, la Conseil d’État confirmera malgré tout sa position dans un arrêt du 31 mars 2014.
Au soutien de sa décision il affirme que les requérants, parents d’un enfant né handicapé, faute d’avoir engagé une instance avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 « n’étaient pas titulaires à cette date d’un droit de créance indemnitaire qui aurait été lui-même constitutif d’un bien au sens de ces stipulations conventionnelles » et que, à ce titre, « le moyen tiré de ce que l’application de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles aux instances engagées après le 7 mars 2002 à des situations nées avant cette date porterait une atteinte disproportionnée aux droits qui leur sont garantis par ces stipulations doit être écarté » (CE, 31 mars 2014, n°345812).
Contestant la décision rendue par le Conseil d’État, les requérants forment un recours auprès de la CEDH.
?Huitième étape : nouvelle condamnation de la France par la CEDH
Saisie pour violation de l’article 1 du protocole additionnel (droit aux biens) et des articles 6-1 (droit au procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de non-discrimination) de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, par un arrêt du 3 février 2022, la CEDH condamne une nouvelle fois la France pour violation de l’article 1er du protocole additionnel (CEDH, 3 févr. 2022, n° 66328/14, N. M. et a. c/ France).
Contrairement à ce qui avait été décidé par le Conseil d’État, les juges strasbourgeois considèrent que, à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, les requérants détenaient bien une créance qu’ils pouvaient légitimement espérer voir se concrétiser, conformément au droit commun de la responsabilité pour faute, s’agissant d’un dommage survenu antérieurement à l’intervention de la loi litigieuse.
Pour fonder sa décision, la CEDH relève que, au cas particulier, les juridictions nationales avaient établi sans ambiguïté, dans le cadre des décisions rendues, et à tous les stades de ces procédures, l’existence d’une faute ainsi que d’un lien de causalité directe entre la faute commise et le préjudice subi.
Les juridictions ont en effet considéré qu’en l’espèce la faute du centre hospitalier a conduit les requérants à croire que l’enfant conçu n’était pas atteint d’anomalie et que la grossesse pouvait être normalement menée à son terme, alors que les requérants avaient clairement manifesté leur volonté d’éviter le risque d’un accident génétique.
La faute ainsi commise a dissuadé la requérante de pratiquer tout examen complémentaire qu’elle aurait pu faire dans la perspective d’une interruption de grossesse pour motif thérapeutique.
Les conditions d’engagement de la responsabilité du Centre hospitalier étaient donc bien réunies, et les requérants disposaient par conséquent d’une créance correspondant au droit à l’indemnisation des frais liés à la prise en charge d’un enfant né handicapé après une erreur de diagnostic prénatal s’analysant en une « valeur patrimoniale ».
Quant à la date à laquelle cette créance aurait été constituée en droit interne sans l’application contestée des dispositions de l’article L. 114-5 du CASF, la CEDH relève que les jurisprudences administratives et judiciaires sont concordantes : le droit à réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause, et ce, indépendamment de la date d’introduction d’une demande en justice tendant à la réparation de ce dommage (voir paragraphe 19 ci-dessus).
Elle en déduit que, compte tenu des principes de droit commun français et de la jurisprudence constante en matière de responsabilité selon lesquels la créance en réparation prend naissance dès la survenance du dommage qui en constitue le fait générateur, les requérants pouvaient légitimement espérer pouvoir obtenir réparation de leur préjudice correspondant aux frais de prise en charge de leur enfant handicapé dès la survenance du dommage, à savoir la naissance de cet enfant.
Or cette espérance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; d’où la naissance avant cette date de leur créance d’indemnisation. Ils étaient donc titulaires d’un “bien” au sens de la première phrase de l’article 1 du Protocole n° 1, lequel s’applique dès lors en l’espèce.