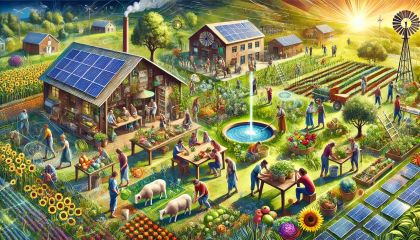Dans sa forme originelle, telle que pensée par les rédacteurs du Code civil, le droit de propriété est d’abord un droit individuel conférant à son titulaire un monopole de l’usage (usus), de la jouissance (fructus) et de la disposition (abusus) d’une chose.
Cette conception reflète une vision libérale de la propriété, influencée par les idées des Lumières et notamment par les théories de John Locke, qui voyait dans la propriété privée un prolongement de la personne et un fondement de la liberté et de l’autonomie individuelle.
Aussi, en 1804, la propriété est-elle fortement marquée par son caractère exclusif et absolu lequel s’accommode mal, a priori, de l’exercice de droits concurrents sur un même bien.
Il est pourtant des cas où l’appropriation d’une chose peut être collective. L’Histoire a, en effet, montré que la propriété n’a pas toujours été envisagée comme un droit strictement individuel.
Avant l’avènement du Code civil, et notamment sous l’Ancien Régime, diverses formes de propriétés collectives étaient courantes, notamment dans les communautés rurales où les terres agricoles étaient souvent exploitées collectivement sous forme de communautés villageoises ou de seigneuries.
Ces pratiques, qui consistaient notamment en des droits d’usage commun sur les forêts, les pâturages et les cours d’eau, ont été progressivement éclipsées par la quasi-sacralisation du concept de propriété privée à la Révolution française.
Lors de l’élaboration du Code civil, ses rédacteurs n’ont toutefois pas pu ignorer la propriété collective, car répondant à des situations où la propriété individuelle ne suffit pas à régler efficacement les rapports sociaux ou économiques, ou quand la chose se prête mal à une division matérielle.
Ces situations où l’appropriation collective d’un bien se rencontrent peuvent tout autant être subies (division de la propriété résultant de l’ouverture d’une succession), que voulues (instauration d’une communauté de biens dans le cadre d’un mariage).
À cet égard, classiquement on distingue six formes de propriété collective :
- L’indivision
- L’indivision est la situation juridique dans laquelle se trouvent plusieurs personnes (les coindivisaires) qui sont propriétaires ensemble d’un même bien, chacune ayant des droits égaux sur la totalité du bien, sans qu’il y ait division matérielle de celui-ci.
- Le plus souvent l’indivision résulte d’une situation fortuite, telle que l’ouverture d’une succession ou le prononcé d’un divorce.
- Aussi, l’indivision a-t-elle été conçue comme une situation juridique qui, par nature, est temporaire, en ce sens qu’elle n’a pas vocation à durer.
- L’article 815 du Code civil prévoit en ce sens que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué […]».
- S’agissant de la gestion du bien indivis, parce que, tous les coindivisaires exercent concurremment sur celui-ci un même droit réel, elle obéit au principe de l’unanimité.
- Cette règle de l’unanimité est essentielle pour prévenir les démarches qui pourraient affecter négativement les droits d’un ou plusieurs coindivisaires sans leur consentement.
- Par exemple, aucune décision concernant le bien, comme sa vente, son hypothèque, ou des rénovations substantielles, ne peut être prise sans l’accord de tous les coindivisaires.
- Toutefois, cette exigence peut aussi conduire à des impasses où les décisions nécessaires sont retardées ou bloquées en raison de désaccords.
- Pour remédier aux difficultés inhérentes à la règle de l’unanimité, des alternatives comme la possibilité d’attribuer à un coindivisaire la gestion du bien ou de nommer un administrateur peuvent être envisagées.
- La copropriété des immeubles bâtis
- La copropriété des immeubles bâtis est une situation juridique dans laquelle plusieurs personnes (les copropriétaires) détiennent individuellement des parties privatives d’un bien immobilier et partagent collectivement la propriété des parties communes.
- Dit autrement, chaque copropriétaire possède un droit exclusif sur certaines parties de l’immeuble (appartements, bureaux, etc.), appelées parties privatives, ainsi que des droits indivis sur les parties communes de l’immeuble (hall d’entrée, escaliers, toit, etc.).
- À cet égard, chaque lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
- La conséquence en est que aucun copropriétaire ne peut renoncer à son droit indivis sur les parties communes, ou le céder indépendamment de ses parties privatives et inversement.
- Si la copropriété et l’indivision partagent de nombreux points communs, il s’agit là de deux formes de propriété collective distinctes :
- L’indivision
- En indivision, chaque coindivisaire possède une fraction du bien, exprimée généralement en pourcentage qui symbolise leur part.
- Toutefois, il n’existe pas de séparation matérielle du bien ; de sorte que chaque coindivisaire a le droit d’utiliser la totalité du bien.
- Il en résulte que la gestion doit être assurée conjointement par tous les coindivisaires.
- La copropriété
- En copropriété, le bien est divisé matériellement en parties privatives (formant des lots), qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire, et en parties communes, dont tous les copropriétaires partagent la propriété.
- Compte tenu de ce que chaque copropriétaire est investi d’un pouvoir exclusif sur le lot dont il est titulaire, il y a là une incompatibilité s’agissant de la gestion du bien, avec le principe de l’unanimité lequel ne s’entend qu’en présence de pouvoirs concurrents.
- C’est la raison pour laquelle, en copropriété, la gestion du bien est régie par un règlement de copropriété.
- À cet égard, un syndic de copropriété est souvent élu pour gérer les parties communes, et les décisions sont prises lors d’assemblées générales selon des majorités prévues par la loi et le règlement de copropriété.
- L’indivision
- La communauté conjugale
- La communauté conjugale est la situation dans laquelle se trouvent deux personnes mariées qui ont opté pour la création d’un « patrimoine » commun.
- Contrairement à l’indivision, l’instauration d’une communauté de biens entre époux ne résulte jamais d’un cas fortuit ; il s’agit toujours d’une situation juridique qui a été voulue.
- Par ailleurs, à la différence de l’indivision qui, par nature, est temporaire, la communauté a vocation à durer aussi longtemps que perdure le mariage.
- Enfin, la communauté se distingue fondamentalement de l’indivision en ce que sa gestion ne requiert pas toujours l’accord des deux époux.
- Sur les biens communs, les époux sont investis, tantôt de pouvoirs concurrents (actes de gestion courante), tantôt de pouvoirs exclusifs (actes accomplis sur des biens affectés à l’exercice d’une profession séparée).
- Ce n’est que dans certains cas, très à la marge, que c’est le principe de cogestion qui préside à la gestion des biens (acte de disposition à titre gratuit entre vifs, actes visant à aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, etc.)
- La mitoyenneté
- La mitoyenneté est définie classiquement comme l’« état d’un bien sur lequel deux voisins ont un droit de copropriété et qui sépare des immeubles, nus ou construits, contigus»[1].
- Le Code civil traite de la mitoyenneté avec les servitudes et plus précisément dans le chapitre consacré aux servitudes établies par la loi.
- Est-ce à dire que la mitoyenneté est constitutive d’une servitude au sens de l’article 637du Code civil ?
- Pour mémoire, cette disposition définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
- Pour la majorité des auteurs, la mitoyenneté ne s’analyse pas en une servitude dans la mesure où elle n’instaure pas vraiment de relation entre un fonds servant et un fonds dominant les propriétaires étant mis sur un pied d’égalité.
- La mitoyenneté n’implique pas, en effet, la création d’une charge pour l’un et d’un droit réel pour l’autre. Les propriétaires sont investis d’un même droit de propriété qu’ils exercent en commun sur le bien séparant leurs fonds respectifs.
- Ajoutés à cela, les modes d’acquisition de la mitoyenneté diffèrent sensiblement de ceux institués en matière de servitude. Pour exemple, la destination du bon père de famille qui ne joue pas en matière de mitoyenneté. À l’inverse, le jeu de la prescription abrégée est exclu pour les servitudes.
- La mitoyenneté ne s’analysant pas en une servitude, la question de sa nature s’est posée en doctrine et en jurisprudence.
- Si elle emprunte à l’indivision de nombreux traits, elle s’en distingue en ce qu’elle ne place pas les propriétaires des fonds contigus dans une situation temporaire ; la mitoyenneté leur confère un droit de propriété perpétuel sur l’élément de séparation.
- De la même manière, elle ne correspond pas à la copropriété des immeubles bâtis, faute de division du mur, de la clôture ou de la haie en parties communes et parties privatives.
- À l’examen, la mitoyenneté n’est autre qu’une forme particulière d’indivision assujettie à un régime juridique spécifique.
- Telle est la position que semble avoir adopté la Cour de cassation qui, par exemple, dans un arrêt du 19 février 1985 a jugé que « la mitoyenneté constitue un droit de propriété indivise» ( 3e civ. 19 févr. 1985, n°83-16496).
- Dans une décision du 20 juillet 1989 elle a encore affirmé que « la mitoyenneté est un droit de propriété dont deux personnes jouissent en commun», ce qui l’a conduite à censurer une Cour d’appel qui l’avait qualifié de servitude ( 3e civ. 20 juill. 1989, n°88-12883).
- La propriété fiduciaire
- Instituée par la loi, n° 2007-211 du 19 février 2007 elle est définie à l’article 2011 du Code civil comme « l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires. »
- D’origine romaine, la fiducie est l’un des plus anciens contrats réels visant soit à la gestion d’un patrimoine (fiducie cum amico), soit à la garantie d’une créance (fiducie cum creditore).
- Si elle a évolué dans sa forme, ses principes sont fondamentalement restés inchangés : il s’agit toujours, pour le titulaire de droits sur un patrimoine (le « constituant »), de consentir un transfert de tout ou partie de ses droits vers le patrimoine d’un tiers (le « fiduciaire »), à charge pour celui-ci d’agir dans un but déterminé au profit d’un ou de plusieurs bénéficiaires.
- La fiducie, qui repose sur la conclusion d’un contrat synallagmatique, comporte deux grandes obligations :
- Tout d’abord, le constituant doit transférer le droit de propriété qu’il détient sur un bien à son cocontractant, le fiduciaire
- Ensuite, le fiduciaire s’engage réciproquement, d’une part, à gérer ledit bien et, d’autre part, à le restituer, soit au fiduciant, soit à un autre bénéficiaire préalablement désigné par lui, à une échéance précisée (date ou événement, tel qu’un décès, un défaut ou un appel à garantie).
- Quant au bénéficiaire, il n’est pas partie au contrat ; il se trouve dans une situation semblable au tiers bénéficiaire d’une stipulation pour autrui.
- Par la conclusion du contrat fiduciaire, le constituant transfère les droits et les choses mobilières ou immobilières au fiduciaire, qui en acquiert la pleine titularité.
- S’il transmet ces mêmes droits à un tiers, même à titre gratuit, ce dernier devient alors à son tour propriétaire.
- Par voie de conséquence, le constituant et le bénéficiaire ne peuvent exciper que de droits de nature personnelle, sous forme d’une créance de restitution.
- Le fiduciaire ne peut néanmoins agir que dans la limite des conditions fixées par le contrat. Dès lors, ses actes sont susceptibles d’engager sa responsabilité en cas d’irrespect des objectifs fixés lors de la constitution de la fiducie.
- Les biens mis en fiducie sont en principe administrés dans un intérêt distinct de celui de la personne à qui ils se trouvent transmis.
- Aussi relèvent-ils d’un statut patrimonial un peu particulier, dans la mesure où ils constituent un patrimoine d’affectation séparé du patrimoine personnel du fiduciaire.
- L’article 2025du Code civil dispose en ce sens que « Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d’un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine. »
- Le fiduciaire est donc, en réalité, titulaire d’au moins deux patrimoines :
- D’une part, son patrimoine propre
- D’autre part, un patrimoine fiduciaire.
- Il peut même être en pratique titulaire de plusieurs patrimoines fiduciaires s’il est désigné fiduciaire par plusieurs actes juridiques distincts.
- Le patrimoine propre du fiduciaire et le patrimoine fiduciaire sont donc juridiquement distincts et les opérations effectuées au titre de la fiducie doivent l’être à partir des biens figurant dans le patrimoine fiduciaire.
- Par voie de conséquence, les créanciers personnels du fiduciaire ne peuvent exiger le paiement de leur dette en saisissant des biens formant le patrimoine d’affectation.
- Par exception, l’article 2025du Code civil prévoit que « en cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire. »
- Par ailleurs, le contrat de fiducie peut également limiter l’obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n’est toutefois opposable qu’aux créanciers qui l’ont expressément acceptée.
- La société
- L’article 1832 du Code civil dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
- Il ressort de cette disposition que la société s’analyse en un contrat visant à créer une entité juridique distincte de ses membres, capable de posséder des biens, de contracter des dettes, et d’exercer des droits en son propre nom.
- Aussi, une société dispose-t-elle de la capacité juridique à être propriétaire de biens qui ne sont pas attribués individuellement à ses membres, mais détenus collectivement par l’entité elle-même.
- Cela signifie que les actifs appartiennent à la société en tant que personne morale et non aux actionnaires ou associés individuellement.
- Les membres ont des droits dans le bénéfice généré par ces biens, proportionnellement à leur part dans le capital social, mais n’ont pas de droit direct sur les biens eux-mêmes.
- C’est là toute la différence avec l’indivision, les coindivisaires exerçant directement des droits réels sur le bien indivis.
- Parce que la société est un contrat, elle procède toujours d’une démarche volontaire. Elle ne résulte jamais d’un cas fortuit comme c’est le cas pour l’indivision.
- Par ailleurs, à la différence de l’indivision qui est temporaire, la société est créée, la plupart du temps, pour perdurer dans le temps à tout le moins aussi longtemps que ses ressources le lui permettent.
- S’agissant de la gestion d’une société, elle est assurée par un ou plusieurs dirigeants sociaux, lesquels peuvent être distincts des associés.
- Ces derniers doivent, en tout état de cause, toujours agir dans la limite des prérogatives qui leur sont conférées par les statuts.
À l’analyse, si les formes de propriété collective sont multiples, elles ont pour point commun de correspondre à des situations où les droits des propriétaires sont tout à la fois partagés et individuels mais encore supportés collectivement sur un même bien ou une universalité de biens.
À cet égard, dans le cadre d’une propriété collective, chaque propriétaire détient une part du tout, et peut, dans une certaine mesure, se considérer comme propriétaire de l’ensemble. Toutefois, cette propriété ne se traduit pas par un démembrement des droits classiques de propriété, à savoir l’usus, le fructus et l’abusus, car tous ces attributs demeurent intégralement présents et sont exercés de manière conjointe par tous les propriétaires.
Cette situation est illustrée par le fait que chaque titulaire d’un droit sur le bien partagé a également une part individuelle, quoique abstraite, dans la propriété globale.
Cette part n’est pas une fraction matérielle du bien, mais plutôt une quote-part des droits de propriété. Dans le cadre de la copropriété, par exemple, cette quote-part se manifeste par la possession d’une partie spécifique du bien, comme un appartement dans un immeuble, tout en partageant la propriété des parties communes. Ainsi, chaque copropriétaire possède un droit réel et concret sur certaines parties de la propriété, tout en ayant un droit plus abstrait mais tout aussi légitime sur d’autres éléments qui sont gérés de manière collective.
Au fond, les régimes de propriété collective offrent une figure juridique où les droits individuels et collectifs coexistent de manière complexe, chacun contribuant à un ensemble plus grand tout en conservant une certaine autonomie individuelle.
Cette configuration requiert une gestion délicate pour équilibrer les intérêts collectifs avec les droits individuels, en assurant que chaque partie prenante puisse exercer son droit sans entraver celui des autres.
[1] Lexique des termes juridique, éd. Dalloz, 2001.