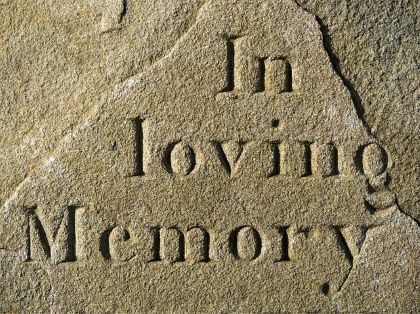Le conjoint survivant n’est pas seulement investi de droits qu’il tient de sa qualité d’héritier ab intestat, la loi lui reconnaît également des droits qu’il exerce contre la succession en sa qualité de créancier de la succession.
Ces droits de créance dont est titulaire le conjoint survivant contre la succession visent à assurer sa protection et sa subsistance future.
Au nombre de ces droits figurent :
- D’une part, un droit temporaire au logement
- D’autre part, un droit à pension alimentaire
A) Le droit temporaire au logement
La situation de vulnérabilité dans laquelle est susceptible de se trouver le conjoint survivant confronté à la faiblesse de ses droits successoraux en l’absence de libéralités stipulées à son profit peut précipiter son départ du foyer conjugal. Cette situation ajoute une souffrance matérielle à la douleur émotionnelle déjà intense, forçant le conjoint survivant à abandonner un environnement familial ancré dans ses habitudes de vie.
Pour pallier cette rupture abrupte et adoucir les conditions de cette transition douloureuse, il est apparu nécessaire pour le législateur, à l’occasion de la réforme du droit des successions intervenue en 2001, de lui fournir une protection.
À cette fin, a été introduite dans le Code civil une disposition – l’article 763 du Code civil – conférant au conjoint survivant, de plein droit et pendant une année, la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale.
Ce droit au logement, qui s’étend également aux meubles meublants, présente la particularité d’être temporaire, de sorte qu’il se distingue du droit d’usage et d’habitation de l’article 764 qui lui est viager.
Bien que ces deux droits ne se confondent pas, ils n’en ont pas moins été pensés pour être exercés de façon successive :
- Premier temps
- Le droit temporaire au logement garantit au conjoint survivant la jouissance de la résidence qu’il occupait au décès du défunt pendant une période d’un an à compter du décès
- Second temps
- Le droit viager d’usage et d’habitation prend le relais du droit temporaire au logement dans l’hypothèse où le conjoint survivant manifeste, dans le délai d’un an, sa volonté d’en bénéficier
Parce le droit temporaire au logement s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance, son régime juridique est très différent de celui auquel est soumis le droit viager de l’article 764.
1. Conditions
Il ressort de l’article 763 du Code civil que l’ouverture du droit temporaire au logement est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions qui tiennent :
- D’une part, à la personne du conjoint survivant
- D’autre part, au logement
==>Les conditions tenant à la personne du conjoint survivant
L’article 763 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit temporaire au logement est le « conjoint successible ».
Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès.
À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés.
Par ailleurs, parce que le droit temporaire constitue un effet direct du mariage (art. 763, al. 3 C. civ.), il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité.
Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité.
==>Les conditions tenant au logement
Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :
- Première condition
- L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit temporaire au logement, que du seul bien qu’il occupât, à l’époque du décès, « effectivement, à titre d’habitation principale »
- Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
- D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement
- D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui était occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569).
- S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. »
- Seconde condition
- L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
- En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
- Soit appartenir au seul défunt
- Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
- Est-ce à dire que lorsque l’une ou l’autre condition n’est pas remplie le conjoint survivant ne peut pas se prévaloir du droit temporaire au logement ?
- À cette question il y a lieu de répondre par la négative.
- Il est, en effet, indifférent que l’habitation du conjoint survivant soit assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt.
- L’alinéa 2 de l’article 763 du Code civil précise que dans l’une ou l’autre situation, « les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. »
- Que faut-il comprendre de cette disposition ?
- Il y a lieu de retenir que lorsque le conjoint survivant réside, soit dans une habitation louée à un tiers, soit dans un immeuble appartenant au de cujus en indivision avec un tiers, cela ne fait nullement obstacle à l’ouverture du droit temporaire au logement.
- La seule conséquence réside dans les modalités de réalisation de ce droit.
2. Modalités de réalisation
Les modalités de réalisation du droit temporaire au logement diffèrent selon que le conjoint survivant occupe un logement :
- Soit dépendant totalement de la succession
- Soit qui appartenait aux deux époux
- Soit qui appartenait au défunt en indivision avec un tiers
- Soit qui est loué à un tiers
==>Le logement occupé par le conjoint survivant dépend totalement de la succession
Cette hypothèse correspond à la situation où le logement était la propriété exclusive du défunt, raison pour laquelle il dépend totalement de la succession.
Ici, la réalisation du droit temporaire se traduira par l’occupation par le conjoint survivant, du logement pendant une période d’une année, sans que les héritiers ne puissent rien lui réclamer en contrepartie.
==>Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait aux deux époux
Cette hypothèse, correspond à l’hypothèse où le logement appartenait aux deux époux, soit dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre d’une indivision.
Ici, la réalisation du droit temporaire prend la forme d’un droit de créance qui correspond au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par le conjoint survivant au titre de la jouissance du bien indivis pendant un an.
==>Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait au défunt en indivision avec un tiers
Dans cette hypothèse, l’occupation par le conjoint survivant du bien indivis postérieurement au décès du défunt justifie qu’une indemnité d’occupation soit versée au tiers à proportion de sa quote-part indivise.
Parce que cette occupation intervient au titre du droit temporaire au logement, l’indemnité due au tiers devra être supportée par la succession.
==>Le logement occupé par le conjoint survivant est loué à un tiers
Dans cette hypothèse, la réalisation du droit temporaire au logement prend la forme d’un droit de créance qui donne lieu à la prise en charge, par la succession, de l’intégralité des loyers à verser par le conjoint survivant pendant une durée d’une année.
Pratiquement, cela implique que le conjoint survivant réclame le remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement.
3. Caractères
- Un droit constitutif d’un effet direct du mariage
- Le droit temporaire au logement reconnu au conjoint survivant est présenté par l’article 763, al. 3e du Code civil comme constituant un effet direct du mariage
- Il en résulte deux conséquences :
- Première conséquence
- Le droit temporaire au logement échoit, de plein droit, au conjoint survivant sans qu’il lui soit besoin d’en faire la demande comme c’est le cas pour le droit viager de l’article 764.
- Seconde conséquence
- Le droit temporaire au logement ne s’analyse pas en une libéralité, de sorte qu’il n’a pas vocation à être imputé sur la quote-part de la succession qui revient au conjoint survivant.
- Première conséquence
- Un droit personnel
- Le législateur a conçu le droit temporaire au logement comme un droit personnel et non comme un droit réel.
- Cela signifie que le conjoint survivant est dépourvu de tout pouvoir direct sur le logement qu’il occupe.
- Plus précisément, il est insusceptible de se prévaloir des prérogatives attachées aux droits d’usage et d’habitation visés aux articles 625 et suivants du Code civil.
- Le conjoint survivant est seulement titulaire d’un droit de créance qu’il peut exercer contre la succession.
- Pour cette dernière, il s’agit donc d’une dette, à inscrire au passif successoral, dont le règlement s’opère par la concession d’un droit de jouissance du logement au profit du conjoint survivant pendant la durée d’un an.
- Un droit d’ordre public
- En application de l’article 763, al. 4e du Code civil, le droit temporaire au logement présente un caractère d’ordre public.
- Il en résulte que le conjoint survivant ne saurait en être privé par voie de libéralité, ni même y renoncer par anticipation.
4. Extinction
Le droit au logement reconnu au conjoint survivant par l’article 763 du Code civil est un droit temporaire.
Comme précisé par cette disposition, il s’éteint à l’expiration d’un délai d’un un à compter du décès du défunt.
À cet égard, il s’agit d’un délai préfix de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption.
B) Le droit à pension alimentaire
==>Évolution
Dans le Code civil de 1804, le conjoint survivant n’était appelé à hériter qu’en absence d’héritiers jusqu’au douzième degré, sans qu’aucun autre droit ne soit institué à son profit.
Cette omission ne fut corrigée que par la loi du 9 mars 1891, qui instaura une créance alimentaire pour le conjoint survivant nécessiteux, intégrée à l’article 205 (ancien) du Code civil.
Cette disposition prévoyait que « la succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. ».
Le texte resta inchangé jusqu’à la loi du 3 janvier 1972, qui ne modifia que sa numérotation, devenant l’article 207-1 du Code civil.
La loi du 3 décembre 2001, qui a considérablement renforcé les droits du conjoint survivant, déplaça les règles régissant la pension alimentaire à l’article 767 du Code civil, lequel relève d’un titre consacré aux Successions.
Bien que l’essentiel du contenu de l’ancien article 207-1 ait été repris par le législateur en 2001, des modifications ont été apportées aux fins de renforcer le caractère successoral de cette créance alimentaire.
Dans le droit fil de cette évolution, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modernisé le vocabulaire de l’article 767, en remplaçant le terme « hérédité » par le mot « succession ».
Malgré ce changement de vocable, la nature de la pension comme créance alimentaire a été maintenue.
==>Nature
Le droit à pension alimentaire est d’abord et avant tout un droit de nature alimentaire.
Ce caractère est ancré dans le principe de solidarité familiale, visant à assurer la subsistance du conjoint survivant qui se trouve dans le besoin après le décès de son partenaire.
La pension alimentaire susceptible d’être octroyée au conjoint survivant est destinée à couvrir ses besoins essentiels de la vie quotidienne, comme l’alimentation, le logement, et les soins médicaux.
À cet égard, ce droit découle directement du devoir de secours qui existe entre les époux pendant la vie conjugale et se prolonge après le décès au travers de cette créance alimentaire contre la succession.
==>Caractères
Outre sa nature alimentaire, la créance instituée à l’article 767 du Code civil présente un caractère successoral marqué.
Ce caractère successoral se manifeste par le fait que la créance alimentaire est inscrite au passif de la succession, de sorte qu’elle doit être supportée par l’ensemble des héritiers à proportion de la quote-part qui leur revient.
Concrètement, cela signifie que la pension alimentaire doit être prélevée sur l’actif successoral, avant la répartition des biens du défunt entre les héritiers. La créance alimentaire prend alors une dimension patrimoniale, influençant la composition de la masse successorale à partager.
1. Les conditions d’ouverture du droit à pension alimentaire
a. Les conditions tenant au créancier
Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que pour se prévaloir du droit à pension alimentaire il faut justifier :
- D’une part, de la qualité de conjoint successible
- D’autre part, d’un état de besoin
==>La qualité de conjoint successible
L’article 767 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit à pension alimentaire est le « conjoint successible ».
Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès.
À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés.
Par ailleurs, parce que le droit à pension alimentaire consiste, non pas en un droit successoral, mais en un droit de créance, il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité.
Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité.
==>L’état de besoin
Pour être fondé à se prévaloir du droit à pension alimentaire, le conjoint survivant doit justifier être « dans le besoin » dit l’article 767, al. 1er du Code civil.
Autrement dit, il ne doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir seul à sa subsistance.
Cette impossibilité devra résulter de l’insuffisance des ressources personnelles du conjoint survivant (revenus du travail ou revenus du capital) quant à couvrir tout ou partie de ses besoins.
À cet égard, les besoins ne se limitent pas à l’alimentation ; ils s’étendent au logement, à l’habillement ou encore aux soins médicaux.
S’agissant du moment de l’appréciation du besoin, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 mars 1994 qu’il y a lieu de se situer au jour de l’ouverture de la succession, soit à la date du décès du défunt (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
==>L’indifférence de l’existence de manquements graves
La question s’est posée de savoir si en cas de manquement grave par le conjoint survivant à ses obligations envers le de cujus, il pouvait être déchu de son droit à pension alimentaire.
On pourrait le penser si l’on se reporte à l’article 207, al. 2e du Code civil qui prévoit que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Reste que cette disposition ne s’applique pas au devoir de secours entre époux. Or la créance alimentaire instituée à l’article 767 du Code civil n’en est que le prolongement.
Il en résulte que quand bien même le conjoint survivant aurait manqué gravement à ses obligations envers le défunt, il ne saurait être privé de son droit à pension.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 17 janvier 1995 aux termes duquel elle a jugé que « lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; que, cependant, cette faculté ne s’étend pas, sauf l’exception prévue par l’article 303, alinéa 2, du Code civil, au devoir de secours entre époux, dont l’obligation alimentaire pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation » (Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995, n°92-21.599).
Quid alors en cas de manquement grave aux obligations auxquelles est tenu le conjoint survivant envers les héritiers ?
Un tel manquement ne saurait là encore conduire à le déchoir de son droit à pension dans la mesure où ce ne sont pas les héritiers qui sont personnellement débiteurs de ce droit, mais la succession.
b. Les conditions tenant au débiteur
Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que le débiteur du droit à pension alimentaire n’est autre que la succession.
Pour rappel, ce texte prévoit que « la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin ».
La conséquence en est que les héritiers ne peuvent être obligés à régler une pension alimentaire au conjoint survivant que dans la limite de l’actif successoral ; ils ne sauraient répondre de cette dette sur leur patrimoine personnel.
Aussi, l’ouverture du droit à pension alimentaire dépend directement de la consistance de l’actif successoral net, soit déduction faite du passif successoral.
En cas d’absence de biens au décès du défunt, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’octroi d’aucune pension alimentaire.
À l’inverse, en présence d’éléments d’actifs, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 janvier 2019 que leur nature importait peu. Il est notamment indifférence que cet actif soit essentiellement constitué de droits indivis non mobilisables immédiatement (Cass. 1ère civ. 30 janv. 2019, n°18-13.526).
2. Le régime du droit à pension alimentaire
==>Délai pour exercer le droit à pension
- Fixation d’un délai
- L’article 767, al. 1er du Code civil prévoit que le délai imparti au conjoint survivant pour faire valoir son droit à pension alimentaire est d’un an.
- Ce délai commence à courir :
- Soit à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint.
- Soit, pour le cas où les héritiers auraient déjà versé des subsides au conjoint survivant à partir « du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint ».
- Prolongation du délai
- L’article 767, al. 1er prévoit que le délai pour exercer le droit à pension alimentaire se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
- Autrement dit, tant que le partage de la succession n’est pas réalisé, le conjoint survivant est autorisé à se prévaloir de son droit à pension.
- Le délai d’un an est donc prolongé autant que dure la situation d’indivision, sauf à ce que le conjoint survivant ne soit pas partie à cette indivision.
- Si l’indivision successorale ne concerne que les autres héritiers, alors la prolongation du délai d’un an n’a pas lieu de jouer.
- Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les dispositions de l’article 767 du Code civil selon lesquelles, en cas d’indivision, le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-71.840).
==>Modalités du droit à pension
- Absence d’imputation
- Parce que le droit à pension alimentaire institué au profit du conjoint survivant constitue une créance contre la succession, il ne vient pas en déduction de ses droits successoraux, il s’ajoute à eux.
- Autrement dit, le droit à pension s’additionne à la quote-part revenant à ce dernier.
- Il en résulte que le conjoint survivant est fondé à faire valoir sa créance d’aliments peu importe sa vocation légale, sauf à ce qu’il soit attributaire de la totalité de la succession en pleine propriété.
- La raison en est que le droit à pension ne peut être prélevé que sur la succession.
- Or lorsque celle-ci est recueillie dans son intégralité par le conjoint survivant, il n’y a plus rien à prélever, sinon sur sa propre part.
- Forme de la pension
- La pension alimentaire octroyée au conjoint survivant ne peut prendre qu’une seule forme : celle d’une rente versée périodiquement.
- Si le législateur avait, dans un premier temps, envisagé qu’elle puisse prendre la forme d’un capital, il a finalement abandonné cette idée.
- Montant de la pension
- Le montant de la pension est déterminé en fonction :
- D’une part, des besoins du conjoint survivant
- D’autre part, de ses ressources personnelles
- Le montant de la pension est déterminé en fonction :
==>La réalisation du droit à pension
L’article 767, al. 2e du Code civil prévoit expressément que la pension alimentaire est prélevée sur la succession.
Il en résulte deux principales conséquences :
- Première conséquence
- Le montant du droit à pension ne saurait excéder le montant de l’actif successoral net, lequel constitue l’assiette de ce droit.
- Cela signifie que :
- D’une part, les créanciers successoraux seront payés avant le conjoint survivant
- D’autre part, en cas d’absence d’actif successoral après désintéressement des créanciers, le conjoint survivant ne pourra faire valoir aucun droit à pension.
- Deuxième conséquence
- Le conjoint survivant n’est autorisé à poursuivre son droit à pension que sur les seuls biens composant la succession.
- La dette de pension n’est donc pas exécutoire sur le patrimoine personnel des héritiers.
- Troisième conséquence
- Parce que la pension alimentaire est prélevée sur la succession, elle est supportée, dit l’article 767, al. 2e du Code civil, par tous les héritiers à due proportion de la quote-part qui leur revient.
- Le texte précise que, dans l’hypothèse où la part revenant aux héritiers ab intestat serait insuffisante quant à couvrir le droit à pension, celui-ci doit alors être supporté par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
- Il est toutefois admis que le prémourant puisse décider que tel ou tel legs serait acquitté de préférence aux autres.
==>La révision du droit à pension
La question s’est posée de savoir si la pension alimentaire pouvait faire l’objet d’une révision, à la baisse ou à la hausse, en cas de modification de la situation du conjoint survivant.
Faute de réponse apportée par les textes, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 mars 1994 que la « pension est seulement susceptible d’être diminuée ou supprimée, dans le cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
Il se déduit de cette décision que, en cas de diminution des ressources du conjoint survivant ou d’augmentation de ses besoins, la pension ne peut faire l’objet d’aucune augmentation.