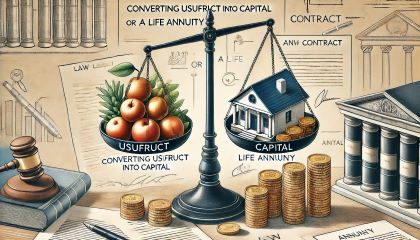L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.
L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.
En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier.
La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant.
Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.
Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.
Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.
Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.
Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.
Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.
I) La conversion de l’usufruit en rente viagère
==>Définition
L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.
Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.
Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers.
La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.
En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.
L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.
==>Domaine de la conversion
- Principe
- Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
- La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
- Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
- Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
- La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant en droit réel en droit personnel.
- En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
- En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
- Limite
- Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
- L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
- Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
- Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
- À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
- Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie.
==>Auteurs de la demande de conversion
Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.
Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.
À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.
La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.
==>La procédure de conversion
La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire.
- La conversion amiable
- En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
- Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
- À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
- S’agissant du montant de la rente
- Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
- La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
- La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
- Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
- Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
- Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
- Cette méthode est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens.
- S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
- Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
- Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
- Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèse, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome etc.)
- En tout état cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- S’agissant du montant de la rente
- La conversion judiciaire
- L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
- Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
- Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
- Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
- Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
- Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
- En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge.
- Sur les modalités de la rente
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
- D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
- Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
- Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
- Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable.
- Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
- Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950)
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
-
-
-
-
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai.
-
-
-
==>Effets
Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.
Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se limite à constater un droit préexistant.
L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.
En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.
Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.
Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.
Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.
Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :
- Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
- D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
- Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.
La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.
Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.
L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit.
II) La conversion de l’usufruit en capital
Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.
La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.
Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires.
La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458).
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital.
L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.
Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement.
Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.
À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit.
Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.
Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers.
Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage de sorte que :
- D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif.