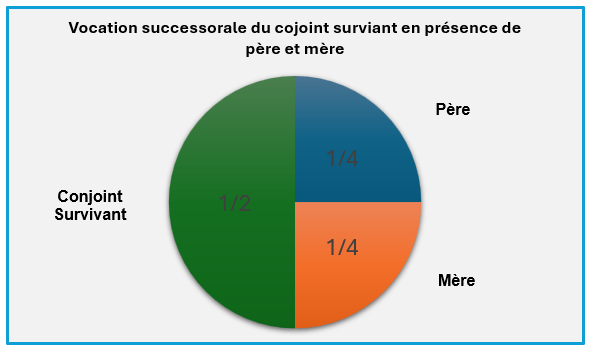==> Vue générale
Bien qu’il soit admis, aujourd’hui, que deux personnes puissent entreprendre une communauté de vie en dehors des liens du mariage, celui-ci demeure la seule forme d’union conférant à chacun de ses membres des droits dans la succession de l’autre.
Le concubinage, par exemple, s’il est certes désormais reconnu par le Code civil (art. 515-8), les concubins n’en restent pas moins regardés par la loi comme des étrangers l’un pour l’autre. La conséquence en est qu’ils ne s’auraient se prévaloir d’aucune vocation successorale.
Il en va de même pour les couples ayant opté pour la conclusion d’un PACS. Cette nouvelle forme d’union, instituée par la loi du 15 novembre 1999, ne confère aux partenaires que des droits limités.
Tout au plus, la loi reconnaît au partenaire survivant le droit d’occuper gratuitement, pendant une période d’un an, le logement qui servait de résidence principale au couple (art. 515-6, al. 3e C. civ.). Ce dernier se voit également conférer le droit de solliciter l’attribution préférentielle de certains biens (art. 515-6, al. 1er C. civ.).
Ces quelques avantages reconnus au partenaire survivant, s’ils lui procurent une situation préférable à celle du concubin, sont très éloignés des droits que le statut de conjoint confère à une personne mariée.
Le Code civil reconnaît, en effet, au conjoint survivant une véritable vocation successorale, soit une vocation à prendre part au partage du patrimoine du défunt.
==> Ancien droit
- Pays de droit écrit
- Sous l’influence du droit romain, les règles des pays de droit écrit conféraient au conjoint survivant, le plus souvent la femme, un certain nombre de droits dans la succession.
- L’un de ces droits était appelé la « quarte du conjoint pauvre ».
- Ce droit reconnu à la veuve, lui permettait, si elle se trouvait dans une situation de précarité financière après le décès de son époux, de réclamer jusqu’à un quart de la succession de son défunt mari.
- La « quarte » était calculée sur la base de la valeur totale de la succession après règlement des dettes.
- À cet égard, la veuve se voyait reconnaître un droit prioritaire sur les autres héritiers pour ce quart de la succession, garantissant ainsi que son sort ne dépende pas de la générosité des autres héritiers ou du solde restant de la succession après règlement des dettes.
- Pays de droit coutumier
- En contraste avec le droit écrit, le droit coutumier, reconnaissait à la femme mariée au décès de son époux ce que l’on appelait le douaire.
- Le douaire était un droit d’usufruit accordé à la veuve sur une partie des immeubles du défunt mari.
- Ce droit était généralement limité à la durée de vie de la veuve, et ne pouvait être transmis à ses héritiers.
- Le douaire remplissait plusieurs fonctions :
- Protection économique de la veuve : il garantissait à la veuve un logement et une source de revenus (par exemple, à travers les loyers ou les produits de la terre) après le décès de son mari. Cela était particulièrement important dans une société où les femmes pouvaient difficilement exercer librement une activité professionnelle.
- Préserver les biens fonciers dans la famille : en limitant l’usufruit au temps de vie de la veuve, le douaire assurait que les biens fonciers reviendraient aux héritiers directs du défunt, souvent les enfants, après le décès de la veuve. Cela contribuait à maintenir la continuité patrimoniale et économique de la famille.
- Aspect social et familial : le douaire exprimait également un engagement social et familial, reconnaissant la contribution de la veuve à la famille durant son mariage, et lui assurant une position respectée et sécurisée dans la famille élargie après la mort de son mari.
==> Révolution
Entre 1790 et 1793, plusieurs réformes ont été conduites aux fins de modifier en profondeur le droit des successions. Ces réformes visaient principalement à assurer une égalité des droits entre les citoyens en abolissant les privilèges de la noblesse et du clergé.
Durant cette période, les avantages spécifiquement accordés au conjoint survivant, tels que la « quarte du conjoint pauvre » et le douaire, ont été supprimés. Ces avantages étaient perçus par les révolutionnaires comme des vestiges de l’ancien régime féodal où certains groupes sociaux bénéficiaient de droits supérieurs sur la base de leur statut ou de leur genre.
La suppression de ces droits a eu une incidence directe sur la situation financière des femmes, qui se retrouvaient, au décès de leur mari, sans protection juridique face aux héritiers en ligne directe, les liens du sang présidant à la dévolution successorale.
Cette situation rendait ainsi les veuves totalement dépendantes des dispositions testamentaires ou de la bonne volonté des héritiers.
==> Code Napoléon
Nonobstant les critiques formulées à l’encontre des lois révolutionnaires, le Code civil de 1804 n’a que très peu amélioré le sort du conjoint survivant.
Tout au plus, l’ancien article 767 reconnaissait au conjoint survivant le droit d’hériter des biens du défunt que dans le cas où ce dernier ne laissait aucun parent jusqu’au douzième degré inclus.
Cette disposition révèle une vision des rédacteurs du Code civil de la famille fondée essentiellement sur les liens de sang, où la priorité était donnée à la transmission des biens dans la lignée biologique directe ou collatérale élargie.
À cet égard, la condition posée par l’article 767 était si restrictive qu’elle rendait presque illusoire le droit du conjoint à hériter directement de son époux ou épouse.
En effet, la probabilité qu’il n’existe aucun parent jusqu’au douzième degré était extrêmement faible, ce qui signifie que dans la plupart des cas, le conjoint survivant était effectivement exclu de la succession directe.
En limitant de manière si stricte les droits du conjoint survivant, le Code civil ignorait les besoins de protection et de sécurité économique qui pourraient échoir au conjoint après le décès du défunt, en particulier dans un contexte où les autres formes de soutien social ou familial pouvaient ne pas être disponibles.
Cette approche a été vivement critiquée pour son manque de compassion et de réalisme, étant donné les implications pratiques pour les conjoints survivants souvent laissés dans la précarité. Cette situation, jugée par beaucoup peu satisfaisante, a conduit le législateur à intervenir dès la fin du XIXe siècle.
==> Loi du 9 mars 1891
La loi du 9 mars 1891 constitue une nouvelle étape dans l’évolution du droit des successions, marquant une rupture significative avec les dispositions très restrictives antérieures en matière de droits du conjoint survivant.
Cette loi a introduit un changement profond en reconnaissant le droit d’usufruit du conjoint survivant sur la succession du défunt, ajusté selon la proximité des parents concurrents.
En effet, avant l’adoption de cette loi, le conjoint survivant était largement désavantagé dans la succession, ne recevant des droits que dans des circonstances très limitées.
La loi de 1891 rompt avec l’approche classique en reconnaissant au conjoint survivant une vocation successorale en usufruit, c’est-à-dire le droit d’utiliser et de tirer profit des biens de la succession pendant sa vie, la nue-propriété revenant aux parents par le sang.
L’étendue de l’usufruit octroyé au conjoint survivant dépendait de la proximité des autres héritiers présents dans la succession avec le de cujus.
Plus les parents concurrents étaient éloignés, plus l’usufruit attribué au conjoint était étendu. Ce dispositif réalisait un équilibre entre la protection du conjoint survivant et les droits des héritiers par le sang.
La doctrine souligne que la loi du 9 mars 1891 illustre une évolution de la perception du conjoint survivant dans la famille et la société. Le passage d’une vision où le conjoint est presque un étranger dans la succession à une reconnaissance de son rôle essentiel et de son besoin de protection économique après le décès du défunt marque un changement significatif dans l’approche du législateur.
En offrant un usufruit au conjoint survivant, la loi renforce ainsi la sécurité financière de ce dernier et reconnaît sa contribution à la constitution du patrimoine familial. Cela contribue également à maintenir une certaine continuité dans la gestion des biens familiaux, évitant une rupture brutale qui pourrait survenir si tous les biens étaient transférés immédiatement à d’autres héritiers.
Bien que la loi ait été un progrès notable, elle n’était toutefois pas exempte de critiques. Par exemple, l’usufruit peut parfois créer des tensions entre le conjoint survivant et les héritiers directs, particulièrement quand il s’agit de la gestion ou de la vente des biens. Ces défis ont nécessité des ajustements et des clarifications ultérieures dans la jurisprudence et les lois postérieures.
au cours des siècles suivants, où les législateurs ont progressivement élargi les droits successoraux du conjoint survivant, reconnaissant leur rôle central dans la famille et leur vulnérabilité potentielle en l’absence de leur partenaire.
==> Lois des 3 décembre 1930 et 26 mars 1957
Dans les années 1930, la société française commençait à subir des transformations importantes. La législation en vigueur n’était plus en adéquation aux réalités sociales, notamment en ce qui concerne la protection des conjoints survivants.
C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la loi du 3 décembre 1930. Jusqu’à l’adoption de cette loi, le conjoint survivant ne se voyait reconnaître des droits en pleine propriété dans la succession qu’en l’absence de parent successible en degré.
La loi du 3 décembre 1930 a mis fin à cette situation en attribuant au conjoint survivant la moitié de la succession en pleine propriété pour le cas où le défunt laisserait derrière lui des parents ou des collatéraux dans une seule ligne.
La loi du 26 mars 1957, quant à elle, va encore plus loin en attribuant au conjoint survivant :
- La totalité de la succession en pleine propriété pour le cas où le défunt ne laisserait derrière lui que des collatéraux
- La moitié de la succession en pleine propriété pour le cas où le défunt laisserait derrière lui des ascendants dans une branche et des collatéraux dans l’autre branche
==> Loi du 3 janvier 1972
Pour mémoire, avant l’adoption de la loi du 3 janvier 1972, les enfants adultérins étaient souvent exclus de la succession ou avaient des droits très limités par rapport aux enfants légitimes.
Cette discrimination était fondée sur des considérations morales et sociales qui distinguaient les enfants selon les circonstances de leur naissance.
La loi du 3 janvier 1972 a aboli ces distinctions, en traitant tous les enfants de manière égale devant la loi, quelle que soit la nature de leur filiation.
En introduisant les enfants adultérins dans l’équation successorale, il en est résulté mécaniquement une augmentation du nombre de prétendants à la succession, ce qui était susceptible d’avoir pour effet de diminuer la part disponible pour le conjoint survivant, surtout dans les familles où les ressources étaient limitées.
Conscient que l’instauration du principe d’égalité des filiations pourrait défavoriser le conjoint survivant dans certaines configurations familiales, le législateur a prévu dans la loi du 3 janvier 1972 un certain nombre de mesures correctrices. L’objectif recherché était de s’assurer que le conjoint ne serait pas indûment lésé par cette nouvelle répartition des droits successoraux.
À cet égard, la loi prend en compte des situations où le conjoint survivant pourrait se retrouver en concurrence avec des enfants adultérins, qui, sans l’adoption de la nouvelle loi, n’auraient peut-être pas participé à la succession. Pour ces cas, des dispositions sont mises en place pour protéger les intérêts économiques et la sécurité du conjoint survivant.
L’ancien article 759 du Code civil, issu de la loi du 3 janvier 1972, disposait ainsi que les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n’excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée.
En pareil cas, ils ne recevront, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.
==> Lois du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006
Les lois des 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 ont marqué une étape décisive dans l’évolution des droits reconnus au conjoint survivant dans la succession.
Le législateur s’est, ni plus ni moins, fixé pour objectif que de « donner au conjoint survivant des droits qui reflètent la place qu’il occupait dans la vie du défunt ».
La poursuite de cette ambition s’est traduite par le renforcement significatif des droits du conjoint survivant dans la succession.
Désormais, en présence d’enfants communs, le conjoint survivant reçoit, au choix, le quart de la succession en pleine propriété ou la totalité de la succession en usufruit. En présence d’enfants d’un premier lit, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’à un quart en pleine propriété.
En l’absence de descendants et en présence des père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié de la succession, les trois quarts si un seul survit. Quant aux frère et sœur, le conjoint survivant prime sur ces derniers en cas de concours. Il en va de même en présence d’ascendants ordinaires ou de collatéraux ordinaires.
Outre la part de la succession dévolue au conjoint survivant, il lui est reconnu, sous certaines conditions, un droit viager au logement dans le lieu où le couple avait établi sa résidence principale.
À l’analyse, les réformes opérées par les lois du 3 décembre 2001 et 23 juin 2006 ont instauré une véritable vocation successorale à la faveur du conjoint survivant, celui-ci se voyant octroyer une place de choix dans l’ordre de la dévolution légale.
À cet égard, une section entière du Code civil est consacrée à cette vocation successorale du conjoint survivant, laquelle est désormais régie aux articles 756 à 767.
§1: Les conditions de reconnaissance de la qualité de conjoint successible
Pour prétendre à la vocation successorale attachée à la qualité de conjoint successible, encore faut-il justifier de cette qualité.
À cet égard, l’article 732 du Code civil prévoit que « est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé. »
Il ressort de cette disposition que pour se prévaloir de la qualité de conjoint successible, il faut être uni par les liens du mariage avec le défunt au jour de l’ouverture de la succession.
Autrement dit, seules les personnes dont le mariage est toujours en cours au moment du décès du défunt sont admises à hériter du de cujus en qualité de conjoint.
Cette exigence, posée par l’article 732 du Code civil, conduit à dénier toute vocation successorale à des personnes qui seraient susceptibles de se prévaloir de la qualité de conjoint au titre de certaines situations passées ou futures.
I) Les situations matrimoniales n’ouvrant pas droit à la vocation successorale
==> Le divorce
Parce que le divorce a pour effet de dissoudre le mariage, lorsqu’il est prononcé avant le décès du de cujus, il fait obstacle à ce que l’ex conjoint survivant se prévale de tout droit dans la succession.
À cet égard, l’article 732 du Code civil prévoit expressément que pour endosser la qualité de conjoint successible, il faut être « non divorcé ».
Dans un arrêt du 30 juin 1998, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’époux divorcé n’est pas appelé à la succession de son ex-conjoint » (Cass. 1ère civ. 30 juin 1998, n°96-13.922).
La question qui alors se pose est de savoir quelle date retenir ? À partir de quand le divorce produit-il ses effets et plus précisément à partir de quelle date le mariage est-il réputé dissout ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article 260 du Code civil qui prévoit que le mariage peut être dissous :
- Soit par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats
- Soit par une décision de justice qui prononce le divorce
Aussi, selon que le divorce procède d’une convention ou d’une décision, sa date de prise d’effet diffère :
- Lorsque le divorce procède d’une convention, il y a lieu de retenir la date à partir de laquelle la convention de divorce acquiert force exécutoire
- Lorsque le divorce procède d’une décision, il convient de revenir la date à partir de laquelle la décision prend force exécutoire, soit devient définitive
En tout état de cause, tant que l’une ou l’autre date n’est pas survenue, les époux demeurent unis par les liens du mariage, de sorte que le conjoint survivant conserve sa vocation successorale quand bien même celui-ci était séparé de fait avec le défunt au jour de son décès.
La séparation de fait n’a, en effet, aucune incidence sur le droit à hériter du conjoint survivant.
==> Le mariage nul
En ce que le mariage comporte une dimension contractuelle, il est envisagé par le législateur comme un acte juridique.
À ce titre, la violation de ses conditions de formation est sanctionnée par la nullité. Lorsqu’elle est prononcée, la nullité a pour effet d’anéantir le mariage.
Ainsi, cette sanction met-elle fin à l’union conjugale, au même titre que le divorce. Il s’en déduit que la nullité du mariage prive le conjoint survivant de toute vocation successorale.
Il peut être observé que, contrairement au divorce, il est indifférent que la nullité du mariage survienne antérieurement ou postérieurement au décès du défunt.
En effet, le principal effet de la nullité c’est la rétroactivité. Par rétroactivité il faut entendre que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Cela signifie que le mariage est anéanti, tant pour ses effets futurs que pour ses effets passés.
Dans la mesure où le mariage aura nécessairement reçu un commencement d’exécution, son annulation suppose de revenir à la situation antérieure, soit au statu quo ante.
Il en résulte que lorsque la nullité est prononcée postérieurement au décès du de cujus, elle a pour effet d’anéantir tous les effets du mariage, ce qui inclut la vocation successorale du conjoint survivant.
Celui-ci se voit dès lors rétroactivement déchu de son droit à hériter et doit, par conséquent, restituer tous les biens qui lui ont été attribués.
Par exception, il est admis que le conjoint puisse conserver son droit à hériter dans l’hypothèse où le mariage est reconnu comme putatif.
L’article 201 du Code civil prévoit que « le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l’égard des époux, lorsqu’il a été contracté de bonne foi. »
Il ressort de cette disposition que le mariage putatif opère, à la seule et unique condition que les époux soient de bonne foi.
La bonne foi consiste pour un époux en l’ignorance de l’existence de la cause de nullité du mariage au jour de la célébration.
Dans l’hypothèse où le conjoint survivant parviendrait à démontrer sa bonne foi, il pourra prétendre à ce que les effets passés du mariage soient maintenus à son profit.
Il ne sera dès lors pas privé de la vocation successorale qu’il avait acquise avant l’annulation du mariage.
==> Le mariage posthume
Il est admis en droit français, sous réserve de l’observation de conditions très strictes, qu’un mariage puisse être contracté avec une personne décédée. C’est ce que l’on appelle le mariage posthume.
Pour mémoire, conformément à l’article 171 du Code civil trois conditions doivent être réunies pour qu’un mariage posthume soit célébré :
- Une demande de mariage doit avoir été faite avant le décès de l’un des futurs époux, et il doit exister des preuves claires que la personne décédée avait l’intention de se marier ;
- Le consentement de la personne décédée doit être clairement établi et la demande de mariage doit être suffisamment avancée (par exemple, la publication des bans).
- Le Président de la République doit autoriser le mariage, après avoir reçu une demande motivée généralement soumise par le conjoint survivant.
Lorsque ces conditions sont satisfaites et que le mariage posthume est célébré, l’article 171, al. 2e du Code civil fait remonter ses effets « à la date du jour précédant celui du décès de l’époux. »
Est-ce à dire que le conjoint survivant est admis à se prévaloir de la vocation successorale prévue par l’article 756 du Code civil ?
Le troisième alinéa de l’article 171 l’exclut expressément. Cette disposition énonce, en effet, que lorsqu’il est posthume, le mariage « n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant ».
Ainsi, quand bien même la loi fait produire au mariage posthume des effets antérieurement au décès du de cujus, cette fiction ne joue pas pour la vocation successorale du conjoint survivant qui est privé de tout droit à hériter.
II) Cas particulier de la séparation de corps
La séparation de corps représente une alternative au divorce. Elle permet, en effet, aux époux de suspendre leur cohabitation tout en restant légalement mariés.
Régie par les articles 296 à 308 du Code Civil, la séparation de corps peut être initiée dans les mêmes conditions que le divorce (articles 296 et 298 du Code Civil) et suit généralement les mêmes étapes procédurales (article 1129 du Code de Procédure Civile).
Si la séparation de corps suspend l’obligation de cohabitation, elle ne met en revanche pas fin au mariage (art. 299 C. civ.). Autrement dit, la séparation de corps opère seulement un relâchement du lien conjugal et non une dissolution du mariage.
Il s’en déduit que la séparation de corps n’affecte pas la vocation successorale du conjoint survivant qui donc demeure investi du droit d’hériter du défunt.
Cette règle est exprimée à l’article 301 du Code civil qui prévoit que « en cas de décès de l’un des époux séparés de corps, l’autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant ».
En cas toutefois de séparation de corps initiée sur demande conjointe des époux, ils sont autorisés à renoncer à leurs vocations successorales respectives.
L’article 301 précise en ce sens que « en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766. »
Pour que la renonciation des époux séparés de corps à leurs droits successoraux produise ses effets, elle doit être réciproque.
Par ailleurs, comme énoncé par le texte, la renonciation ne peut porter que sur les droits visés aux articles 756 à 757-3 et 764 à 766 du Code civil soit les droits dans la succession.
Cela signifie a contrario que les époux ne peuvent pas renoncer à leurs droits contre la succession, tels que le droit annuel au logement ou le droit à une pension alimentaire.
§2: Les droits du conjoint successible
I) Les droits du conjoint successibles dans la succession
La loi reconnaît au conjoint survivant deux droits distincts dans la succession :
- Un droit à une quote-part ou à la totalité de la succession
- Un droit viager au logement
A) Le droit à une quote-part ou à la totalité de la succession
La loi du 3 décembre 2001 a marqué un tournant décisif dans le droit des successions en renforçant significativement la position du conjoint survivant.
Pour mémoire, avant cette réforme, la situation du conjoint survivant était souvent précaire, surtout en l’absence de dispositions testamentaires en sa faveur.
Il bénéficiait d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement familial et d’un droit temporaire sur le mobilier, mais ses droits en propriété étaient limités, surtout si le défunt laissait des descendants ou d’autres héritiers réservataires.
La loi du 3 décembre 2001 a introduit des dispositions nettement plus favorables pour le conjoint survivant. Désormais, le Code civil reconnaît au conjoint survivant une véritable vocation successorale en propriété.
L’étendue de cette vocation successorale dépend toutefois des parents laissés par le de cujus.
1. L’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant en propriété
L’étendue de la vocation successorale du conjoint survivant en propriété dépend donc des parents laissés le de cujus derrière lui.
La loi distingue plusieurs situations de concours :
- La vocation du conjoint survivant en présence de descendants
- La vocation du conjoint survivant en présence des père et mère
- La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires
1.1. La vocation du conjoint survivant en présence de descendants
Il s’infère de l’article 757 du Code civil que, en présence de descendants, les droits reconnus au conjoint survivant diffèrent selon que tous les enfants du défunt sont issus des deux époux et selon qu’il en est un ou plusieurs qui ne sont pas issus du même lit.
a. Tous les enfants sont issus des deux époux
==> La reconnaissance d’une option
L’article 757 du Code civil énonce que, en présence de descendants et lorsque tous les enfants sont issus des deux époux « le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Cette disposition confère ainsi au conjoint survivant le droit de choisir entre :
- Soit l’attribution du quart de la succession en pleine propriété
- Soit l’attribution de l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession
Le droit d’opter consenti au conjoint survivant est alternatif, en ce sens que celui-ci doit choisir entre l’une ou l’autre option ; il ne dispose pas de la faculté de cumuler les deux.
Surtout, l’option n’est ouverte qu’à la condition, précise le texte, que « tous les enfants [soient] issus des deux époux ».
Autrement dit, il doit s’agir des enfants que le de cujus et le conjoint survivant ont eus en commun.
À cet égard, il est indifférent que les enfants soient nés pendant le mariage de ces derniers. Ce qui compte, c’est que les enfants aient tous pour père et mère le défunt et le conjoint survivant et donc qu’ils soient leurs héritiers présomptifs.
Ce n’est que si cette condition est remplie que l’option énoncée à l’article 757 est ouverte au conjoint survivant.
Cette option offre une certaine flexibilité au conjoint survivant pour adapter ses droits successoraux à ses besoins financiers et à sa situation personnelle.
Par exemple, l’usufruit de la totalité de la succession peut lui garantir un logement et des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins, surtout s’il est âgé ou dépendant financièrement du défunt.
En même temps, cette option assure une protection minimale des droits des descendants du défunt en limitant les droits successoraux du conjoint survivant à un quart en pleine propriété ou à l’usufruit de la totalité des biens.
Cela évite que le conjoint survivant n’obtienne une part disproportionnée de la succession au détriment des descendants du défunt, en particulier si ces derniers sont mineurs ou ont besoin de ces biens pour assurer leur propre subsistance.
==> Les modalités d’exercice de l’option
- Titulaire de l’option
- L’option est strictement personnelle au conjoint survivant.
- Cela signifie que seul le conjoint survivant a le droit d’exercer cette option et de choisir entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens composant la succession.
- Les enfants du défunt ou d’autres héritiers n’ont pas le pouvoir d’opter à la place du conjoint survivant.
- Cela garantit que la décision concernant les droits successoraux du conjoint survivant est prise par lui-même, en fonction de ses propres besoins et de sa situation personnelle.
- Délai d’exercice de l’option
- En principe, l’exercice de l’option reconnue au conjoint survivant n’est enfermé dans aucun délai.
- Il en résulte qu’il peut, s’il le souhaite, se laisser le temps de la réflexion jusqu’aux opérations de partage de la succession.
- L’absence de délai d’exercice de l’option ne joue toutefois qu’à la condition que le conjoint survivant ne soit pas invité par les héritiers à opter.
- L’article 758-3 du Code civil prévoit, en effet, que « tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d’avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. »
- Il ressort de cette disposition que lorsque le conjoint survivant est enjoint par un héritier à opter, il dispose d’un délai de trois mois pour exprimer son choix.
- L’article 1341 du Code de procédure civile précise que l’invitation du conjoint survivant à exercer l’option doit être réalisée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- Le délai de trois mois dont dispose le conjoint survivant court à compter de la réception de l’invitation.
- À l’analyse, en imposant un délai pour répondre, cela permet un règlement de la succession plus rapide, évitant ainsi les situations d’indécision prolongée qui peuvent paralyser l’administration des biens mais également prévenir tout manœuvre dilatoire.
- À cet égard, le texte précise que dans l’hypothèse où le conjoint survivant n’exercerait pas son option dans les trois mois, il « est réputé avoir opté pour l’usufruit ».
- La règle est la même en cas de décès du conjoint survivant avoir d’avoir pu exercer son option.
- L’article 758-4 du Code civil dispose en ce sens que « le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. »
- En réputant le conjoint survivant avoir opté pour l’usufruit, la loi favorise les héritiers avec lesquels il était en concours dans la mesure où l’usufruit est en droit viager et que, à ce titre, il a vocation à revenir aux nus-propriétaires qui ne sont autres que les descendants du de cujus.
- Par ailleurs, cette règle vise à garantir que les biens demeurent au sein de la famille de l’époux prédécédé et de prévenir les conflits qui pourraient résulter de l’entrée en indivision avec les enfants du conjoint survivant issus d’une union antérieure.
- Forme de l’option
- L’option doit être exercée de façon claire et non équivoque.
- Le conjoint survivant peut exprimer son choix par écrit, généralement en déposant une déclaration d’option auprès, par exemple, du notaire en charge du règlement de la succession.
- Cette déclaration doit être faite dans les délais impartis et doit préciser de manière précise le choix du conjoint survivant entre le quart en pleine propriété et l’usufruit de la totalité des biens de la succession.
- Il est toutefois admis que l’option puisse être exercée tacitement.
- Le choix du conjoint survivant pourra se déduire, par exemple, par l’accomplissement d’un acte d’aliénation d’un bien de la succession, ce qui suggérerait que le choix aurait été fait d’opter pour le quart en pleine propriété.
- À l’inverse, on pourra déduire de l’encaissement et de la consommation des revenus par le conjoint survivant sa volonté d’opter pour l’usufruit.
- En tout état de cause, l’article 758-2 du Code civil prévoit que « l’option du conjoint entre l’usufruit et la propriété se prouve par tout moyen. »
- Intransmissibilité de l’option
- L’article 758-1 du Code civil prévoit que « lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l’usufruit, ses droits sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option. »
- Cela signifie que le conjoint ne peut ni vendre, ni donner, ni transférer de quelque manière que ce soit ses droits sur la succession avant d’avoir fait connaître sa décision.
- Cette règle protège le conjoint survivant contre la pression éventuelle d’autres héritiers ou de tiers désireux de s’approprier ou de bénéficier des droits successoraux avant que le conjoint n’ait eu l’opportunité de choisir de manière informée et délibérée.
- À cet égard, pour une partie de la doctrine, l’intransmissibilité du droit d’option fait obstacle à ce que les tiers, et plus précisément des créanciers, puissent opter en lieu et place du conjoint survivant au moyen de l’action oblique[1].
- D’autres auteurs soutiennent toutefois le contraire en convoquant l’article 815-17, al. 3 du Code civil qui confère aux créanciers « la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui »[2].
- À ce jour, la question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation.
- Caractère supplétif de l’option
- La règle conférant au conjoint survivant un droit d’option en présence d’enfants communs n’est pas d’ordre public.
- Il en résulte que le de cujus est libre d’écarter cette option en attribuant à son conjoint, par voie de testament, soit le quart de la succession en pleine propriété, soit l’usufruit sur la totalité de ses biens.
b. Tous les enfants ne sont pas issus des deux époux
L’article 757 du Code civil prévoit que « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille […] la propriété du quart [des biens] en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Il ressort de cette disposition que, en présence d’enfants non communs, soient d’enfants qui ne sont pas issus du couple formé entre le défunt et le conjoint survivant, ce dernier ne dispose d’aucune option : la loi lui attribue d’office le quart de la succession en pleine propriété.
Il suffit qu’un seul enfant ne soit pas commun aux deux époux pour que le conjoint survivant soit privé de la faculté d’opter. Cet enfant peut être né d’une première union ou être né pendant le mariage dans le cadre d’une relation adultérine.
Ce qui importe, c’est qu’il est au moins un enfant qui, d’une part, soit appelé à la succession du défunt et, d’autre part, qu’il soit issu d’un autre lit. Si l’une ou l’autre condition n’est pas remplie, alors le conjoint survivant conserve le bénéfice de l’option successorale.
La suppression de l’option en présence d’enfants non communs aux époux vise notamment à protéger les intérêts patrimoniaux de ces derniers.
En effet, autoriser le conjoint survivant à opter pour l’usufruit serait susceptible à priver de façon déraisonnable les enfants issus d’une précédente union de leur droit à jouir pleinement de la quote-part des biens qui leur revient, puisque devant attendre l’extinction de l’usufruit. Or cette extinction n’intervient qu’au décès du conjoint survivant lequel peut ne survenir que très tardivement en raison de son jeune âge.
Aussi, afin de ne pas les priver durablement de l’usufruit de leur réserve, le législateur a-t-il décidé en 2001 de ne laisser aucun choix au conjoint survivant : il se voit attribuer de plein droit le quart de la succession en pleine propriété.
Reste que cette règle n’est pas d’ordre public. Le défunt peut y avoir dérogé en prévoyant le contraire dans un testament.
Il est, en effet, admis que le de cujus puisse décider, par voie de testament, d’attribuer à son conjoint l’usufruit universel de l’ensemble de ses biens.
1.2. La vocation du conjoint survivant en présence de père et mère
En application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.
À cet égard, le texte distingue deux situations :
- Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dit l’article 757-1 « recueille la moitié des biens ».
- Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. »
- Le défunt laisse derrière un seul de ses père et mère
- L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
- Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.
1.3. La vocation du conjoint survivant en présence de collatéraux privilégiés
==> Principe
L’article 757-2 du Code civil prévoit que « en l’absence d’enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession. »
Ainsi, dans cette configuration, le conjoint survivant devient l’unique héritier légal, y compris en présence de collatéraux privilégiés qui, sauf disposition testamentaire contraire, se retrouvent exclus de la succession.
L’article 757-3 tempère toutefois cette exclusion des frère et sœur ou de leurs descendants en leur reconnaissant un droit de retour légal
==> Tempérament
L’article 757-3 du Code civil prévoit que « par dérogation à l’article 757-2, en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et soeurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. »
Il ressort de cette disposition que lorsque le défunt laisse derrière lui des collatéraux privilégiés, ces derniers ne sont pas totalement exclus de la succession.
La loi leur attribue certains biens spécifiques ; il s’agit de ceux « que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession ».
Plusieurs conditions doivent donc être réunies pour que les collatéraux privilégiés viennent en concours avec le conjoint survivant :
- Première condition
- Les biens dévolus légalement au conjoint survivant ne peuvent être que ceux reçus par le défunt de ses ascendants
- Deuxième condition
- Les biens concernés doivent avoir été transmis au défunt, soit par voie de donation, soit par voie de testament.
- Il ne peut donc pas s’agir de biens acquis à titre onéreux.
- Troisième condition
- Pour être dévolus aux collatéraux privilégiés, les biens doivent se retrouver en nature dans la succession, ce qui signifie qu’ils ne doivent pas avoir été aliénés.
- En pareil cas, les collatéraux privilégiés ne pourront pas prétendre recevoir le produit de leur cession.
Ce n’est que lorsque ces trois conditions sont réunies que les collatéraux privilégiés peuvent se retrouver en concours avec le conjoint survivant.
Ils sont alors fondés à réclamer, dit le texte, à la moitié des biens qui ont été transmis au défunt à titre gratuit par des ascendants.
En reconnaissant aux collatéraux privilégiés un droit de retour légal sur certains biens, l’article 757-3 du Code civil institue une succession que l’on qualifie d’anomale.
1.4. La vocation du conjoint survivant en présence d’ascendants ou de collatéraux ordinaires
a. En présence d’ascendants ordinaires
==>Principe
En application de l’article 752-2 du Code civil, en l’absence de descendants ou des père et mère du de cujus, le conjoint survivant a vocation à recueillir la totalité de la succession, à l’exclusion des autres ascendants, tels que les grands-parents ou les arrière-grands-parents.
Tous les ascendants au-delà du 2e degré sont donc exclus de la succession en présence d’un conjoint survivant.
Ces derniers ne sont toutefois pas laissés sans rien. La loi institue à leur profit une créance d’aliments contre la succession.
==>Tempérament
- Reconnaissance d’un droit de créance d’aliments contre la succession
- L’article 758, al. 1er du Code civil prévoit que « les ascendants du défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le besoin bénéficient d’une créance d’aliments contre la succession du prédécédé. »
- Plusieurs enseignements peuvent être retirés de cette disposition
- Premier enseignement
- La créance d’aliments contre la succession ne peut être réclamée que par les ascendants à partir du 2e degré, soit les ascendants ordinaires.
- Les père et mère ne peuvent pas prétendre à l’octroi de cette créance.
- Deuxième enseignement
- L’octroi d’une créance d’aliments aux ascendants ordinaires n’est pas automatique.
- Pour y prétendre, ces derniers doivent justifier d’être « dans le besoin » dit l’article 758.
- Au sens de cette disposition être « dans le besoin » signifie que l’ascendant concerné ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour couvrir ses besoins vitaux, y compris nourriture, logement, soins médicaux et autres nécessités essentielles.
- La détermination de l’état de besoin prend en compte l’ensemble des ressources disponibles pour l’ascendant, y compris ses revenus, épargnes, et autres actifs, ainsi que ses dépenses courantes et ses obligations financières.
- Premier enseignement
- Exercice du droit de créance d’aliments contre la succession
- L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :
- Soit du décès du défunt
- Soit du moment à partir duquel les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant aux ascendants.
- Le texte précise que le délai peut se prolonger, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
- Il peut être observé que la créance d’aliment reconnue aux ascendants ordinaire est en droit de créance qui s’exerce, non pas contre le conjoint survivant, mais contre la succession.
- C’est la raison pour laquelle la pension octroyée à l’ascendant concerné est prélevée sur la succession.
- Elle est alors supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
- L’alinéa 4 de l’article 758 prévoit toutefois que le de cujus dispose de la faculté de déclarer que tel ou tel legs aura la préférence, en ce sens qu’il ne supportera le poids de la dette que si les autres legs ne suffisent pas à y répondre.
- L’article 758, al. 2e du Code civil prévoit que le délai pour réclamer la créance d’aliments est d’un an à partir :
b. En présence de collatéraux ordinaires
Conformément à l’article 757-2 du Code civil, en présence de collatéraux ordinaires, le conjoint survivant recueille la totalité de la succession.
À cet égard, la loi ne leur reconnaît aucun droit ; ils sont totalement exclus de la succession.
2. La mise en œuvre de la vocation successorale du conjoint survivant en propriété
2.1. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence de descendants
2.1.1. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants communs
Lorsque le conjoint survivant est en concours avec des descendants, il peut opter:
- Soit pour l’usufruit portant sur la totalité des biens
- Soit pour le quart de la succession en pleine propriété
a. La liquidation du droit au quart de la succession en pleine propriété
Lorsqu’il a été arrêté que le conjoint survivant recevrait le quart de la succession en pleine propriété, l’opération de transmission est loin d’être achevée.
Pour que cette transmission puisse se faire, encore faut-il procéder à ce que l’on appelle la liquidation du droit du conjoint survivant.
Par liquidation, il faut entendre l’ensemble des opérations visant à valoriser la quote-part qui lui revient et plus précisément à
En première intention, on pourrait être porté à penser qu’il suffirait d’évaluer l’ensemble des biens présents au jour de la succession et de retrancher le quart de la valeur obtenue pour liquider les droits du conjoint survivant.
Si toutefois l’on retenait cette méthode, elle pourrait se révéler fort désavantageuse pour le conjoint survivant. Dans l’hypothèse, en effet, où le défunt aurait consenti de nombreuses libéralités à ses enfants et qu’il laisserait derrière lui un patrimoine des plus modeste, il ne reviendrait qu’une faible portion des biens au conjoint survivant rapportée à l’ensemble des biens transmis.
Une autre méthode pourrait consister à tenir compte dans le calcul de la quote-part revenant au conjoint survivant de l’ensemble des libéralités consenties par le défunt à ses enfants.
Cela serait toutefois susceptible de produire l’effet inverse de celui obtenu par la première méthode : une atteinte trop grande aux intérêts des enfants du défunt, lesquels pourraient se retrouver à devoir de restituer au conjoint survivant le quart de la valeur de l’ensemble des libéralités qu’ils ont reçues. Une telle situation serait, de toute évidence, de nature à remettre en cause le caractère intangible des libéralités que le défunt a entendu consentir à ses enfants de son vivant.
Conscient des incidences de chacune de ces méthodes de calcul, le législateur a opté, en 2001, pour une solution intermédiaire.
La méthode de calcul retenue est énoncée aux articles 758-5 et 758-6 du Code civil. Elle se décompose en trois étapes :
- Première étape
- Elle consiste à déterminer la consistante de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant.
- Il s’agit ce que l’on appelle la masse de calcul
- Deuxième étape
- Elle consiste à déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant.
- Car en effet, il est certains biens qui composent la masse de calcul qui n’ont pas vocation à revenir au conjoint survivant.
- On parle ici de la masse d’exercice.
- Troisième étape
- Elle consiste à retrancher de la valeur obtenue les libéralités que défunt a consenties au conjoint survivant
a.1. La détermination de la masse de calcul
Afin de pouvoir attribuer au conjoint survivant la quote-part de la succession en pleine propriété qui lui revient, la première étape consiste à déterminer les biens qui formeront l’assiette sur laquelle sera prélevée cette quote-part. C’est donc ce que l’on appelle la masse de calcul.
La méthode de détermination de cette masse de calcul est énoncée à l’article 758-5, al. 1er du Code civil qui prévoit que « le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport. »
Il ressort de cette disposition que la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant comprend deux catégories de biens :
- Les biens existants
- Les libéralités rapportables
La méthode de détermination de la masse de calcul énoncée à l’article 758-5 du Code civil vise à assurer une équité entre tous les héritiers en tenant compte des transmissions effectuées par le défunt de son vivant. Cependant, l’application de cette méthode n’est pas sans soulever des difficultés pour certains biens, notamment lorsque le Code civil ne précise pas explicitement les règles relatives à leur intégration dans la masse de calcul.
i. Les biens existants
Les biens existants ne sont autres que les biens présents au jour du décès du de cujus et dont il n’a pas disposé à cause de mort par voie de testament ou d’institution contractuelle.
Cette masse de biens peut se décomposer en plusieurs éléments, selon le régime matrimonial sous lequel le couple vivait et la nature même des biens.
Au nombre de ces éléments on est susceptible de compter :
- Les biens propres du défunt sont ceux qu’il possédait avant le mariage ou qu’il a acquis durant le mariage par donation ou succession.
- La quote-part de biens communs revenant au défunt, si les époux étaient mariés sous un régime de communauté, laquelle comprend les biens acquis par les époux pendant le mariage, à l’exception de ceux qui sont explicitement considérés comme propres au regard du régime matrimonial ou de la loi. La détermination de cette part peut nécessiter des ajustements, notamment les récompenses dues à la communauté ou à l’un des époux en raison des mouvements de valeurs entre les biens propres et les biens communs.
En tout état de cause, l’évaluation des biens existants doit se faire en valeur nette, c’est-à-dire après déduction des dettes du défunt et des charges de la succession.
Cela inclut les frais funéraires, les dettes fiscales, les prêts en cours, et autres obligations financières que le défunt aurait laissées.
Une attention particulière doit être portée sur les droits temporaires d’habitation et d’usage attribués au conjoint survivant, tels que décrits à l’article 763 du Code civil.
Ces droits, lorsqu’ils sont exercés sur un bien de la succession, doivent être évalués et considérés comme une charge de la succession, soit par la jouissance gratuite du logement pendant un an, soit par le remboursement des loyers que la succession doit au conjoint survivant.
ii. Les libéralités rapportables
Autres biens devant être intégrés dans la masse de calcul : les libéralités dites rapportables.
Une libéralité rapportable est un bien ou un ensemble de biens qu’un défunt a transmis à un héritier durant sa vie, sous forme de donation ou de legs, avec la stipulation ou la présomption que ce bien doit être réintégré fictivement dans la masse de calcul de la succession pour déterminer les parts des héritiers.
En réintégrant les libéralités rapportables, on assure que tous les héritiers reçoivent une part juste et proportionnelle de la succession, ajustée en fonction des avantages déjà reçus par certains d’entre eux de leur vivant. Cela permet de maintenir l’équilibre entre les héritiers et de respecter autant que possible l’équité.
En application de l’article 843 du Code civil, toutes les donations sont réputées avoir été consenties aux descendants comme des avancements d’hoirie, c’est-à-dire des avances sur leur part d’héritage. Cette présomption signifie que, à moins d’indications contraires, ces donations doivent être rapportées à la succession.
Les donations peuvent toutefois être exemptées du rapport si le donateur l’a explicitement déclaré dans l’acte de donation.
Pour effectuer le rapport, la valeur des biens donnés est réévaluée au jour du décès du donateur. Cela signifie que si un bien a pris de la valeur depuis qu’il a été donné, cette plus-value est aussi prise en compte dans la masse successorale. L’objectif est de refléter fidèlement la valeur réelle du patrimoine du défunt au moment de son décès.
S’agissant des legs, la présomption est inversée : ils sont réputés préciputaires, soit « faits hors part successorale » (art. 843, al. 2e C. civ.).
Il en résulte que, par principe, les legs n’ont pas vocation à être intégrés dans la masse de calcul pour déterminer la quote-part du conjoint survivant. Ils en sont exclus, ce qui, mécaniquement, est de nature à amoindrir la quote-part revenant à ce dernier.
Le testateur dispose toutefois de la faculté de stipuler que le legs consenti est rapportable à la succession. Dans cette hypothèse, il devra alors être réintégré à la masse de calcul.
Lorsque le rapport est requis, l’évaluation du bien légué s’effectue à la date du décès du testateur. Il s’agit de déterminer la valeur réelle du bien au moment du décès pour l’intégrer correctement dans le calcul de la répartition de la succession.
L’intégration de ce bien légué dans la masse successorale permet d’assurer une équité entre tous les héritiers, particulièrement dans les situations où certains bénéficient de legs alors que d’autres ne reçoivent que leur part d’héritage traditionnelle.
Au bilan, la masse de calcul comprend :
- D’une part, les donations qui ne sont assorties d’aucune dispense de rapport
- D’autre part, les legs qui sont assortis d’une stipulation de rapport
iii. Les biens sur lesquels le Code civil est silencieux
Au nombre des biens qui interrogent quant à leur intégration dans la masse de calcul en raison du silence du Code civil figurent :
- Les donations consenties au conjoint survivant
- Les legs faits au profit du conjoint survivant
- Les donations-partages que le défunt a pu faire à la faveur de ses enfants
==>S’agissant des donations consenties au profit du conjoint survivant
- Principe
- Il est admis que toutes les donations reçues par le conjoint survivant doivent être intégrées à la masse de calcul.
- Pour justifier ce principe, les auteurs se fondent sur l’article 758-6 du Code civil qui énonce que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
- Cette disposition prévoit donc ici un mécanisme d’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant sur ses droits successoraux.
- Si elle ne se confond pas avec le rapport successoral, l’imputation fonctionne de manière similaire, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession.
- Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
- Il peut être observé que l’article 758-6 ne distingue pas selon que la libéralité est ou non rapportable.
- Il en résulte qu’une donation consentie au profit du conjoint survivant qui serait assortie d’une dispense de rapport doit être intégrée dans la masse de calcul par le jeu du mécanisme de l’imputation.
- Elle en sera en revanche exclue si le défunt a stipulé une dispense d’imputation, soit en précisant que la donation est faite hors par successorale.
- La Cour de cassation a admis la validité d’une telle stipulation dans un arrêt du 17 décembre 2014 (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).
- Tempéraments
- Cadeaux et présents d’usage
- Conformément à l’article 852 du Code civil, les cadeaux et présents d’usage ne sont normalement pas soumis au rapport, sauf volonté contraire exprimée par le donateur.
- Cette disposition légale établit, en effet, une distinction entre les libéralités ordinaires, qui doivent être rapportées à la succession, et les présents d’usage, qui sont généralement exemptés de ce rapport.
- À cet égard, les présents d’usage sont définis comme des cadeaux faits à des occasions spéciales telles que les anniversaires, les fêtes religieuses, les mariages, ou autres célébrations similaires.
- Ces cadeaux sont caractérisés par leur nature appropriée et leur valeur modérée, relative à la situation financière du donateur.
- Ce qui les distingue des autres types de donations, c’est qu’ils sont faits selon les usages sociaux et ne représentent pas une diminution significative du patrimoine du donateur.
- Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport pour plusieurs raisons :
- Tout d’abord, les cadeaux sont faits dans le contexte d’événements spécifiques où il est coutumier d’offrir des présents (Noël, anniversaires, etc.).
- Ensuite, leur valeur est généralement proportionnelle aux moyens du donateur, ce qui signifie qu’ils ne constituent pas une avance sur l’héritage ou une libéralité impactant significativement la succession.
- Enfin, il existe une attente sociale que ces cadeaux ne soient pas considérés comme des avancements d’héritage mais plutôt comme des gestes de bonne volonté liés à l’événement célébré.
- Toutefois, l’exemption de rapport n’est pas absolue.
- Le donateur peut explicitement déclarer que même un présent d’usage doit être rapporté à la succession.
- Cette intention doit être clairement exprimée, soit au moment de la donation, soit par des indications ultérieures.
- Cette liberté laissée au donateur permet de maintenir une équité entre les héritiers si cela est jugé nécessaire, en fonction des circonstances particulières de la famille ou de l’état du patrimoine.
- Donations rémunératoires entre époux
- Une donation rémunératoire est celle qui est faite en reconnaissance de contributions exceptionnelles faites par un conjoint, qui vont au-delà des obligations normales du mariage.
- À la différence d’une donation ordinaire, qui est motivée par l’intention de gratifier une personne sans attendre de contrepartie, la donation rémunératoire est essentiellement compensatoire.
- Elle est destinée à compenser le bénéficiaire pour des services spécifiques ou pour des sacrifices personnels qui ont bénéficié à l’autre partie.
- Elle est souvent liée à des contributions qui dépassent les attentes normales des devoirs conjugaux, comme le soutien à la carrière de l’autre conjoint au détriment de la propre carrière professionnelle du bénéficiaire, ou des années consacrées exclusivement à l’éducation des enfants ou à l’entretien du foyer sans poursuivre une activité rémunérée.
- Un exemple classique pourrait être celui d’un conjoint qui a financé l’achat d’un bien immobilier en son nom mais en reconnaissant une part au conjoint non-travailleur en compensation pour son soutien et ses sacrifices.
- La jurisprudence a souvent interprété ces donations non pas comme des libéralités, mais comme des actes de reconnaissance de dettes morales ou matérielles au sein du couple.
- En ce sens, elles ne sont pas considérées comme des donations devant être rapportées à la succession, car elles ne reflètent pas une intention libérale mais plutôt une obligation morale ou éthique de compenser le conjoint pour ses sacrifices ou ses contributions.
- En conséquence, ces donations ne sont généralement pas incluses dans la masse de calcul.
- Cela est dû au fait que leur finalité n’est pas de diminuer la part de la succession revenant aux autres héritiers, mais de compenser équitablement le conjoint pour des contributions spécifiques qui ont bénéficié au couple.
- Cadeaux et présents d’usage
==>S’agissant des legs faits au profit du conjoint survivant
Historiquement, les legs et autres libéralités faites au profit du conjoint survivant étaient souvent considérés comme hors part successorale, sauf indication contraire du disposant.
Cela signifiait que, sauf si le testateur stipulait expressément que le legs devait être rapporté, ces biens ne faisaient pas partie de la masse de calcul utilisée pour déterminer les parts des autres héritiers. Cette approche permettait au conjoint survivant de recevoir des biens par legs sans que cela affecte sa part dans la répartition de la succession résiduelle.
L’article 758-6 du Code civil, introduit par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, a modifié cet état du droit en prévoyant l’imputation de toutes les libéralités, y compris les legs, sans distinction, sur les droits successoraux du conjoint gratifié.
Cette disposition implique que toute libéralité, y compris les legs, doit désormais être prise en compte dans la détermination de la masse de calcul.
Pour mémoire, l’imputation fonctionne de manière similaire au rapport, car elle est déduite de la part du conjoint dans la succession. Techniquement, bien que l’imputation ne soit pas un rapport au sens traditionnel, elle ajuste la part du bénéficiaire en conséquence des valeurs reçues sous forme de libéralités, affectant ainsi indirectement la répartition de la succession parmi les héritiers.
La logique qui a présidé à la réforme opérée par la loi du 23 juin 2006 est que les biens reçus par le conjoint sous forme de legs doivent être considérés dans la détermination de la masse de calcul pour assurer une équité entre tous les héritiers.
Aussi, cela garantit que le conjoint survivant ne reçoive pas une double portion – une première fois sous forme de legs et une seconde fois sous forme de quote-part de la succession – au détriment des autres héritiers.
Cette approche a été renforcée par la jurisprudence, notamment par un avis de la Cour de cassation rendu le 25 septembre 2006.
Aux termes de cet avis, elle a décidé que « s’agissant des successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ayant réintroduit la règle de l’imputation en insérant un article 758-6 dans le code civil, le conjoint survivant ne peut plus bénéficier d’un tel cumul » (Cass. avis du 25 sept. 2006, 06-000.09).
Autrement dit, les libéralités reçues par le conjoint ne sont pas cumulables avec sa part successorale normale. Il est donc dorénavant admis que toutes les libéralités faites au conjoint, y compris les legs, doivent être prises en compte dans la masse de calcul.
==>S’agissant des donations-partages
La donation-partage est une forme spécifique de donation qui permet à une personne de procéder, entre ses héritiers présomptifs, à la distribution et au partage de ses biens et de ses droits (art. 1075 C. civ.).
Ce dispositif confère, autrement dit, à tout personne la faculté de diviser, de son vivant, son patrimoine de manière définitive et irrévocable aux fins de le répartir entre ses successibles.
La donation-partage a été conçue pour favoriser une transmission harmonieuse des biens familiaux et pour éviter les litiges entre héritiers après le décès du donateur.
Elle se révélera particulièrement utile pour les familles possédant des biens importants ou complexes, tels que des entreprises familiales, des terres agricoles ou des biens immobiliers, où un partage équitable et précoce peut prévenir les conflits futurs et assurer une gestion stable des biens.
À la question de savoir si la donation-partage doit être intégrée dans la masse de calcul sur laquelle sera prélevée la quote-part du conjoint survivant, le Code civil n’apporte aucune réponse. De son côté, la doctrine est partagée.
Certains auteurs rappellent que les donations-partages sont regardées comme des avancements d’hoirie, ce qui signifie qu’elles sont présumées faites en avance sur la part d’héritage que les bénéficiaires auraient autrement reçu.
À cet égard, contrairement aux donations ordinaires qui, par principe, sont rapportables, sauf dispense, les donations-partages ne sont généralement pas sujettes au rapport.
Cela est dû à leur nature même de partage anticipé, où l’ascendant répartit de son vivant les biens entre ses descendants.
Dans un arrêt du 16 juillet 1997, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport, car le rapport est une opération préliminaire visant à constituer la masse partageable, alors que dans le cas d’une donation-partage, cette masse a déjà été attribuée (Cass. 1ère civ. 16 juill. 1997, n°95-13.316).
Compte tenu de leur caractère non rapportable, la doctrine majoritaire plaide pour que les donations-partages ne soient pas intégrées dans la masse de calcul.
Certains auteurs font toutefois valoir que l’article 758-5 du Code civil semble prévoir que seules les libéralités expressément dispensées de rapport sont exclues de la masse de calcul.
On pourrait alors en déduire que, en l’absence d’une dispense explicite de rapport, une libéralité, y compris sous la forme une donation-partage, pourrait théoriquement être incluse dans cette masse.
Si dès lors une donation-partage n’est assortie d’aucune clause expressément libératoire de rapport, elle devrait être intégrée dans la masse de calcul.
En l’état, cette question n’a toujours pas été tranchée par la Cour de cassation. Pour cette raison, il pourrait apparaître avisé pour un donateur de prévoir une clause stipulant s’il entend ou non que la donation-partage qu’il fait à la faveur de ses successibles soit intégrée dans la masse de calcul.
En synthèse :
MASSE DE CALCUL
=
- Biens existants – Passif
+
- Donations consenties au profit de descendants non assorties d’une dispense de rapport
+
- Legs consentis au profit de descendants assortis d’une stipulation de rapport
+
- Libéralités consenties au conjoint survivant non assorties d’une dispense d’imputation – (présents d’usage + donations rémunératoires)
+
- Les donations-partages non assorties d’une stipulation de rapport
a.2. La détermination de la masse d’exercice
Une fois la masse de calcul fixée, l’opération de liquidation des droits du conjoint survivant n’est pas achevée. Il reste notamment à déterminer parmi les biens qui composent cette masse, quels sont ceux qui sont réellement disponibles afin de procéder à l’attribution effective de la quote-part de la succession revenant au conjoint survivant.
Car en effet, il est certains biens qui sont compris dans la masse de calcul, mais qui ne seront pas transmis à ce dernier. Ces biens vont avoir pour seule finalité de permettre le calcul de l’assiette sur laquelle sera prélevée la part dévolue au conjoint survivant.
Les biens que celui-ci a effectivement vocation à recueillir forment ce que l’on appelle la masse d’exercice. Il s’agit, en d’autres termes, de la masse de biens sur laquelle le conjoint survivant pourra exercer ces biens.
i. Consistance de la masse d’exercice
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n’aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant ne peut exercer ses droits :
- Ni sur les biens donnés et légués
- Ni sur la réserve des descendants
- Ni sur les biens faisant l’objet d’un droit de retour
==>S’agissant des biens donnés et légués
Si, au stade de la détermination de la masse de calcul, sont intégrées toutes libéralités rapportables consenties au profit de successibles ou de tiers, il n’en va pas de même au stade de la détermination de la masse d’exercice.
En application de l’article 758-5, al. 2e du Code civil, tous les biens donnés et légués à des personnes autres que le conjoint survivant sont exclus de la masse d’exercice.
À cet égard, le texte ne distingue :
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort
- Ni selon qu’il s’agit de libéralités rapportables ou faites hors part successorale
Cela signifie donc que le conjoint survivant ne peut prétendre exercer ses droits en pleine propriété que sur les biens dont le de cujus n’a pas disposé à titre gratuit.
Au fond, l’idée qui sous-tend la règle d’exclusion des libéralités de la masse d’exercice est d’empêcher qu’elles puissent être révoquées par l’effet du seul exercice des droits du conjoint survivant.
En effet, comme souligné par un auteur « le rapport est dû au de cujus, en ce qu’il est de nature à augmenter ses droits (conséquence de l’inclusion des libéralités rapportables dans la masse de calcul) ; mais il ne lui est pas dû, en ce qu’il ne peut obliger les enfants à lui restituer ce qu’ils ont reçu (conséquence de l’exclusion des libéralités rapportables dans la masse d’exercice) »[3].
Concrètement, si l’intégration des libéralités rapportables dans la masse de calcul est susceptible de permettre au conjoint survivant de capter l’ensemble des biens existants de la succession, cette intégration ne doit jamais conduire les personnes gratifiées à restituer tout ou partie des libéralités qui leur ont été consenties par le défunt ; raison pour laquelle elles sont exclues de la masse d’exercice.
Au total, il apparaît que le conjoint survivant n’est pas un successible ab intestat comme les autres. S’il bénéficie du rapport des libéralités pour le calcul théorique de ses droits, il en perd le bénéfice au stade de leur exercice effectif.
==>S’agissant de la réserve de descendants
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier aux droits de réserve ».
La question qui immédiatement est se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « droits de réserve » lesquelles forment ce que l’on appelle la « réserve héréditaire ».
Aux termes de l’article 912 du Code civil, la réserve héréditaire est définie comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. »
Il s’agit, autrement dit, de la portion de biens dont le défunt ne peut pas disposer à sa guise, la réserve héréditaire présentant un caractère d’ordre public (Cass. req., 26 juin 1882).
Ainsi, la réserve s’impose-t-elle impérativement au testateur qui ne pourra déroger aux règles de dévolution légale qu’en ce qui concerne ce que l’on appelle la quotité disponible.
L’alinéa 2 de l’article 912 définit la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
Selon le nombre d’enfants que le défunt laisse derrière lui la quotité disponible sera plus ou moins étendue.
L’article 913 distingue 3 situations :
- En présence d’un enfant, la quotité disponible s’élève à la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la quotité disponible s’élève au tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la quotité disponible s’élève au quart des biens du disposant
A contrario, cela signifie que :
- En présence d’un enfant, la réserve héréditaire comprend la moitié des biens du disposant
- En présence de deux enfants, la réserve héréditaire comprend le tiers des biens du disposant
- En présence de trois enfants et plus, la réserve héréditaire comprend le quart des biens du disposant
Il peut être observé que, afin de calculer la réserve, en application de l’article 922 du Code civil il y a lieu de former une basse qui comporte :
- D’une part, tous les biens existants au jour de l’ouverture de la succession
- D’autre part, tous les biens donnés et légués, étant précisé qu’il est indifférent que ces biens soient ou non rapportables.
Aussi, l’assiette de calcul de la réserve héréditaire est-elle plus large que celle permettant de calculer les droits théoriques du conjoint survivant.
À cet égard, si l’on en revient à la situation de ce dernier, l’article 758-5, al. 2e prévoit que les droits qui lui sont reconnus ne doivent pas préjudicier aux droits de réserve.
Cela signifie que, en présence de descendants, les droits du conjoint survivant ne peuvent s’exercer que sur la seule quotité disponible.
À supposer que le défunt ait consenti des libéralités qui épuisent la quotité disponible, ou même entament la réserve (dans le cas où les libéralités dépassent la quotité disponible), le conjoint survivant peut se retrouver avec peu ou pas de droits effectifs à exercer.
Cela est dû au fait que la loi protège avant tout les parts de la succession revenant aux réservataires :
- Si toutes les libéralités respectent la réserve : le conjoint peut prétendre à sa part sur la quotité disponible
- Si les libéralités épuisent la quotité disponible : le conjoint ne reçoit rien, car il n’y a plus de biens disponibles à attribuer au-delà de la réserve
- Si les libéralités empiètent sur la réserve : les libéralités peuvent être réduites pour restaurer la réserve, mais cela peut aussi signifier qu’il ne reste rien pour le conjoint
==>S’agissant des biens faisant l’objet d’un droit de retour
L’article 758-5, al. 2e du Code civil prévoit que l’exercice par le conjoint survivant de ses droits ne peut jamais « préjudicier […] aux droits de retour ».
Cela signifie que les biens spécifiquement destinés à revenir à certaines personnes ou à certains groupes par l’effet d’un droit de retour ne peuvent être intégrés dans la masse d’exercice.
Pour mémoire, si les dernières réformes ont supprimé un certain nombre de droits de retour, il en subsiste encore quelques-uns.
Par exemple, l’article 368-1 du Code civil reconnaît un droit de retour pour les biens donnés à un adopté simple par l’adoptant ou recueillis dans sa succession. Si ces biens se retrouvent en nature dans la succession de l’adopté, ils doivent retourner à l’adoptant ou à ses descendants, sous réserve des droits acquis par les tiers.
La raison de l’exclusion de la masse d’exercice des biens faisant l’objet d’un droit de retour réside dans leurs modalités particulières de transmission. En effet, ces biens échappent au jeu de la succession ordinaire ; ils relèvent de ce que l’on appelle la succession anomale.
En synthèse :
MASSE D’EXERCICE
=
MASSE DE CALCUL
–
- Les droits attachés à la réserve héréditaire (compris entre ½ et ¾ des biens du défunt)
–
- Libéralités consenties à des personnes autres que le conjoint survivant (rapportables et hors succession et dans la mesure où elles s’imputent sur la quotité disponible)
–
- Les biens faisant l’objet d’un droit de retour
ii. Évaluation de la masse d’exercice
Le calcul des droits du conjoint survivant s’exerçant sur la masse de calcul obéit à deux principes directeurs :
==>Premier principe directeur
- Énoncé du principe
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- D’une part, la valeur résultant du produit entre la masse de calcul et la quotité légale allouée en pleine propriété au conjoint survivant (1/4)
- D’autre part, la valeur de la masse d’exercice
- Ainsi, les droits du conjoint survivant sont-ils enfermés dans un double plafond.
- Il ne peut prétendre qu’à la valeur la plus basse entre les deux plafonds obtenus en calculant la masse de calcul et la masse d’exercice.
- Aussi, deux configurations sont possibles
- Première configuration
- La masse de calcul est supérieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant pourra réclamer l’attribution de l’intégralité de ses droits théoriques, dans la limite d’un quart de la masse de calcul.
- Ce cas se rencontre notamment lorsque le montant des libéralités rapportables consenties par le de cujus est modeste
- Seconde configuration
- La masse de calcul est inférieure à la masse d’exercice
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant percevra moins que ce que lui promettaient ses droits théoriques.
- Ce cas se présentera notamment en présence de libéralités rapportables pour un montant supérieur à la valeur des biens existants ou lorsque, en présence d’une réserve héréditaire, les biens donnés viennent s’imputer sur la quotité disponible.
- Première configuration
- En tout état de cause, il y a lieu d’avoir toujours à l’esprit que les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais être supérieurs à la masse de calcul et inférieurs à la d’exercice.
- Les droits du conjoint survivant ne peuvent jamais excéder :
- Application
- Supposons une succession d’une valeur de 600 000 euros composée d’un bien immobilier (350 000 euros) et d’avoirs bancaires (250 000 euros).
- Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant, de sorte que la réserve héréditaire est portée au 2/3 de la succession, soit 2/3 x 600 000 = 400 000 euros.
- Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + 0
= 600 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – (réserve héréditaire + quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 600 000 – (400 000 + 0)
= 200 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 150 000 euros
-
- Au cas particulier, le conjoint sera fondé à réclamer le prélèvement sur la succession de la somme de 150 000 euros.
==>Second principe directeur
- Énoncé du principe
- Les libéralités consenties à un héritier réservataire s’imputent toujours prioritairement sur sa part de réserve, puis subsidiairement sur la quotité disponible pour la portion excédant la réserve.
- Il n’est donc pas question, pour déterminer la masse d’exercice, de retrancher de la masse de calcul, la réserve, puis les libéralités rapportables consenties à l’héritier réservataire, ce qui reviendrait à soustraire deux fois les mêmes valeurs.
- En effet, l’évaluation de la réserve comprend déjà la prise en compte des libéralités rapportables consenties aux héritiers réservataires.
- Aussi, pour la formation de la masse d’exercice, ce n’est que pour le surplus, soit la portion non prise en compte dans la réserve, que les libéralités rapportables sont retranchées à la masse de calcul.
- Application
- Si l’on reprend l’exemple précédent, supposons que le de cujus avait donné de son vivant à ses enfants la somme de 300 000 euros à chacun.
- S’agissant de la réserve héréditaire, elle est déterminée sur la base d’une masse de calcul comprenant les biens existants et les libéralités, soit (600 000 + 300 000 + 300 000) x 2/3 = 800 000 euros
- Afin de déterminer la part revenant au conjoint survivant il convient de procéder à l’évaluation de la masse de calcul, puis de la masse d’exercice :
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
- Masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables
= (350 000 + 250 000) + (300 000 + 300 000)
= 1 200 000 euros
-
-
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
-
-
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 1 200 000
= 300 000 euros
-
-
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
- Masse d’exercice
-
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 0
= 400 000 euros
-
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 300 000 euros
-
- Dans cet exemple, il apparaît que les libéralités consenties aux héritiers réservataires sont totalement absorbées par la réserve puisque 800 000 > (300 000 + 300 000)
- La solution eut été différente, si les libéralités consenties à chacun des enfants s’étaient élevées à 500 000 euros.
- Dans cette hypothèse, l’évaluation de la masse d’exercice aurait donné lieu au calcul suivant :
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible)
= 1 200 000 – 800 000 – 200 000
= 200 000 euros
-
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
-
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 200 000 euros
-
- Dans cette configuration, les droits effectifs du conjoint survivants (200 000 euros) sont inférieurs à ses droits théoriques (300 000 euros) en raison du montant élevé des libéralités consenties aux héritiers réservataires.
iii. Date d’évaluation de la masse d’exercice
Aucune disposition dans le Code civil ne précise la date à laquelle doit être évaluée la masse d’exercice pour le calcul des droits du conjoint survivant.
Les articles 732 et suivants traitent des droits du conjoint survivant mais sans mentionner de date spécifique pour l’évaluation de l’actif successoral.
S’agissant de la doctrine, elle est partagée : certains auteurs soutiennent qu’il y a lieu de retenir la date du décès, d’autres avancent que l’évaluation des biens doit être réalisée à la date du partage, étant précisé que, entre les deux dates, il peut s’écouler de nombreuses années ; d’où l’importance de la question.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du décès
- Parce que les successeurs acquièrent leurs droits au jour du décès du défunt, il s’en déduit que l’évaluation des biens à partager doit se faire à cette date.
- À cet égard, évaluer la masse successorale à la date du décès offre une certitude quant à la valeur des biens, ce qui évite les difficultés liées aux fluctuations possibles dues aux conditions de marché ou aux changements de l’état des biens.
- Par ailleurs, l’évaluation à la date du décès permet de respecter les dernières volontés du défunt exprimées en considération de la valeur des biens existants à sa mort.
- Arguments pour l’évaluation des biens à la date du partage
- Évaluer la masse successorale à la date du partage est plus équitable car cela prend en compte les évolutions de la valeur des biens jusqu’au moment où ils sont effectivement partagés entre les héritiers.
- L’évaluation à la date du partage reflète mieux la réalité économique des biens, évitant ainsi des injustices liées à des variations importantes de leur valeur.
- Dans les cas où le partage prend beaucoup de temps, évaluer à la date du partage permet d’ajuster les droits de chaque héritier en fonction de la situation actuelle, surtout en présence de biens susceptibles de variation significative de valeur (immobilier, entreprises).
Entre ces deux approches, certains auteurs plaident pour une solution intermédiaire. Cette solution consisterait à procéder à une évaluation en deux temps :
- Premier temps : évaluation au jour du décès
- Il s’agit ici de calculer les droits du conjoint survivant tels qu’ils résultent de la dévolution légale.
- Il y a donc lieu, d’abord d’évaluer la masse de calcul et la masse d’exercice, puis de rapporter le résultat de cette double opération, soit la quotité dévolue au conjoint survivant, à la valeur des biens existants au jour du décès.
- Second temps : évaluation au jour du partage
- Cette étape intervient après que les droits du conjoint survivant résultant de la dévolution légale ont été établis.
- Il s’agit ici d’attribuer les biens aux héritiers et notamment le lot revenant au conjoint survivant : c’est l’opération de partage.
- Pour déterminer la valeur du lot à attribuer au conjoint survivant, il y a lieu de rapporter la quotité évaluée au jour du décès aux biens existants dont la valeur est estimée, quant à elle, au jour du partage.
a.3. L’imputation des libéralités reçues par le conjoint survivant
Les biens attribués au conjoint survivant dans le cadre du règlement de la succession ne se limitent pas à ceux résultant de la dévolution légale.
Le conjoint survivant est, en effet, susceptible de recevoir des biens au titre des libéralités qui lui auraient été consenties par le défunt. Il peut s’agir, tant de donations, que de legs.
Aussi, le conjoint survivant est-il susceptible de recevoir plus que la part qui lui est dévolue par l’effet de la loi.
Si en soi, il n’y a rien d’illicite à gratifier son conjoint au-delà de la quotité légale, se pose toutefois la question de la conciliation des libéralités faites entre époux avec les droits des autres héritiers ab intestat et notamment les héritiers réservataires.
Parce qu’elles empruntent une voie parallèle à la transmission des biens par voie légale, les libéralités sont susceptibles de capter tout ou partie de la quotité disponible et donc de concurrencer directement les droits des autres successeurs.
Cette captation de la quotité disponible sera toutefois plus ou moins étendue selon la méthode d’imputation que l’on retient. Deux approches sont possibles :
- Première approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité disponible.
- Il en résulte une captation de cette quotité, dès le premier euro et, par voie de conséquence une extension des droits du conjoint survivant.
- Les droits des héritiers réservataires s’en trouvent toutefois diminués d’autant.
- Seconde approche
- Elle consiste à imputer les libéralités consenties au conjoint survivant sur la quotité légale qui lui revient.
- En procédant de la sorte, aucun prélèvement n’est effectué sur la quotité disponible qui demeure intacte et qui dès lors peut être dévolue aux héritiers réservataires, sauf legs faits à des tiers.
- À supposer que le de cujus ait gratifié le conjoint survivant au-delà de sa vocation légale, cela signifie qu’il ne recevra rien au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
- Quant au surplus, il ne pourra être prélevé sur la quotité disponible que dans la limite de ce qui est prévu par la loi.
Entre ces deux approches, le législateur a finalement opté pour la seconde après une période d’incertitude jurisprudentielle.
==>Évolution
À l’origine, l’ancien article 767, al. 6e du Code civil, issu d’une loi du 9 mars 1891, prévoyait une règle spécifique d’imputation des libéralités entre époux.
Il prévoyait, en effet, que le conjoint survivant devait cesser d’exercer ses droits « dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le montant atteindrait celui des droits que la présente loi lui attribue ».
En application de cette disposition, il était donc admis que toutes les libéralités consenties au conjoint survivant devaient s’imputer sur son usufruit légal (souvent limité au quart des biens).
Cela signifiait, autrement dit, que toutes libéralités (legs et donations) entre époux venaient automatiquement en déduction des droits dont le conjoint survivant était titulaire au titre de sa vocation successorale.
Et dans l’hypothèse où le montant des libéralités reçues était inférieur à la valeur des droits légaux reconnus au conjoint survivant, celui-ci n’était admis à « réclamer que le complément de son usufruit ».
La loi instituait ainsi un principe de non-cumul entre le droit légal d’usufruit et les libéralités entre époux.
Lorsque, en 2001, le législateur a réformé les règles régissant la vocation successorale du conjoint survivant, celui-ci a, sans doute par inadvertance, omis de prévoir un texte reconduisant le dispositif d’imputation des libéralités entre époux alors en vigueur.
Cette omission a été à l’origine d’une grande controverse doctrinale, les auteurs s’interrogeant sur l’approche qu’il y avait désormais lieu de retenir s’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence de libéralités faites entre époux.
Tandis que certains soutenaient que le système mis en place en 1891 devait être maintenu au motif notamment que l’égalité entre successeurs le commandait, d’autres avançaient au contraire que, compte tenu du silence de la loi, il devait être dorénavant admis que le conjoint survivant puisse cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités qui lui auraient été éventuellement consenties par le prémourant dans la limite de la quotité disponible.
Dans un avis rendu le 26 septembre 2006, la Cour de cassation a décidé que « s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767, alinéa 6, ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités consenties en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ni dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, le silence des textes en vigueur sous l’empire de la loi du 3 décembre 2001 ne saurait s’interpréter comme une reconduction de l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux (Cass. avis du 25 sept. 2006, n°06-000.09)
Il en résulte que, en cas de libéralités consenties au conjoint survivant, celles-ci doivent dorénavant s’imputer, non pas sur les droits légaux de ce dernier, mais sur la quotité disponible.
La Cour de cassation a, par suite, confirmé cette approche dans un arrêt du 4 juin 2009. Aux termes de cette décision, elle a jugé que les droits légaux reconnus au conjoint survivant pouvaient se cumuler avec les libéralités reçues à la condition que ce cumul ait été voulu par le disposant (Cass. 1ère civ. 4 juin 2009, n°08-15.799).
La position adoptée par la Première chambre civile a été particulièrement critiquée par la doctrine.
La raison en est que, en reconnaissant la possibilité pour le conjoint de cumuler ses droits ab intestat avec les libéralités consenties à son profit, cela est susceptible de conduire à une situation d’empiètement sur la réserve héréditaire en présence d’un enfant commun.
Supposons, en effet, que le conjoint survivant soit gratifié à hauteur de la totalité de la quotité disponible et que celui-ci opte, au titre de ses droits légaux, pour l’usufruit.
Dans cette hypothèse, il recevrait alors la moitié des biens de la succession en propriété et la moitié en usufruit, de sorte qu’il ne resterait à l’héritier réservataire plus que la moitié de la succession en nue-propriété. Les droits de ce dernier s’en trouveraient ainsi réduits à la portion congrue.
Lors de l’intervention du législateur en 2006 aux fins de parachever la réforme du droit des successions entreprise en 2001, il ressort des travaux parlementaires que la reconnaissance par la Cour de cassation de la possibilité pour le conjoint survivant de cumuler ses droits ab intestat avec des libéralités entre époux ne correspondrait pas à l’intention originelle du législateur de l’époque.
Aussi, afin de mettre un terme à une position jurisprudentielle qui était de nature à permettre une atteinte excessive à la réserve héréditaire des descendants, a-t-il été décidé par le législateur en 2006 d’introduire une disposition dans le code civil visant à réintroduire expressément l’ancien système d’imputation des libéralités entre époux.
==>Énoncé du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 756-8 du Code civil, issu de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Aussi, la vocation successorale du conjoint survivant se borne-t-elle à ses seuls droits légaux, déduction faite des libéralités qu’il a reçues.
Dit autrement, toutes les libéralités que le prémourant a faites au profit du conjoint survivant épuisent d’autant l’assiette de ses droits légaux.
Il peut être observé que, au regard des dernières décisions rendues, la Cour de cassation n’est pas des plus à l’aise avec le mécanisme d’imputation énoncé par l’article 758-6 du Code civil.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017, elle a, en effet, affirmé que le conjoint survivant « bénéficiait de sa vocation légale, augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux » (Cass. 1ère civ. 25 oct. 2017, n°17-10.644).
Cette affirmation est pourtant contraire à la lettre de l’article 758-6 qui écarte tout cumul entre la vocation légale du conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties.
Les libéralités reçues ne s’ajoutent pas à la vocation légale, elles s’imputent sur celle-ci. Tout au plus, en cas d’excédent, il est admis qu’elles puissent déborder dans la limite de la quotité disponible spéciale.
Plus surprenant encore, dans un arrêt du 12 janvier 2022, la Première chambre civile a jugé que « le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l’article 758-6 » (Cass. 1ère civ. 12 janv. 2022, n°20-12.232).
L’assertion formulée ici par la Haute juridiction est, au mieux maladroite, au pire totalement erronée.
L’opération visée par l’article 758-6 du Code civil s’analyse, non pas en un rapport successoral, mais comme une imputation.
La différence existant entre les deux mécanismes n’est pas neutre :
- S’agissant du rapport successoral, il oblige le bénéficiaire de la libéralité de restituer à la masse partageable l’intégralité de ce qu’il a reçu, y compris ce qui excède la quotité légale qui lui dévolue. Si donc il a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il devra restituer à la succession 20.
- S’agissant de l’imputation, elle oblige seulement le bénéficiaire de la libéralité à restituer ce qu’il a reçu dans la limite de ses droits légaux, de sorte que, en cas d’excédent, celui-ci n’a pas vocation à être restitué à la masse partageable. Cela signifie que si le bénéficiaire a reçu 100 et que sa part s’établit à 80, il n’aura rien à restituer et pourra donc conserver le bénéfice des 20, quand bien même, au bilan, il aura reçu plus que sa part.
==>Le domaine de l’imputation des libéralités entre époux
Il s’infère de l’article 758-6 du Code civil que l’imputation qui s’opère sur les droits légaux du conjoint survivant concerne « les libéralités reçues du défunt ».
Positivement, cela signifie qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature de la libéralité consentie au conjoint survivant. Toutes les libéralités sont admises à l’opération d’imputation.
Aussi, est-il indifférent que l’on soit en présence de libéralités stipulées entre vifs ou à cause de mort. Autrement dit, il peut s’agir, tant d’une donation, que d’un legs ou d’une institution contractuelle.
Négativement, en visant les seules « libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant », l’article 758-6 suggère que n’est pas concerné par le dispositif d’imputation tout ce qui ne s’analyse pas en une libéralité.
Tel est notamment le cas notamment d’une pension de réversion ou d’une assurance vie à tout le moins dès lors que le montant des primes versées n’est pas excessif au regard de la capacité financière du défunt.
Surtout, ne constituent pas des libéralités, les avantages matrimoniaux. Pour mémoire, l’avantage matrimonial consiste en une disposition prise dans le cadre d’un contrat de mariage qui permet à l’un des époux de bénéficier d’un enrichissement ou d’un bénéfice sans contrepartie lors de la dissolution du régime matrimonial, soit par divorce, soit par décès.
À cet égard, l’article 1527 du Code civil dispose expressément que « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes, ne sont point regardés comme des donations. »
La conséquence en est qu’ils ne sont ni rapportables, ni réductibles en cas d’atteinte à la réserve héréditaire des autres héritiers.
Il est en outre admis qu’ils ne sauraient être imputés sur les droits résultant de la vocation successorale du conjoint survivant.
Il peut être observé que l’article 1527, al. 2 du code civil semble admettre une exception à l’exclusion des avantages matrimoniaux du domaine de l’imputation.
Cette disposition prévoit, en effet, que, en présence d’enfants qui ne seraient pas issus du mariage avec le de cujus, les avantages matrimoniaux doivent être regardés comme des libéralités de sorte qu’ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réduction en cas d’atteinte à la réserve.
Est-ce à dire que, dans cette configuration, l’avantage matrimonial s’impute sur les droits légaux du conjoint survivant ? La question se pose.
Pour la doctrine majoritaire ; il n’en est rien. L’alinéa 2 de l’article 1527 du Code civil viserait seulement à protéger les intérêts des enfants non-communs. Cette disposition ne vise nullement à requalifier l’avantage matrimonial en libéralité.
Pour cette raison, il est soutenu – et nous partageons cet avis – que, même en présence d’enfants non issus des deux époux, il n’y a pas lieu d’imputer l’avantage matrimonial stipulé au profit du conjoint survivant sur sa quotité légale.
==>Le caractère supplétif du principe d’imputation des libéralités entre époux
Bien que l’article 758-6 du Code civil ne précise pas si le mécanisme d’imputation des libéralités entre époux peut être écarté par l’effet d’une volonté contraire, il est admis qu’il s’agit là d’une règle supplétive.
Dans un arrêt du 17 décembre 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que le prémourant est libre de stipuler une dispense d’imputation. Un cumul est donc permis entre les droits légaux reconnus au conjoint survivant et les libéralités qui lui sont consenties (Cass. 1ère civ. 17 déc. 2014, n°13-25.610).
En cas de dispense, soit dans l’hypothèse où il est stipulé que la donation ou le legs est consenti hors part successorale, cela signifie que la libéralité ne s’impute pas sur les droits légaux du conjoint survivant ; elle s’ajoute à ces derniers.
==>La mise en œuvre du principe d’imputation des libéralités entre époux
L’article 758-6 du Code civil prévoit donc que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. »
Si, en première intention, le principe d’imputation se comprend bien, sa mise en œuvre n’est toutefois pas sans soulever quelques difficultés pratiques.
Ces difficultés tiennent notamment à l’énoncé du principe qui est formulé en des termes pour le moins généraux.
L’article 758-6 ne distingue pas, en effet, selon l’option successorale qui aurait été exercée par le conjoint survivant.
Le texte vise l’article 757 dans son intégralité, lequel prévoit que le conjoint survivant « recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens ».
Ce renvoi laisse à penser qu’il est indifférent que ce dernier ait opté pour l’attribution du quart de la succession en pleine propriété ou pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Dans les deux cas, le mécanisme d’imputation aurait vocation à jouer.
Il faut en déduire que les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer, tout autant sur ses droits légaux en pleine propriété, que sur ses droits légaux en usufruit.
Si, l’opération d’imputation ne soulève pas de difficultés particulières lorsque les libéralités reçues et les droits légaux sont de même nature (imputer une libéralité en usufruit sur des droits en usufruit), il n’en va pas de même dans le cas contraire.
Lorsque, en effet, il y a lieu d’imputer des libéralités en pleine propriété sur des droits légaux en usufruit (ou inversement), l’opération requiert de trouver un dénominateur commun, soit de procéder à une conversion.
Cette conversation repose sur la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra, par exemple, imputer la libéralité en usufruit (dont la valeur est estimée à 90 000 euros) reçue par le conjoint survivant, sur des droits en pleine propriété.
==>Les effets du principe d’imputation des libéralités entre époux
Parce que, les libéralités reçues par le conjoint survivant ont vocation à s’imputer sur ses droits légaux, les effets vont être différents selon que ces libéralités sont supérieures ou inférieures à la quotité légale.
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est supérieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant ne recevra rien au titre de sa vocation successoral ab intestat.
- Quant aux libéralités qu’il a reçues en dépassement de la quotité légale, parce qu’elles font l’objet d’une imputation – et non d’un rapport –, elles n’ont pas vocation à faire l’objet d’une restitution au profit de la masse partageable.
- Le conjoint survivant ne pourra toutefois conserver ce qu’il a reçu que dans la limite de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
- Cette disposition énonce que « pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. »
- Pour mémoire, la quotité disponible, telle que définie à l’article 912 du Code civil, représente part de la succession dont le défunt peut disposer librement par donation ou testament, sans porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Tandis que l’article 913 du Code civil établit la quotité disponible ordinaire, laquelle varie selon le nombre d’enfants, l’article 1094-1 fixe ce que l’on appelle la quotité disponible spéciale qui bénéficie au seul conjoint survivant.
- Cette quotité disponible est dite spéciale, car elle est plus étendue que celle susceptible de revenir à un tiers.
- Par ailleurs, elle présente la particularité de s’articuler autour de trois options laissées à la discrétion du conjoint survivant.
- Celui-ci dispose, en effet – sauf volonté contraire du prémourant – de la faculté d’opter :
- Soit pour la quotité disponible ordinaire prévue à l’article 913
- Soit pour la totalité des biens en usufruit,
- Soit pour le quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit
- Il peut être observé que la quotité disponible spéciale reconnue au profit du conjoint survivant n’est pas sans limite : elle ne doit pas porter atteinte à la réserve héréditaire des héritiers réservataires.
- Dans l’hypothèse où la quotité disponible spéciale empiéterait sur la réserve, les descendants du de cujus disposeraient alors d’une action en réduction des libéralités consenties au conjoint survivant.
- Au total, il apparaît que, pour le cas où le montant des libéralités consenties au conjoint survivant serait supérieur à ses droits légaux, ce dernier n’est pas tenu de restituer l’excédent à tout le moins dans la double limite :
- D’une part, de la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1 du Code civil
- D’autre part, de la quotité délimitée par la réserve revenant aux héritiers réservataires
- Le montant des libéralités reçues par le conjoint survivant est inférieur à ses droits légaux
- Dans cette hypothèse, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « le conjoint survivant peut en réclamer le complément ».
- Autrement dit, le conjoint survivant peut réclamer le reste de sa part légale pour atteindre le montant total de la quotité auquel il a droit.
- Le texte précise que le complément de part demandé ne peut jamais conduire le conjoint survivant à « recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l’article 1094-1 ».
- Cette précision apportée par le législateur n’est pas sans interpeller.
- Faut-il comprendre que le complément qui peut être sollicité par le conjoint survivant peut excéder ses droits légaux pour atteindre la quotité disponible spéciale ?
- Cela reviendrait toutefois à réintroduire le cumul des libéralités reçues avec les droits légaux.
- Or c’est précisément ce qui a été écarté par le législateur en 2006.
- Par ailleurs, il peut être observé que la quotité disponible spéciale visée à l’article 1094-1 du Code civil ne joue qu’en présence de descendants et non de père et mère, ces derniers n’étant plus réservataires.
- L’article 758-6 indique pourtant s’appliquer dans les deux cas.
- Comment, dans ces conditions, faire application de la règle ?
- Plus précisément, en présence de père et mère quel complément de part octroyer au conjoint survivant ?
- Pour les auteurs, compte tenu du flou qui entoure le texte « en son état actuel, le dernier membre de la phrase de l’article 758-6 paraît dénué de toute portée normative ».
- Aussi, il y aurait lieu de considérer qu’il ne peut être dévolu au conjoint survivant un complément de part que dans la seule limite de ses droits légaux.
Exemples:
Supposons une succession d’une valeur de 200 000 euros. Le défunt laisse derrière lui deux enfants et un conjoint survivant auquel il a consenti une donation de son vivant d’une valeur de 50 000 euros.
Afin de déterminer les droits du conjoint survivant, il convient, pour mémoire, de calculer, dans un premier temps, la masse de calcul puis, dans un second temps, la masse d’exercice.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 60 000
= 360 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 360 000
= 90 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 360 000 – (2/3 x 360 000) – 0
= 120 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 120 000 – 60 000
= 60 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= 60 000 euros
Au cas particulier, il apparaît que les libéralités consenties au conjoint survivant par le défunt n’ont pas totalement épuisé l’assiette de ses droits légaux.
Reste qu’il percevra moins d’un quart de ses droits théoriques, soit 60 000 euros au lieu de 90 000 euros.
Supposons désormais que la libéralité consentie par le défunt au conjoint survivant se soit élevée à 300 000 euros. Le résultat ne sera alors pas le même.
- Masse de calcul
- Évaluation de la masse de calcul
= biens existants + libéralités rapportables + libéralités consenties au conjoint survivant
= 300 000 + 0 + 300 000
= 600 000 euros
-
- Droits théoriques du conjoint survivant
= ¼ x masse de calcul
= ¼ x 600 000
= 150 000 euros
- Masse d’exercice
- Évaluation de la masse d’exercice
= masse de calcul – réserve héréditaire – quote-part des libéralités rapportables imputable sur la quotité disponible
= 600 000 – (2/3 x 600 000) – 0
= 200 000 euros
-
- Imputation des libéralités entre époux
= Droits avant imputation – quote-part des libéralités entre époux imputable sur la quotité disponible
= 200 000 – 300 000
= – 100 000 euros
-
- Droits effectifs du conjoint survivant
= Valeur la plus faible entre la masse de calcul et la masse d’exercice
= – 100 000 euros
Dans cette hypothèse, il apparaît que les droits du conjoint survivant sont négatifs. Cela signifie qu’il ne pourra rien percevoir au titre de sa qualité d’héritier ab intestat.
La raison en est l’épuisement de l’assiette de ses droits légaux par la libéralité de 300 000 euros qui lui a été consenti par le défunt.
b. La liquidation du droit à l’usufruit sur la totalité de la succession
En application de l’article 757 du Code civil, le conjoint survivant peut, en présence d’enfants communs, opter pour l’attribution d’un droit à l’usufruit sur la totalité des biens de la succession.
Si, dans son expression, le principe est simple, sa mise en œuvre n’est pas sans soulever un certain nombre de difficultés qui tiennent :
- D’une part, à l’assiette de l’usufruit
- D’autre part, à l’exercice de l’usufruit
b.1. L’assiette de l’usufruit
L’article 757 du Code civil prévoit que le droit d’usufruit pour lequel le conjoint survivant peut opter s’exerce sur « la totalité des biens existants ».
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « biens existants ».
Plus précisément, quels sont les biens qui relèvent de cette catégorie et quels sont ceux qui en sont exclus, l’enjeu étant la détermination du périmètre de la masse d’exercice de l’usufruit ?
i. Les biens compris dans la catégorie des biens existants
==>Les biens formant l’actif du patrimoine du défunt
Il est admis que la catégorie des biens existants comprend tous les éléments qui forment l’actif du patrimoine du défunt au jour de son décès.
Dans le détail, il s’agit :
- D’une part, de tous les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels
- D’autre part, de tous les droits de créance dont était titulaire le défunt
À cet égard, comme précisé par l’article 757 du Code civil, l’usufruit s’exerce sur la totalité de ces biens, de sorte que le conjoint survivant devient usufruitier du tout, y compris de la part des biens relevant de la réserve héréditaire.
Les enfants communs sont dès lors susceptibles de voir leur vocation successorale réduite à la nue-propriété des biens composant leur réserve sous l’effet du seul exercice de l’option successorale par le conjoint survivant.
Pour que ce dernier soit gratifié d’un usufruit universel, il n’est donc plus besoin pour le défunt, comme c’était le cas sous l’empire du droit antérieur, d’opérer par voie de libéralités, à tout le moins en présence d’enfants communs.
En présence d’enfants issus d’un autre lit, la transmission d’un usufruit universel au profit du conjoint survivant requiert, en effet, toujours l’établissement d’une libéralité à cause de mort, étant précisé que l’article 1094-1 du Code civil autorise, au titre de la quotité disponible spéciale dont bénéficie le conjoint survivant, à ce qu’un legs portant sur des droits en usufruit empiète sur la réserve des héritiers réservataires.
==>L’indifférence d’un droit de retour légal grevant le bien
En première intention, on pourrait être porté à penser que les biens faisant l’objet d’un droit de retour sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit du conjoint survivant.
Pourtant, il n’en est rien. La raison en est que le droit de retour légal ne joue jamais en présence de descendants. Or lorsque le conjoint survivant opte pour l’usufruit, c’est précisément parce qu’il se trouve en concours avec des descendants.
Aussi, il y a bien lieu de comprendre dans la catégorie des biens existants, les biens grevés d’un droit de retour légal. Tel n’est, en revanche, pas le cas pour les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel.
ii. Les biens exclus de la catégorie des biens existants
==>Les biens donnés
En application de l’article 757 du Code civil les biens donnés par le prémourant, soit ceux dont il a disposé entre vifs sont exclus de la masse d’exercice de l’usufruit.
La raison en est que ces biens sont réputés ne pas faire partie du patrimoine du défunt au jour de son décès. Et pour cause, ils en sont sortis de son vivant.
À cet égard, il est indifférent que les libéralités entre vifs aient été faites au profit de tiers ou d’héritiers ab intestat. Il importe peu, par ailleurs, qu’elles soient rapportables à la succession ou réductibles pour cause d’empiètement sur la réserve des héritiers réservataires.
==>Les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel
Il est des cas où le droit de retour grevant un bien a pour origine non pas la loi, mais une convention.
Dans cette hypothèse, le droit de retour conventionnel se définit comme un mécanisme par lequel le donateur se réserve la faculté de reprendre le bien donné si certaines conditions, définies au moment de la donation, se réalisent, au nombre desquelles figure notamment le décès du donataire.
Aussi, le droit de retour légal s’analyse, non pas comme un mécanisme de transmission successorale, mais plutôt comme une condition résolutoire.
Or une condition résolution produit un effet rétroactif. Lorsqu’une telle condition se réalise, le bien grevé du droit de retour légal est réputé n’avoir jamais quitté le patrimoine du donateur.
Pour cette raison, les biens faisant l’objet d’un droit de retour conventionnel ne sauraient être compris dans la catégorie des biens existants.
iii. Les biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine
Il est des biens dont la catégorie d’appartenance est incertaine en raison de la contradiction des textes : il s’agit des biens légués.
Si l’on se fie à l’article 922 du Code civil, on pourrait être porté à considérer que les biens légués doivent être compris dans l’assiette de l’usufruit.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul de la réserve héréditaire, prévoit, en effet, que pour calculer la réduction des libéralités excessives, on doit former une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, en y ajoutant fictivement ceux qui ont été disposés par donation entre vifs, après déduction des dettes. Ainsi, tous les biens, qu’ils soient légués ou non, entrent dans le calcul de cette masse pour déterminer les parts réservataires et la quotité disponible.
Si l’on s’en tenait à la lettre de l’article 922 du Code civil, il y aurait donc lieu de regarder les biens légués comme faisant toujours partie du patrimoine du défunt au jour de l’ouverture de la succession, ce qui justifierait qu’ils soient comptés parmi les biens existants.
Cette analyse se heurte toutefois à la règle énoncée à l’article 758-5 du Code civil qui suggère la solution inverse.
Cette disposition, qui définit la masse de calcul des droits en pleine propriété du conjoint survivant, exclut en effet de la catégorie des biens existants formant cette masse, tous les biens dont le défunt « aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire ».
Les articles 922 et 758-5 du Code civil fournissent ainsi des approches radicalement opposées de la catégorie des biens existants.
Pour sortir de l’impasse, la doctrine majoritaire suggère de distinguer selon que les legs sont rapportables et selon qu’ils sont consentis hors part successorale.
S’agissant des legs rapportables, soit ceux consentis par le défunt à un héritier qui doit être réintégré dans la masse successorale au moment du partage de la succession, il y aurait lieu de les comprendre dans la catégorie des biens existants.
L’usufruit du conjoint serait dès lors admis à s’exercer sur ces biens.
Les auteurs justifient cette thèse en avançant que les legs rapportables sont sans incidence sur le contenu de la masse partageable. Il n’y a dès lors aucune raison qu’ils affectent l’assiette de l’usufruit du conjoint.
S’agissant des legs non rapportables, soit ceux consentis hors part successorale, il y aurait lieu de les exclure de l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
La raison en est que ces legs présentent la particularité de s’imputer sur la quotité disponible. À ce titre, ils ne sont a priori pas réductibles et ne sauraient dès lors être grevés par l’usufruit du conjoint survivant.
Surtout, la stipulation de ce type de legs exprime, par hypothèse, la volonté du défunt de réduire la quotité légale revenant au conjoint survivant.
Il serait dès lors totalement contraire à cette volonté d’intégrer les legs non rapportables dans l’assiette de l’usufruit.
Cette conclusion conduit immédiatement à se demander ce qu’il en est des legs réductibles, car empiétant sur la réserve.
Pour les auteurs, dans la mesure où l’action en réduction appartient aux seuls héritiers réservataires, quand bien même un legs préciputaire serait réductible, il n’y a pas lieu de le comprendre dans l’assiette de l’usufruit du conjoint survivant.
À ce jour, la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question, de sorte que l’incertitude reste de mise.
Afin de prévenir tout litige, le mieux pour le testateur serait sans doute d’exprimer avec précision son intention en écartant les legs préciputaires du champ de l’usufruit du conjoint survivant ou en prévoyant que cet usufruit ne pourra s’exercer que sur la portion réductible du legs.
iv. L’imputation des libéralités entre époux
Pour mémoire, l’article 758-6 du Code civil prévoit que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession ».
Il ressort de cette disposition que les libéralités consenties par le prémourant au conjoint survivant ne se cumulent pas aux droits dont il est titulaire en sa qualité d’héritier ab intestat, elles viennent, au contraire, en déduction de ces mêmes droits.
Si ce mécanisme se conçoit bien lorsque le conjoint survivant opte pour des droits en pleine propriété, il ne paraît pas pouvoir jouer lorsque ce dernier opte pour l’usufruit, à tout le moins pas dans tous les cas.
On sait, en effet, que les donations et les legs ne sont pas compris dans l’assiette de l’usufruit légal. Il n’y aurait, dès lors, pas de sens à les imputer d’une masse dont ils sont d’ores et déjà exclus.
Il pourrait éventuellement être admis que le mécanisme d’imputation énoncé à l’article 758-6 du Code civil puisse jouer en présence d’un legs rapportable.
Dans cette hypothèse, il y a lieu toutefois de distinguer selon que le legs consiste en la transmission d’un droit en usufruit ou en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit
- Lorsque le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en usufruit, il y aurait lieu, en toute logique, d’imputer ce legs sur l’usufruit légal.
- Bien que conforme à la lettre de l’article 758-6 du Code civil, de l’avis général des auteurs cette approche ne saurait toutefois prospérer.
- En consentant un legs au profit du conjoint survivant, le prémourant a, en effet, entendu lui octroyer un droit supplémentaire qui s’ajoute aux droits qu’il tient de la loi.
- Or en faisant jouer le mécanisme d’imputation, cela revient à affecter la vocation légale du conjoint survivant, l’assiette de son usufruit étant réduite à due concurrence du legs qu’il a reçu.
- En l’absence de ce legs, il aurait pourtant pu prétendre exercer son droit d’usufruit sur la totalité des biens du défunt par le seul effet de la loi.
- Aussi, au lieu de procurer un avantage au conjoint survivant, le legs reçu lui causerait une perte, ce qui, pour reprendre les mots du Professeur Grimaldi, serait « absurde »[4].
- Pour cette raison, il y a lieu de considérer que, en présence de legs en usufruit, le mécanisme d’imputation prévu à l’article 758-6 du Code civil doit être purement et simplement écarté.
- La situation est en revanche légèrement différente lorsque le legs – rapportable – consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété.
- Le legs rapportable consiste en la transmission d’un droit en pleine propriété
- Dans cette hypothèse, il est admis que le mécanisme d’imputation puisse jouer mais uniquement pour ce qui concerne la nue-propriété du bien légué.
- Plus précisément, il y aura lieu d’imputer à l’usufruit légal la seule valeur de la nue-propriété du legs.
- Pour le reste, soit pour l’usufruit du bien légué, le mécanisme de l’imputation ne produit pas ses effets, pour les raisons précédemment évoquées.
- Il peut être observé que, ici, la stipulation d’un legs en pleine propriété au conjoint survivant a pour conséquence de restreindre l’assiette de son usufruit légal, de sorte que celui-ci perd son caractère universel.
b.2. L’exercice de l’usufruit
b.2.1. L’objet de l’usufruit
En application de l’article 757 du Code civil, l’usufruit légal du conjoint survivant a vocation à s’exercer sur le patrimoine du défunt, lequel constitue une universalité de droit.
Aussi, l’assiette du droit du conjoint survivant est constituée par l’ensemble des biens qui composent de ce patrimoine et non par le patrimoine pris dans sa globalité.
La conséquence en est que, si l’usufruitier peut jouir des biens qui relèvent de l’assiette de son droit, il lui est fait interdiction, en revanche, d’en disposer, sauf à ce que, au nombre de ces biens, figurent des choses consomptibles auquel cas il sera autorisé à les restituer en valeur.
L’article 587 du Code civil prévoit en ce sens que « si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».
En contrepartie du droit de jouir d’une chose consomptible, l’usufruitier a donc l’obligation de restituer, à l’expiration de l’usufruit, soit une chose de même qualité et de même quotité, soit son équivalent en argent.
S’agissant des choses consomptibles, le nu-propriétaire perd donc, de fait, les prérogatives attachées à l’abusus, de sorte qu’il n’exerce plus aucun droit réel sur la chose. Au fond, il n’est qu’un simple créancier de l’usufruitier.
b.2.2. La durée de l’usufruit
L’article 617, al. 1 prévoit que « l’usufruit s’éteint […] par la mort de l’usufruitier ».
Le principe, c’est donc que l’usufruit est viager, ce qui implique qu’il prend fin au décès de l’usufruitier.
À cet égard, l’usufruit est attaché à la personne. Il en résulte qu’il n’est pas transmissible à cause de mort.
b.2.3. Les droits et obligations de l’usufruitier
L’usufruit légal pour lequel le conjoint survivant est susceptible d’opter est régi par les articles 578 à 624 du Code civil.
i. Les droits de l’usufruitier
La constitution d’un usufruit sur une chose opère un démembrement du droit de propriété : tandis que le nu-propriétaire conserve l’abusus, l’usufruitier recueille l’usus et le fructus.
Au vrai, cette répartition des prérogatives entre ces deux titulaires de droits réels n’est pas tout à fait exacte, en ce sens que le démembrement du droit de propriété n’est pas une opération à somme nulle.
En toute logique, la somme des démembrements du droit de propriété devrait être égale au tout que constitue la pleine propriété, soit rassemblée dans tous ses attributs.
Tel n’est pourtant pas le cas. Il suffit pour s’en convaincre d’observer que le démembrement du droit de propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire ne permet, ni à l’un, ni à l’autre de détruire le bien, alors même qu’il s’agit d’une prérogative dont est investi le plein propriétaire.
Ce constat a conduit des auteurs à relever que « quantitativement, l’usufruitier a moins de pouvoir que le propriétaire n’en perd… ; quant au nu-propriétaire, il a moins de pouvoir que ce qu’il aurait si son droit était ce qu’il reste de la propriété après ablation de l’usus et du fructus »[5].
En tout état de cause, il peut être relevé que l’usufruitier est titulaire de deux sortes de droits
- Les droits qui s’exercent sur la chose
- Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
==>Les droits qui s’exercent sur la chose
Les droits de l’usufruitier sur la chose comprennent l’usus et le fructus, l’abus relevant des prérogatives du nu-propriétaire.
L’usus permet à l’usufruitier d’utiliser la chose pour ses besoins personnels ou pour autrui, comme habiter une maison ou utiliser une voiture, et même de donner la chose à bail ou de l’exploiter économiquement. Selon l’article 597 du Code civil, l’usufruitier jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits que pourrait jouir le propriétaire.
Concernant les choses qui se détériorent par l’usage (comme le linge, les meubles), l’usufruitier peut les utiliser selon leur destination et doit les restituer dans l’état où ils se trouvent à la fin de l’usufruit, à moins qu’il n’ait agi avec dol ou faute.
Si l’usufruitier utilise de façon inappropriée la chose, il engage sa responsabilité. De plus, il doit utiliser la chose selon la destination prévue par l’acte de constitution de l’usufruit, respectant les habitudes d’usage antérieures sans commettre d’abus de jouissance.
Pour la conclusion de baux, l’usufruitier peut généralement les conclure seul si leur durée est inférieure à neuf ans. Cependant, pour les baux de plus longue durée ou ceux portant sur un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, l’usufruitier doit obtenir l’accord du nu-propriétaire ou une autorisation judiciaire, sous peine de nullité du bail.
Le fructus, quant à lui, confère le droit de percevoir les fruits de la chose, qu’ils soient naturels, industriels ou civils. Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre ou des animaux, les fruits industriels sont obtenus par la culture, et les fruits civils comprennent les loyers, les intérêts et les arrérages des rentes. Les fruits sont acquis par l’usufruitier dès l’ouverture de son droit et selon des modalités spécifiques qui dépendent de leur nature.
==>Les droits qui s’exercent sur l’usufruit
L’usufruitier bénéficie non seulement d’un droit direct sur la chose dont il a la jouissance, mais il peut aussi aliéner ce droit et initier des actions judiciaires pour en garantir la protection.
- Le droit d’aliéner l’usufruit
- Principe
- Selon l’article 595 du Code civil, l’usufruitier peut exploiter directement l’usufruit, le donner à bail, le vendre ou le céder gratuitement.
- Il peut également constituer une sûreté réelle sur l’usufruit et l’apporter en société.
- L’usufruit peut aussi être saisi.
- Limites
- L’aliénation de l’usufruit est limitée par son intransmissibilité à cause de mort, son caractère temporaire, et toute clause d’inaliénabilité inscrite dans l’acte de constitution.
- Portée
- L’aliénation n’affecte pas la durée de l’usufruit, qui s’éteint soit à la mort de l’usufruitier, soit à l’expiration du terme fixé.
- Le cédant de l’usufruit est responsable des préjudices causés au nu-propriétaire par le cessionnaire.
- Principe
- Le droit d’agir en justice
- Action confessoire
- Cette action permet à l’usufruitier de faire reconnaître son droit de jouissance et d’obtenir la délivrance de la chose détenue par un tiers ou le nu-propriétaire.
- Contrairement à l’action en revendication, cette action est prescriptible et doit être exercée dans un délai de trente ans.
- Action personnelle
- L’usufruitier peut intenter une action personnelle, surtout contre le nu-propriétaire et ses ayant droits, pour obtenir la délivrance de la chose ou pour sanctionner les troubles de jouissance.
- Cette action peut aussi viser à engager la responsabilité du nu-propriétaire pour des actes préjudiciables.
- Action confessoire
ii. Les obligations de l’usufruitier
Il ressort de l’article 601 du Code civil que l’usufruitier est tenu « de jouir en bon père de famille » du bien soumis à l’usufruit.
Dit autrement, cela signifie que le droit d’usufruit doit s’exercer dans le respect du droit de propriété du nu-propriétaire.
De ce devoir général qui pèse sur la tête de l’usufruitier découlent plusieurs obligations très concrètes au nombre desquelles figurent :
- L’obligation de conserver la substance de la chose
- L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
==>L’obligation de conserver la substance de la chose
L’article 578 du Code civil prévoit que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. »
Il ressort de cette disposition que l’une des principales obligations de l’usufruitier, c’est de conserver la substance de la chose.
Par substance, il faut entendre les caractères substantiels du bien, ceux qui le structurent et sans lesquels il perdrait son identité.
L’obligation pour l’usufruitier de conserver la substance de la chose emporte plusieurs conséquences ;
- Interdiction de détruire ou détériorer la chose
- La première conséquence de l’obligation de conservation de la substance de la chose consiste en l’interdiction de lui porter atteinte.
- Il est, de sorte, fait défense à l’usufruitier de détruire la chose ou de la détériorer.
- À cet égard, l’article 618 du Code civil prévoit que l’usufruit peut cesser « par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. »
- La destruction et la détérioration de la chose sont ainsi susceptibles d’être sanctionnées par la déchéance de l’usufruit, laquelle peut être sollicitée par le nu-propriétaire.
- L’usufruitier engagera également sa responsabilité en cas de perte de la chose, sauf à démontrer la survenance d’une cause étrangère.
- Accomplissement d’actes conservatoires
- Pour conserver la substance de la chose, il échoit à l’usufruitier d’accomplir tous les actes conservatoires requis.
- Cette obligation s’applique en particulier lorsque l’usufruit a pour objet une créance.
- Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’usufruitier d’engager tous les actes nécessaires à sa conservation : recouvrement, renouvellement des sûretés, interruption des délais de prescription, action.
- Usage de la chose conformément à sa destination :
- Bien que le Code civil soit silencieux sur ce point, il est fait obligation à l’usufruitier d’utiliser la chose conformément à la destination prévue dans l’acte de constitution de l’usufruit.
- Cela signifie, autrement dit, que l’usufruitier doit se conformer aux habitudes du propriétaire qui a usé de la chose avant lui, sauf à commettre un abus de jouissance.
- Par exemple, il lui est interdit de transformer un immeuble à usage d’habitation en local qui abriterait une activité commerciale.
- Obligation d’information en cas d’altération de la substance de la chose :
- Dans un arrêt du 12 novembre 1998, la Cour de cassation a qualifié le portefeuille de valeurs mobilières d’universalité de fait (Cass. 1ère civ. 12 nov. 1998, n°96-18041)
- Or lorsque l’usufruit porte sur une universalité de fait, le droit dont est investi l’usufruitier a pour assiette, non pas les biens qui la composent, mais l’ensemble constitué par ces biens, soit le tout.
- Il en résulte que l’usufruitier est seulement tenu de conserver l’universalité, prise dans sa globalité : il ne peut pas en disposer, ni la détruire.
- Pendant toute la durée de l’usufruit, il est, en revanche, libre de disposer de chacun des éléments qui composent l’universalité.
- Lorsque l’universalité consiste en un portefeuille de valeurs mobilières, il est un risque que le nu-propriétaire soit spolié par l’usufruitier.
- Aussi, afin de prévenir cette situation, la Cour de cassation a instauré une obligation d’information du nu-propriétaire sur la modification du contenu du portefeuille de valeurs mobilières (Cass. 3e civ. 3 déc. 2002, n°00-17870).
- Cette obligation d’information instituée par la Cour de cassation doit être exécutée pendant toute la durée de l’usufruit, l’objectif recherché étant que le nu-propriétaire puisse, en cas de manquement grave de l’usufruitier, engager toutes les actions nécessaires à la préservation de ses droits.
==>L’obligation de s’acquitter des charges usufructuaires
Les charges usufructuaires ne sont autres que l’ensemble des défenses et des frais qui incombent à l’usufruitier en contrepartie de la jouissance de la chose.
Au nombre des charges usufructuaires figurent :
- Les charges périodiques
- Les frais et dépenses de réparation
Lorsque l’usufruit est universel ou à titre universel, pèse sur l’usufruitier une autre catégorie de charges usufructuaires : les intérêts du passif attaché au patrimoine ou à la quotité de patrimoine dont il jouit.
- Les charges périodiques
- L’article 608 du Code civil dispose que « l’usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l’héritage, telles que les contributions et autres qui dans l’usage sont censées charges des fruits. »
- Sont ici visées ce que l’on appelle les charges périodiques, soit celles qui sont afférentes à la jouissance du bien. Leur périodicité est en générale annuelle.
- Tel est notamment le cas des charges fiscales au nombre desquelles figurent, l’impôt sur les revenus générés par le bien, la taxe d’habitation, la taxe foncière, les charges de copropriété relatives aux services collectifs.
- Les charges périodiques incombent à l’usufruitier dans la mesure où elles sont directement attachées à la jouissance du bien.
- Les frais et dépenses de réparation
- Il ressort des articles 605 et 606 du Code civil que, tant l’usufruitier, que le nu-propriétaire sont tenus de supporter la charge des réparations du bien.
- Ces réparations peuvent être de deux ordres :
- D’une part, il peut s’agir de dépenses d’entretien, soit des dépenses qui visent à conserver le bien en bon état
- D’autre part, il peut s’agir de grosses réparations, soit des dépenses qui visent à remettre en état la structure du bien
- Tandis que les dépenses d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, les grosses réparations sont, quant à elles, à la charge du nu-propriétaire.
- La contribution aux dettes grevant le patrimoine soumis à l’usufruit
- En tant qu’usufruitier universel, le conjoint survivant est tenu de contribuer aux dettes grevant le patrimoine dont il jouit.
- L’idée qui préside à l’obligation de contribution de l’usufruitier à la dette est qu’il jouit d’un patrimoine.
- Or un patrimoine consiste en une corrélation entre un actif et un passif.
- Il en résulte que la jouissance de l’actif s’accompagne nécessairement d’une contribution aux dettes qui composent le passif.
- C’est la raison pour laquelle, le Code civil met à la charge de l’usufruitier le règlement des intérêts de la dette, lesquels ne sont autres que l’équivalent des revenus engendrés par le patrimoine soumis à l’usufruit.
- Par ailleurs, en application de l’article 610 du Code civil l’usufruitier universel doit supporter la charge des arrérages à proportion de l’étendue de son usufruit.
b.2.4. La conversion de l’usufruit
L’usufruit est susceptible de procurer bien des avantages au conjoint survivant à commencer par le contrôle direct du patrimoine du défunt, ce qui lui permet non seulement de jouir des biens qui le composent, mais encore d’en percevoir les fruits, lui assurant ainsi la conservation de son cadre de vie.
L’exercice de droits en usufruit n’est toutefois pas sans présenter des inconvénients économiques pour l’usufruitier.
En effet, l’usufruit implique pour le conjoint survivant de supporter les charges attenantes, ce qui suppose de percevoir des revenus suffisants. Pour y parvenir, la solution pourrait résider dans la vente de certains biens. Cette prérogative n’appartient toutefois pas à l’usufruitier.
La position des nus-propriétaires n’est pas plus confortable, dans la mesure où ils voient leurs parts successorales gelées. Par ailleurs, ils peuvent craindre une mauvaise gestion des biens qui leur reviennent par le conjoint survivant.
Compte tenu de ces inconvénients liés au démembrement de la propriété du défunt, le législateur a institué un dispositif permettant de sortir de cette situation. Ce dispositif consiste à autoriser la conversion de l’usufruit, soit en rente viagère, soit en capital.
Sous l’empire du droit antérieur, l’usufruit ne pouvait être converti qu’en rente viagère. Quant à la demande, elle ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
Le droit à la conversion était ainsi unilatéral, ce qui avait pour conséquence de conférer aux héritiers par le sang un pouvoir considérable sur les conditions de vie du conjoint survivant après le décès du défunt, sans nécessairement prendre en compte les besoins ou les préférences de ce dernier.
Aussi, cette situation était-elle susceptible de placer le conjoint survivant dans une position de dépendance, où ses intérêts financiers et son bien-être pouvaient être compromis par des décisions prises uniquement dans l’intérêt des héritiers.
Conscient que les règles alors en vigueur pouvaient être source de nombreuses tensions, le législateur a apporté une réponse à l’occasion de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001.
Cette loi a non seulement admis que la demande de conversion de l’usufruit puisse être formulée par le conjoint survivant, mais encore elle a introduit la possibilité de solliciter une conversion de l’usufruit en capital.
Dans les deux cas, la conversion de l’usufruit obéit à des règles communes.
i. La conversion de l’usufruit en rente viagère
==>Définition
L’article 759 du Code civil prévoit que « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir, donne ouverture à une faculté de conversion en rente viagère, à la demande de l’un des héritiers nus-propriétaires ou du conjoint successible lui-même ».
Il ressort de cette disposition que l’usufruit dont est titulaire le conjoint survivant peut être converti en rente viagère.
Concrètement, l’opération de conversion consiste pour le conjoint survivant à renoncer à son droit d’usufruit et à toutes les prérogatives qui y sont attachées et à accepter, en contrepartie, de recevoir une rente périodique fixée pour le reste de sa vie.
Il s’agit ainsi pour le conjoint survivant d’abandonner un droit réel (l’usufruit) à la faveur d’un droit de créance (rente viagère) contre les héritiers.
La conversion en rente viagère assure au conjoint survivant un revenu régulier et prévisible, indépendamment des variations potentielles de la valeur ou de l’état des biens en usufruit. Cela peut être particulièrement important pour répondre aux besoins matériels du conjoint âgé et ainsi lui assurer une sécurité financière.
En transformant l’usufruit en rente viagère, les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété des biens, ce qui simplifie la gestion des biens, évite les complications potentielles liées à la coexistence de l’usufruit et de la nue-propriété, et permet une transmission patrimoniale plus directe.
L’opération de conversion peut encore servir à prévenir ou résoudre des conflits entre le conjoint survivant et les autres héritiers, notamment en cas de désaccords sur la gestion des biens ou leur affectation future.
==>Domaine de la conversion
- Principe
- Sous l’empire du droit antérieur, la conversion n’était admise qu’en présence d’un usufruit légal.
- La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a étendu le domaine de la conversion en prévoyant que l’opération puisse porter sur « tout usufruit appartenant au conjoint sur les biens du prédécédé, qu’il résulte de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- Ainsi, désormais, la conversion peut porter, tant sur un usufruit légal que sur un usufruit résultant d’une libéralité.
- Lorsque, toutefois, l’usufruit a pour origine une libéralité, il ne peut s’agir que d’une libéralité à cause de mort.
- Lorsque, en effet, l’usufruit résulte d’une donation entre vifs, il est insusceptible de faire l’objet d’une conversion.
- La raison en est que les donations entre vifs sont irrévocables. Or l’opération de conversion viendrait porter atteinte à ce principe, puisque transformant en droit réel en droit personnel.
- En outre, la liste énoncée à l’article 759 du Code civil est limitative et elle ne vise que l’usufruit résultant « de la loi, d’un testament ou d’une donation de biens à venir ».
- S’agissant, en revanche, de l’assiette de l’usufruit, elle est indifférente.
- En visant « tout usufruit », l’article 759 admet, en effet, que la conversion puisse avoir pour objet, tant un usufruit universel ou à titre universel, qu’un usufruit légué à titre particulier, soit s’exerçant sur un bien déterminé.
- Limite
- Tous les biens relevant de l’assiette de l’usufruit ne peuvent pas faire l’objet d’une conversion.
- L’article 760, al. 3 du Code civil prévoit, en effet, que « le juge ne peut ordonner contre la volonté du conjoint la conversion de l’usufruit portant sur le logement qu’il occupe à titre de résidence principale, ainsi que sur le mobilier le garnissant ».
- Lorsqu’ainsi, la demande de conversion de l’usufruit est soumise au juge en raison d’un désaccord entre les parties, le conjoint dispose d’un droit de véto pour ce qui concerne le logement qu’il occupe à titre de résidence principale ainsi que pour les meubles meublants.
- Aussi, la conversion ne sera possible qu’à la condition que le conjoint survivant ait préalablement donné son accord.
- À défaut, l’opération se réalisera sur tous les autres biens à l’exception du logement dans lequel est établi le conjoint survivant.
- Cette règle vise à permettre au conjoint survivant de conserver son cadre de vie.
==>Auteurs de la demande de conversion
Sous l’empire du droit antérieur, la demande de conversion de l’usufruit ne pouvait être formulée que par les seuls héritiers par le sang.
La loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 a mis fin à cette restriction en ouvrant cette faculté au conjoint survivant.
Désormais, les héritiers par le sang et le conjoint survivant sont donc placés sur un pied d’égalité.
À cet égard, l’article 759-1 du Code civil précise que « la faculté de conversion n’est pas susceptible de renonciation. Les cohéritiers ne peuvent en être privés par la volonté du prédécédé. »
Il ressort de cette disposition qu’il ne peut être dérogé par voie de testament à la règle conférant aux héritiers la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit. Il s’agit là d’une règle d’ordre public.
La question s’est posée de savoir si cette règle visait les seuls héritiers par le sang ou si elle valait également pour le conjoint survivant.
La doctrine majoritaire incline vers la seconde alternative dans la mesure où le conjoint survivant appartient désormais à la catégorie des héritiers ab intestat. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne saurait être privé de la faculté de solliciter la conversion de l’usufruit pour lequel il a initialement opté.
==>La procédure de conversion
La conversion de l’usufruit peut être amiable ou judiciaire.
- La conversion amiable
- En principe l’opération de conversion de l’usufruit ne requiert pas l’intervention d’un juge.
- Les parties peuvent opérer en toute autonomie pourvu qu’elles trouvent un accord.
- À cet égard, elles devront notamment déterminer le montant de la rente et les sûretés éventuelles garantissant son paiement
- S’agissant du montant de la rente
- Il est de principe qu’il doive être équivalent à la valeur de l’usufruit.
- La question qui alors se pose est de savoir comment évaluer concrètement le montant de la rente.
- La méthode d’évaluation généralement retenue consiste à évaluer le revenu net réel que l’usufruit est susceptible de procurer au conjoint survivant en se rapportant aux rendements potentiels des biens usufruitiers.
- Pour ce faire, on commence par analyser les revenus réels générés par les biens au cours des années précédentes, ajustés pour les dépenses nécessaires pour maintenir ces biens.
- Ensuite, on projette ces revenus dans l’avenir, en tenant compte des éventuelles moins-values ou plus-values susceptibles d’affecter les biens et qui pourraient influencer les rendements futurs.
- Le revenu net est alors estimé après déduction de toutes les charges et dépenses nécessaires à la gestion et à l’entretien des biens.
- Cette méthode est souvent considérée comme plus équitable pour l’usufruitier, car elle reflète mieux le potentiel économique réel des biens.
- S’agissant de la date d’évaluation du montant de la rente, les parties doivent se placer au jour de la conversion.
- Par ailleurs, parce que la conversion s’analyse en une opération de partage, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer.
- Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
- S’agissant des sûretés garantissant le paiement de la rente
- Les parties peuvent s’entendre sur la fourniture, tant de sûretés réelles (hypothèse, nantissement), que de sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome etc.)
- En tout état cause, le paiement de la rente est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- S’agissant du montant de la rente
- La conversion judiciaire
- L’article 760, al. 1er du Code civil prévoit que « à défaut d’accord entre les parties, la demande de conversion est soumise au juge. »
- Ainsi, si les héritiers et le conjoint survivant ne s’entendent pas, soit sur le principe de la conversion, soit sur ses modalités, il leur faudra solliciter l’intervention du juge auquel il appartiendra de trancher.
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
- Sous l’empire du droit antérieur, lorsque les héritiers formulaient une demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère, le juge n’avait d’autre choix que d’accéder à cette demande à laquelle il était lié.
- Désormais, la règle en vigueur confère au juge la faculté de refuser la conversion.
- Ce pouvoir dont est investi le juge s’infère du deuxième alinéa de l’article 760 qui prévoit que « s’il fait droit à la demande de conversion, le juge détermine le montant de la rente, les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs, ainsi que le type d’indexation propre à maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit. »
- Aussi, le juge peut décider de ne pas faire droit à la demande formulée, soit par le conjoint survivant, soit par les héritiers par le sang au motif que cela porterait atteinte aux intérêts de l’une ou l’autre partie.
- Le juge prendra notamment en considération l’âge, les ressources et les besoins du conjoint survivant.
- En tout état de cause, l’appréciation des intérêts en présence relève du pouvoir souverain du juge.
- Sur les modalités de la rente
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- D’une part, « le montant de la rente » à allouer au conjoint survivant, lequel doit être équivalent à la valeur de l’usufruit auquel ce dernier renonce
- D’autre part, « les sûretés que devront fournir les cohéritiers débiteurs » aux fins de garantir le paiement de la rente et donc prévenir le risque d’insolvabilité du débirentier.
- Enfin, « le type d’indexation de la rente », de sorte que cette dernière ne subisse pas les effets d’une dépréciation monétaire. Le choix de l’indice est libre pourvu qu’il soit de nature à « maintenir l’équivalence initiale de la rente à l’usufruit ». Il peut s’agir, par exemple, de l’indice des prix à la consommation (IPC) ou encore de l’indice du SMIC.
- Lorsque le juge accède à la demande de conversion de l’usufruit, l’article 760, al. 2 du Code civil lui commande de déterminer :
- Sur le délai d’exercice de la demande de conversion
- Il peut être observé que la demande judiciaire de conversion de l’usufruit en rente viagère peut, selon l’article 760 al. 1er du Code civil, « être introduite jusqu’au partage définitif. »
- Cela signifie, a contrario, que toute demande de conversion de l’usufruit postérieurement au partage définitif est irrecevable.
- Reste à déterminer de quel partage définitif parle-t-on ?
- Les auteurs s’accordent à distinguer deux hypothèses :
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de la nue-propriété (V. en ce sens Cass. civ. 22 avr. 1950)
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce sur la totalité des biens du défunt
- Sur l’autorisation de la demande de conversion
-
-
-
-
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Dans cette hypothèse, le partage définitif doit s’entendre de celui de l’usufruit et non de la nue-propriété entre héritiers, dans la mesure où c’est cette opération qui marque la liquidation des droits du conjoint survivant.
- Le droit d’usufruit du conjoint survivant s’exerce seulement sur une quotité des biens du défunt
- Quant à l’hypothèse où aucun partage n’aurait vocation à intervenir compte tenu de l’absence d’indivision entre nus-propriétaires (hypothèse de l’enfant unique), il est admis que la demande de conversion n’est enfermée dans aucun délai.
-
-
-
==>Effets
Dans la mesure où la conversion de l’usufruit en rente viagère s’analyse en une opération de partage, elle devrait, en principe, être assortie d’un effet déclaratif.
Pour mémoire, l’effet déclaratif est celui qui est attaché à un acte qui ne crée pas de situation juridique nouvelle, mais se limite à constater un droit préexistant.
L’une des principales conséquences de l’effet déclaratif est la rétroactivité des effets produits par l’acte.
En toute logique, l’opération de conversion de l’usufruit en rente viagère devrait donc produire un effet rétroactif.
Concrètement, cela devrait impliquer que le conjoint survivant soit réputé être créancier d’une rente viagère dès le jour d’ouverture de la succession.
Tel n’est pourtant pas ce qui a été décidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 novembre 1987.
Aux termes de cette décision, elle a jugé que « la demande de conversion, ayant pour objet de substituer une rente viagère à l’usufruit préexistant, ne peut produire ses effets que pour l’avenir, sans porter atteinte à l’effet déclaratif du partage » (Cass. 1ère civ. 24 nov. 1987, n°85-18.285).
Ainsi, pour la Première chambre civile, l’opération de conversion de l’usufruit ne produit aucun effet rétroactif ; elle n’opère que pour l’avenir.
Les raisons qui l’ont conduite à adopter cette solution sont multiples :
- Tout d’abord, la rétroactivité de la conversion de l’usufruit en rente viagère pourrait affecter les droits des tiers lesquels sont susceptibles d’avoir contracté des engagements avec le conjoint survivant en considération de l’existence de l’usufruit. Si un usufruitier a, par exemple, grevé son usufruit d’hypothèques ou de charges réelles la rétroactivité pourrait être de nature à remettre en cause la constitution de ces droits.
- D’autre part, la rétroactivité de la conversion pourrait nécessiter une réévaluation des fruits et autres bénéfices perçus par conjoint survivant pendant toute la période où il était titulaire de l’usufruit. Cela pourrait alors être source de litiges potentiels sur la détermination exacte des montants dus sous forme de rente depuis le décès.
- Enfin, l’usufruit est un droit réel qui confère à l’usufruitier un pouvoir direct sur la chose, tandis que la rente viagère constitue un droit de créance. Le passage d’un droit réel à un droit de créance n’est pas anodin et implique un changement fondamental dans la nature des droits du bénéficiaire. La rétroactivité de ce changement pourrait créer des incohérences juridiques, surtout s’agissant des droits exercés et des responsabilités assumées pendant la période d’usufruit.
La solution – heureuse – adoptée par la Haute juridiction a, non seulement été accueillie favorablement par la doctrine ; surtout, elle a été consacrée par le législateur à l’occasion de la réforme opérée par la loi du 3 décembre 2001.
Tout en confirmant que la conversion de l’usufruit s’analyse en une opération de partage, l’article 762 précise que, en revanche, « elle ne produit pas d’effet rétroactif, sauf stipulation contraire des parties. »
Il en résulte que le conjoint survivant est admis à conserver les fruits perçus pendant toute la période de l’usufruit. En contrepartie, il ne peut prétendre au versement rétroactif d’aucuns arrérages.
L’article 762 autorise toutefois les parties à stipuler le contraire dans l’acte de conversion de l’usufruit.
ii. La conversion de l’usufruit en capital
Sous l’empire du droit antérieur, la conversion de l’usufruit ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi d’une rente viagère.
La conversion en capital, soit l’opération consistant à racheter l’usufruit du conjoint survivant moyennant le versement d’une somme d’argent forfaitaire, n’était envisagée par aucun texte.
Est-ce à dire qu’il s’agissait d’une pratique interdite ? La réponse est non. La conversion de l’usufruit en capital était pratiquée par les notaires.
La Cour de cassation avait toutefois encadré cette pratique en précisant dans un arrêt du 6 juin 1990 qu’elle ne pouvait se faire qu’à la condition que les deux parties aient donné leur accord (Cass. 1ère civ. 6 juin 1990, n°88-20.458).
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur est venu consacrer la faculté pour les parties de convertir l’usufruit du conjoint survivant en capital.
L’article 761 du Code civil prévoit en ce sens que « par accord entre les héritiers et le conjoint, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit du conjoint en un capital. »
Tout d’abord, il ressort de cette disposition que la conversion de l’usufruit en capital ne peut intervenir qu’à la condition que les deux parties y consentent.
Aussi, cette opération ne saurait être imposée par les héritiers par le sang au conjoint survivant et inversement.
Ensuite, s’agissant de la détermination du prix de rachat de l’usufruit, les parties sont libres de choisir la méthode d’évaluation qui leur sied, pourvu que ce prix soit équivalent à la valeur de l’usufruit.
À cet égard, elles pourront notamment se reporter au barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
Selon ce barème, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
Il en résulte que :
Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra calculer le prix de rachat de l’usufruit.
Par ailleurs, il peut être observé que la conversion de l’usufruit en capital peut tout autant porter sur tous les biens du défunt, que sur certains biens déterminés.
Le conjoint survivant peut, en effet, préférer céder son droit d’usufruit petit à petit à mesure de ses besoins financiers.
Enfin, à l’instar de la conversion en rente viagère, la conversion en capital s’analyse en une opération de partage de sorte que :
- D’une part, le paiement du prix est garanti par le privilège du copartageant, lequel est devenu une hypothèque spéciale (art. 2042, 4° C. civ.).
- D’autre part, en cas de lésion de plus d’un quart, les héritiers ou le conjoint survivant peuvent exercer une action en complément de part qui visera soit à augmenter le montant de la rente, soit à le diminuer. Cette action est régie par les articles 889 à 892 du Code civil.
En revanche, comme énoncé par l’article 762 in fine du Code civil, la conversion en capital n’est assortie d’aucun effet rétroactif.
2.1.2. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs
L’article 757 du code civil prévoit, pour mémoire, que, en présence d’enfants non communs, le conjoint survivant ne dispose pas de la faculté d’opter pour l’usufruit sur la totalité des biens du défunt. Le texte lui impose de recevoir le quart des biens en pleine propriété.
Le de cujus demeure toutefois libre d’en disposer autrement en octroyant au conjoint survivant, par un acte de volonté, l’usufruit sur tout ou partie de ses biens. Cette libéralité devra se faire conformément aux règles régissant la quotité disponible spéciale.
S’agissant de la liquidation des droits du conjoint survivant en présence d’enfants non communs, elle répond aux mêmes règles que la liquidation des droits intervenant en présence d’enfants communs.
Compte tenu de ce que le conjoint survivant se voit attribuer un quart des biens en pleine propriété, il conviendra donc :
- Dans un premier temps, de déterminer la consistante de l’assiette sur laquelle sera prélevée la quote-part revenant au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse de calcul
- Dans un deuxième temps, de déterminer les biens relevant de la masse de calcul qui supporteront le prélèvement de la quote-part attribuée au conjoint survivant : il s’agit ici d’évaluer la masse d’exercice
- Dans un dernier temps, d’imputer sur la masse d’exercice les libéralités éventuellement consenties par le prémourant au profit du conjoint survivant
2.2. La liquidation des droits du conjoint survivant en présence des père et mère
Pour mémoire, en application de l’article 757-1 du Code civil, en absence de descendants et lorsque le défunt laisse derrière lui ses père et mère ou l’un d’entre eux, le conjoint survivant a vocation à recevoir une quote-part de la succession en pleine propriété.
À cet égard, le texte distingue deux situations :
- Le défunt laisse derrière lui son père et sa mère
- Dans cette hypothèse, le conjoint survivant dit l’article 757-1 « recueille la moitié des biens ».
- Quant à l’autre moitié, elle est « dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère. »
- Le défunt laisse derrière un seul de ses père et mère
- L’article 757-1 prévoit que « quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. »
- Cela signifie que le conjoint survivant recueille, au total, les trois quarts de la succession en pleine propriété.
S’agissant de la liquidation des droits en conjoint survivant, il y a lieu d’observer que les père et mère ont perdu leur statut d’héritier réservataire.
Il en résulte que, au stade du calcul de la masse d’exercice, ne pourront être déduits du résultat obtenu après la détermination de la masse de calcul que les libéralités et les biens faisant l’objet d’un droit de retour.
S’agissant de ces derniers, leur sort n’est pas sans soulever des difficultés. S’il ne fait aucun doute que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être exclus de la masse d’exercice, l’article 758-5, al. 2e du Code civil le prévoyant expressément, la question s’est posée de savoir s’ils devaient également être déduits de la masse de calcul.
Pour les auteurs, dans la mesure où le droit de retour, d’une part, ne peut s’exercer que dans la limite de la quote-part dévolue aux père et mère et, d’autre part, est susceptible de faire l’objet d’une liquidation en valeur, il doit être regardé comme faisant partie intégrante de la succession et non comme suivant une dévolution autonome.
Il en résulte que les biens faisant l’objet d’un droit de retour doivent être compris dans la masse de calcul. Il n’y a pas lieu de les en exclure.
B) Le droit viager au logement
Lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, le législateur s’est donné pour ambition de conférer au conjoint survivant « des droits qui reflètent la place qu’il occupait dans la vie du défunt ».
À cet égard, il a notamment été tenu compte du souci légitime des personnes de conserver leur cadre de vie après le décès du défunt.
Si, l’octroi au conjoint survivant d’un droit d’usufruit sur la totalité des biens composant la succession répond à cette attente, cela est moins vrai dans l’hypothèse où ce dernier ne se verrait attribuer qu’une quote-part de la succession en pleine propriété.
Dans cette hypothèse, il est un risque que le conjoint survivant ne dispose pas de la capacité financière suffisante, au moment du partage des biens, pour régler la soulte due aux autres héritiers s’il souhaite conserver la pleine et entière propriété du domicile conjugale.
Aussi, afin de protéger le conjoint survivant contre le risque de précarité après le décès du défunt et plus généralement lui assurer le maintien de son cadre de vie, la loi du 3 décembre 2001 lui a accordé un droit viager au logement.
Ce droit a été consacré à l’article 764 du Code civil, lequel prévoit que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. »
Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant se voit octroyer non seulement un droit viager d’habitation sur le logement qu’il occupait avec le défunt, mais encore un droit d’usage sur les meubles meublant.
==>Un droit réel immobilier
L’article 764, al. 3e du Code civil que les droits d’usage et d’habitation reconnus au conjoint survivant « s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635. ».
Il s’en déduit qu’il s’agit de droits réels, soit de droits conférant au conjoint survivant un pouvoir direct sur la chose.
Dans un arrêt du 23 juin 1981, la Cour de cassation avait qualifié, plus précisément, les droits d’usage et d’habitation de « droits réels immobiliers », ce qui implique notamment qu’ils relèvent du dispositif de la publicité foncière (Cass. 3e civ. 23 juin 1981, n°80-11.425).
Quoi qu’il en soit, les droits d’usage et d’habitation sont regardés comme des diminutifs de l’usufruit, en ce sens qu’ils confèrent à leur titulaire un droit de jouissance restreint sur la chose.
- S’agissant du droit d’usage, il autorise à se servir de la chose et à en percevoir les fruits « qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille » (art. 630, al. 1er C. civ.).
- S’agissant du droit d’habitation, il permet seulement d’utiliser la chose aux fins seulement d’habitation. Tout au plus, dit l’article 632 du Code civil, « celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille ». Ce droit doit toutefois rester restreint « à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. »
À la différence de l’usufruit, ni le droit d’usage, ni le droit d’habitation ne peuvent être loués ou cédés (art. 631 et art. 634 C. civ.). Aussi le droit viager octroyé au conjoint survivant comprend pour seul attribut l’usus ; il est en revanche dépouillé du fructus.
==>Un droit dépourvu de caractère d’ordre public
- L’admission d’une volonté contraire
- Il s’infère de l’article 764, al. 1er du Code civil que le droit viager au logement n’est pas d’ordre public.
- Ce droit, est, en effet, octroyé au conjoint survivant « sauf volonté contraire du défunt ».
- Le de cujus dispose ainsi de la faculté de priver son conjoint des droits d’usage et d’habitation qui lui sont reconnus par la loi.
- Compte tenu de la gravité d’un tel acte, le législateur a subordonné sa validé à l’observation de conditions de forme.
- L’article 764, al. 1er précise en ce sens que, la volonté contraire du défunt doit être exprimée « dans les conditions de l’article 971 ».
- Quelles sont les exigences posées par cette disposition ? Il s’agit de celles requises pour l’établissement d’un testament authentique.
- Aussi, pour que la privation du bénéfice pour le conjoint survivant du droit viager au logement produise ses effets, elle doit être formalisée dans un testament instrumenté par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
- Dans un arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation a précisé que l’exigence d’établissement d’un testament authentique s’appliquait également pour les actes rédigés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 (Cass. 1ère civ. 15 déc. 2010, n°09-68.076).
- En parallèle, la question s’est posée de savoir si la privation du droit viager au logement devait être expressément exprimée dans le testament ou si elle pouvait être tacite.
- Pour les auteurs, il doit être admis que cette exhérédation du conjoint survivant puisse être tacite, pourvu qu’elle soit non équivoque. Elle pourrait, par exemple, se déduire de la stipulation d’un legs universel au profit d’un tiers.
- S’agissant, en revanche, de la stipulation d’un legs à titre universel ou d’un legs à titre particulier, la doctrine est partagée.
- Certains estiment, que ces libéralités emportent nécessairement exclusion du conjoint de son droit viager au logement.
- D’autres soutiennent, à l’inverse, qu’il n’y a là aucune incompatibilité.
- Le legs à titre universel ou à titre particulier dont est titulaire le tiers gratifié pourrait parfaitement coexister avec le droit viager au logement, celui-ci s’analysant alors comme une charge grevant la libéralité.
- Afin de ne laisser place à aucune ambiguïté quant au sens à donner au legs, le mieux c’est que la volonté du défunt soit expressément et clairement exprimée dans le testament authentique.
- Limite
- L’article 764, al. 2e du Code civil prévoit que « la privation de ces droits d’habitation et d’usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d’usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d’une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres »
- Il ressort de cette disposition que, quand bien même le défunt aurait exprimé sa volonté, par voie de testament authentique, de priver son conjoint de son droit viager au logement, cet acte ne fait aucunement obstacle à ce que ce dernier puisse jouir pleinement du domicile conjugal, au moyen d’une autre voie :
- soit celle de l’usufruit qu’est-ce susceptible de lui conférer la loi
- soit celle de l’usufruit dont il peut être investi au titre d’une libéralité
- Dans les deux cas, la qualité d’usufruitier du conjoint survivant pourrait ainsi faire échec à la volonté du de cujus de le priver du droit viager au logement.
- À l’analyse, cette situation sera toutefois exceptionnelle dans la mesure où le testament authentique aura, en tout état de cause, pour effet de réduire significativement l’assiette de l’usufruit dévolu au conjoint survivant, de sorte qu’il n’est pas certain que son droit d’usufruit soit suffisamment étendu pour être admis à s’exercer sur le logement convoité.
- Surtout, il est fort probable que le notaire, dont l’intervention est obligatoire, aura informé le prémourant sur l’ensemble des droits susceptibles d’être exercés par le conjoint survivant aux fins de conserver la jouissance du logement et l’aura utilement conseillé sur les leviers dont il dispose afin de rendre son testament efficace.
1. Conditions
Pour que le conjoint survivant soit fondé à se prévaloir du droit viager au logement, il doit satisfaire à plusieurs conditions qui tiennent :
- D’une part, à sa personne
- D’autre part, au logement convoité
- Enfin, à la demande d’exercice du droit
a. Condition tenant à la personne du conjoint survivant
Pour se prévaloir du droit viager au logement, le conjoint survivant doit justifier de sa qualité d’héritier.
La raison en est qu’il s’agit d’un droit de nature successorale en ce sens qu’il procède de la dévolution légale. C’est là une différence majeure avec le droit temporaire au logement que le conjoint survivant tient, non pas de sa qualité d’héritier, mais de sa qualité d’époux.
La conséquence du caractère héréditaire du droit viager au logement est que :
- D’une part, le conjoint survivant ne saurait y renoncer avant l’ouverture de la succession,
- D’autre part, il bénéficie au conjoint survivant par le seul effet du décès du défunt
- Enfin, un conjoint survivant frappé d’indignité ne saurait se prévaloir de ce droit
b. Conditions tenant au logement convoité
Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :
- Première condition
- L’article 764, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul bien qu’il « occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale ».
- Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
- D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement
- D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui était occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569).
- S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. »
- Seconde condition
- L’article 764, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
- En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
- Soit appartenir au seul défunt
- Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
- Il en résulte que le conjoint survivant ne pourra se prévaloir de la jouissance du logement au titre du droit viager lorsque :
- Soit son occupation résultait d’un contrat de bail
- Soit appartenait en indivision au défunt et à un tiers
- Soit appartenait exclusivement au défunt qu’il avait reçu d’une donation assortie d’un droit de retour
- Quant à l’hypothèse où le logement occupé par le conjoint survivant est la propriété d’une société, la réponse est incertaine.
- En effet, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 764, al. 1er du Code civil, le texte ne vise que les biens détenus directement par l’un ou l’autre époux.
- Or lorsqu’il a été acquis au moyen d’une société, la personne morale de celle-ci fait écran.
- Doit-on malgré tout admettre que, en pareille circonstance, le conjoint survivant puisse se prévaloir du droit viager au logement ?
- Si l’on se reporte à une réponse ministérielle publiée le 25 janvier 2005, il doit être répondu par la négative à cette question.
- Le garde des sceaux avait répondu en effet que « dans l’hypothèse où l’habitation familiale a été acquise par le biais d’une société civile immobilière, le logement appartient à la société et non aux époux. Les conditions de propriété prévues par les articles 763 et 764 du code civil ne sont donc pas remplies. Par conséquent, le droit d’habitation conféré par ces articles ne pourra s’appliquer que si les époux ont pris soin de conclure avec la société un bail ou une convention d’occupation. En effet, dans ce cas, le conjoint survivant pourra prétendre, conformément aux dispositions de l’article 763 susvisé, au remboursement des loyers pendant l’année suivant le décès et pourra ensuite continuer le bail ou la convention d’occupation jusqu’à sa résiliation. En revanche, si le logement de la famille est assuré par un droit d’usufruit détenu par le défunt, le décès de ce dernier a pour conséquence l’extinction de ce droit, les nus-propriétaires devenant alors plein-propriétaires. Les conditions des articles 763 et 764 du code civil se trouvent à nouveau insatisfaites. Autoriser dans ces circonstances le conjoint survivant à habiter le logement familial, même de façon temporaire, conduirait, d’une part, à étendre le dispositif civil, et, d’autre part, à faire peser sur les nus-propriétaires une charge non prévue » (Rép. min n°39324, 25 janv. 2005).
- Si l’on se tourne maintenant vers la doctrine, les auteurs soutiennent une position plus nuancée.
- Selon eux, il y aurait lieu de faire droit à la demande d’exercice du droit viager au logement par le conjoint survivant lorsque :
- Soit les parts de la société étaient détenues exclusivement par le défunt
- Soit les parts de la société étaient détenues par les deux époux
- Lorsque, en revanche, des tiers détiendraient une quote-part du capital de la société, le conjoint survivant ne devrait pas être admis à se prévaloir de son droit viager au logement.
- S’agissant des meubles meublants, le conjoint survivant pourra exercer son droit d’usage que lui reconnaît l’article 764 du Code civil à la condition que ces derniers n’appartiennent pas à des tiers.
- Il est toutefois indifférent qu’ils garnissent un logement occupé au titre d’un bail.
- L’article 765-2 du Code civil dispose en ce sens que « lorsque le logement faisait l’objet d’un bail à loyer, le conjoint successible qui, à l’époque du décès, occupait effectivement les lieux à titre d’habitation principale bénéficie du droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ».
c. Conditions tenant à la demande d’exercice du droit
Les conditions tenant à la demande d’exercice du droit viager au logement sont au nombre de deux :
- Première condition
- Le droit viager au logement n’est pas dû au conjoint survivant de plein droit.
- Pour que ce doit puisse être exercé, le conjoint survivant doit exprimer un double choix :
- D’une part, il doit accepter la succession
- D’autre part, il doit réclamer la jouissance du logement
- S’agissant de ce second choix, la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 13 février 2019 que la manifestation de volonté du conjoint survivant puisse être tacite (Cass. 1ère civ. 13 févr. 2019, n°18-10.171).
- Elle a toutefois précisé trois ans plus tard que cette manifestation de volonté « ne peut résulter du seul maintien dans les lieux » (Cass. 1ère civ. 02 mars 2022, n°20-16.674).
- Seconde condition
- L’article 765-1 du Code civil prévoit que « le conjoint dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits d’habitation et d’usage. »
- Il ressort de cette disposition que le conjoint survivant dispose d’une durée limitée pour faire valoir son droit viager au logement.
- À l’expiration du délai d’un nom, dont le décès marque le point de départ, le conjoint survivant perd son droit, sauf à trouver un accord amiable avec les autres héritiers.
- Cet accord conventionnel ne sera toutefois pas opposable aux tiers.
2. Régime
- L’imputation du droit viager au logement
- L’article 765, al. 1er du Code civil prévoit que « la valeur des droits d’habitation et d’usage s’impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. »
- Il ressort de cette disposition que le droit viager au logement ne s’additionne pas à la vocation légale du conjoint survivant ; elle s’impute au contraire sur ses droits successoraux ab intestat.
- Pour ce faire, cela suppose de déterminer la valeur du droit viager au logement.
- Faute d’indication fournie par le texte, les auteurs suggèrent de s’inspirer de la méthode de capitalisation de l’usufruit en valeur selon le barème fiscal prévu par l’article 699 du Code général des impôts.
- Concrètement, la valeur de l’usufruit est calculée comme un pourcentage de la valeur totale du bien en pleine propriété, ce pourcentage étant déterminé par l’âge de l’usufruitier au moment du décès du défunt.
- Ce calcul repose sur l’idée que plus l’usufruitier est âgé, moins longtemps il bénéficiera de l’usufruit, réduisant ainsi sa valeur.
- À cet égard :
- Pour un usufruitier de moins de 21 ans, la valeur de l’usufruit est évaluée à 90% de la valeur totale de la propriété
- Pour un usufruitier de plus de 91 ans, cette valeur est réduite à 20%.
- Prenons l’exemple d’un bien évalué à 300,000 euros. L’usufruitier est âgé de 75 ans au moment du décès du de cujus.
- Selon le barème fiscal, à 75 ans, le pourcentage de la valeur de l’usufruit pourrait être estimé autour de 30% (la valeur exacte peut varier légèrement selon les ajustements annuels du barème).
- Il en résulte que :
- Valeur de l’usufruit = 300,000 euros (valeur de la propriété) × 30% (pourcentage pour un usufruitier de 75 ans) = 90,000 euros
- La valeur de l’usufruit pour un individu de 75 ans, dans cet exemple, serait donc de 90,000 euros.
- C’est sur la base de cette valeur ainsi obtenue que l’on pourra, par exemple, imputer la libéralité en usufruit (dont la valeur est estimée à 90 000 euros) reçue par le conjoint survivant, sur des droits en pleine propriété.
- À l’analyse, on pourrait parfaitement transposer cette méthode pour l’évaluation du droit viager au logement qui n’est autre qu’un diminutif de l’usufruit.
- Une fois, la valeur de ce droit déterminée, il conviendra de retrancher le résultat obtenu au montant estimé des droits successoraux ab intestat dévolus au conjoint survivant.
- Deux situations sont alors envisageables :
- La valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux
- Dans cette hypothèse, l’article 765, al. 2e du Code civil prévoit que « le conjoint peut prendre le complément sur les biens existants. »
- Le complément sera ici égal à la différence résultant de la soustraction entre le montant des droits successoraux ab intestat dévolus au conjoint survivant et la valeur du droit viager au logement.
- La valeur des droits d’habitation et d’usage est supérieure à celle de ses droits successoraux
- Dans cette hypothèse, « le conjoint n’est pas tenu de récompenser la succession à raison de l’excédent. »
- Il faut comprendre ici que l’excédent constituera une charge qui pèsera sur la succession, laquelle devra être supportée par tous les héritiers à due proportion de leurs droits.
- La valeur des droits d’habitation et d’usage est inférieure à celle de ses droits successoraux
- Les prérogatives attachées au droit viager au logement
- L’article 764, al. 3e du Code civil prévoit que les droits d’usage et d’habitation « s’exercent dans les conditions prévues aux articles 627, 631, 634 et 635 ».
- Cette disposition opère ainsi un renvoi vers le droit commun des biens s’agissant des prérogatives attachées à son droit viager d’usage et d’habitation.
- Si l’on s’arrête un instant sur ce droit commun, il faut retenir, de façon générale, que « l’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement » (art. 627 C. civ), ce qui implique pour le titulaire de ces droits :
- D’une part, de ne pas altérer la substance de la chose ou sa valeur
- D’autre part, de jouir de la chose conformément à sa destination, soit un usage servant les seuls intérêts personnels et familiaux du titulaire du droit
- Par ailleurs, comme l’usufruitier, le titulaire du droit d’usage et d’habitation est assujetti aux obligations d’entretien et de réparation de la chose (art. 635 C. civ.).
- Plus précisément, en application de l’article 635 du Code civil, il y a lieu de distinguer deux situations :
- L’usager occupe la totalité du logement
- Dans cette hypothèse, il doit supporter l’intégralité des frais d’entretien et de réparation
- L’usager occupe partiellement le logement
- Dans cette hypothèse, il ne contribue qu’au prorata de ce qu’il jouit.
- L’usager occupe la totalité du logement
- L’extinction du droit viager au logement
- Durée
- L’article 764, al. 1er du Code civil prévoit que le droit viager au logement est conféré au conjoint survivant « jusqu’à son décès », raison pour laquelle on parle de droit viager.
- Il en résulte qu’il est insusceptible d’être transmis à cause de mort.
- Le droit viager au logement s’éteint définitivement au décès du conjoint survivant.
- Par exception, il est admis que le droit viager au logement prenne fin en cas :
- Soit de renonciation par le conjoint survivant à son droit
- Soit de destruction du bien objet du droit viager
- Soit de déchéance du droit viager en raison d’une jouissance du bien qui ne serait pas raisonnable
- Conversion
- L’article 766, al. 1er du Code civil prévoit que « le conjoint successible et les héritiers peuvent, par convention, convertir les droits d’habitation et d’usage en une rente viagère ou en capital. »
- Il ressort de cette disposition que la conversion ne pourra intervenir qu’avec l’accord de toutes les parties.
- En cas de désaccord, il ne sera, en effet, pas possible de saisir le juge qui ne saurait imposer une conversion au conjoint survivant ou aux héritiers.
- L’article 766, al. 2e précise que « s’il est parmi les successibles parties à la convention un mineur ou un majeur protégé, la convention doit être autorisée par le juge des tutelles. »
- S’agissant de l’opération de conversion, elle obéit aux mêmes règles que celles applicables à la conversion de l’usufruit.
- Durée
II) Les droits du conjoint successible contre la succession
Le conjoint survivant n’est pas seulement investi de droits qu’il tient de sa qualité d’héritier ab intestat, la loi lui reconnaît également des droits qu’il exerce contre la succession en sa qualité de créancier de la succession.
Ces droits de créance dont est titulaire le conjoint survivant contre la succession visent à assurer sa protection et sa subsistance future.
Au nombre de ces droits figurent :
- D’une part, un droit temporaire au logement
- D’autre part, un droit à pension alimentaire
A) Le droit temporaire au logement
La situation de vulnérabilité dans laquelle est susceptible de se trouver le conjoint survivant confronté à la faiblesse de ses droits successoraux en l’absence de libéralités stipulées à son profit peut précipiter son départ du foyer conjugal. Cette situation ajoute une souffrance matérielle à la douleur émotionnelle déjà intense, forçant le conjoint survivant à abandonner un environnement familial ancré dans ses habitudes de vie.
Pour pallier cette rupture abrupte et adoucir les conditions de cette transition douloureuse, il est apparu nécessaire pour le législateur, à l’occasion de la réforme du droit des successions intervenue en 2001, de lui fournir une protection.
À cette fin, a été introduite dans le Code civil une disposition – l’article 763 du Code civil – conférant au conjoint survivant, de plein droit et pendant une année, la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale.
Ce droit au logement, qui s’étend également aux meubles meublants, présente la particularité d’être temporaire, de sorte qu’il se distingue du droit d’usage et d’habitation de l’article 764 qui lui est viager.
Bien que ces deux droits ne se confondent pas, ils n’en ont pas moins été pensés pour être exercés de façon successive :
- Premier temps
- Le droit temporaire au logement garantit au conjoint survivant la jouissance de la résidence qu’il occupait au décès du défunt pendant une période d’un an à compter du décès
- Second temps
- Le droit viager d’usage et d’habitation prend le relais du droit temporaire au logement dans l’hypothèse où le conjoint survivant manifeste, dans le délai d’un an, sa volonté d’en bénéficier
Parce le droit temporaire au logement s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance, son régime juridique est très différent de celui auquel est soumis le droit viager de l’article 764.
1. Conditions
Il ressort de l’article 763 du Code civil que l’ouverture du droit temporaire au logement est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions qui tiennent :
- D’une part, à la personne du conjoint survivant
- D’autre part, au logement
==>Les conditions tenant à la personne du conjoint survivant
L’article 763 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit temporaire au logement est le « conjoint successible ».
Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès.
À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés.
Par ailleurs, parce que le droit temporaire constitue un effet direct du mariage (art. 763, al. 3 C. civ.), il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité.
Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité.
==>Les conditions tenant au logement
Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :
- Première condition
- L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit temporaire au logement, que du seul bien qu’il occupât, à l’époque du décès, « effectivement, à titre d’habitation principale »
- Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
- D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement
- D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui était occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569).
- S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. »
- Seconde condition
- L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
- En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
- Soit appartenir au seul défunt
- Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
- Est-ce à dire que lorsque l’une ou l’autre condition n’est pas remplie le conjoint survivant ne peut pas se prévaloir du droit temporaire au logement ?
- À cette question il y a lieu de répondre par la négative.
- Il est, en effet, indifférent que l’habitation du conjoint survivant soit assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt.
- L’alinéa 2 de l’article 763 du Code civil précise que dans l’une ou l’autre situation, « les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. »
- Que faut-il comprendre de cette disposition ?
- Il y a lieu de retenir que lorsque le conjoint survivant réside, soit dans une habitation louée à un tiers, soit dans un immeuble appartenant au de cujus en indivision avec un tiers, cela ne fait nullement obstacle à l’ouverture du droit temporaire au logement.
- La seule conséquence réside dans les modalités de réalisation de ce droit.
2. Modalités de réalisation
Les modalités de réalisation du droit temporaire au logement diffèrent selon que le conjoint survivant occupe un logement :
- Soit dépendant totalement de la succession
- Soit qui appartenait aux deux époux
- Soit qui appartenait au défunt en indivision avec un tiers
- Soit qui est loué à un tiers
==>Le logement occupé par le conjoint survivant dépend totalement de la succession
Cette hypothèse correspond à la situation où le logement était la propriété exclusive du défunt, raison pour laquelle il dépend totalement de la succession.
Ici, la réalisation du droit temporaire se traduira par l’occupation par le conjoint survivant, du logement pendant une période d’une année, sans que les héritiers ne puissent rien lui réclamer en contrepartie.
==>Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait aux deux époux
Cette hypothèse, correspond à l’hypothèse où le logement appartenait aux deux époux, soit dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre d’une indivision.
Ici, la réalisation du droit temporaire prend la forme d’un droit de créance qui correspond au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par le conjoint survivant au titre de la jouissance du bien indivis pendant un an.
==>Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait au défunt en indivision avec un tiers
Dans cette hypothèse, l’occupation par le conjoint survivant du bien indivis postérieurement au décès du défunt justifie qu’une indemnité d’occupation soit versée au tiers à proportion de sa quote-part indivise.
Parce que cette occupation intervient au titre du droit temporaire au logement, l’indemnité due au tiers devra être supportée par la succession.
==>Le logement occupé par le conjoint survivant est loué à un tiers
Dans cette hypothèse, la réalisation du droit temporaire au logement prend la forme d’un droit de créance qui donne lieu à la prise en charge, par la succession, de l’intégralité des loyers à verser par le conjoint survivant pendant une durée d’une année.
Pratiquement, cela implique que le conjoint survivant réclame le remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement.
3. Caractères
- Un droit constitutif d’un effet direct du mariage
- Le droit temporaire au logement reconnu au conjoint survivant est présenté par l’article 763, al. 3e du Code civil comme constituant un effet direct du mariage
- Il en résulte deux conséquences :
- Première conséquence
- Le droit temporaire au logement échoit, de plein droit, au conjoint survivant sans qu’il lui soit besoin d’en faire la demande comme c’est le cas pour le droit viager de l’article 764.
- Seconde conséquence
- Le droit temporaire au logement ne s’analyse pas en une libéralité, de sorte qu’il n’a pas vocation à être imputé sur la quote-part de la succession qui revient au conjoint survivant.
- Première conséquence
- Un droit personnel
- Le législateur a conçu le droit temporaire au logement comme un droit personnel et non comme un droit réel.
- Cela signifie que le conjoint survivant est dépourvu de tout pouvoir direct sur le logement qu’il occupe.
- Plus précisément, il est insusceptible de se prévaloir des prérogatives attachées aux droits d’usage et d’habitation visés aux articles 625 et suivants du Code civil.
- Le conjoint survivant est seulement titulaire d’un droit de créance qu’il peut exercer contre la succession.
- Pour cette dernière, il s’agit donc d’une dette, à inscrire au passif successoral, dont le règlement s’opère par la concession d’un droit de jouissance du logement au profit du conjoint survivant pendant la durée d’un an.
- Un droit d’ordre public
- En application de l’article 763, al. 4e du Code civil, le droit temporaire au logement présente un caractère d’ordre public.
- Il en résulte que le conjoint survivant ne saurait en être privé par voie de libéralité, ni même y renoncer par anticipation.
4. Extinction
Le droit au logement reconnu au conjoint survivant par l’article 763 du Code civil est un droit temporaire.
Comme précisé par cette disposition, il s’éteint à l’expiration d’un délai d’un un à compter du décès du défunt.
À cet égard, il s’agit d’un délai préfix de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption.
B) Le droit à pension alimentaire
==>Évolution
Dans le Code civil de 1804, le conjoint survivant n’était appelé à hériter qu’en absence d’héritiers jusqu’au douzième degré, sans qu’aucun autre droit ne soit institué à son profit.
Cette omission ne fut corrigée que par la loi du 9 mars 1891, qui instaura une créance alimentaire pour le conjoint survivant nécessiteux, intégrée à l’article 205 (ancien) du Code civil.
Cette disposition prévoyait que « la succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. ».
Le texte resta inchangé jusqu’à la loi du 3 janvier 1972, qui ne modifia que sa numérotation, devenant l’article 207-1 du Code civil.
La loi du 3 décembre 2001, qui a considérablement renforcé les droits du conjoint survivant, déplaça les règles régissant la pension alimentaire à l’article 767 du Code civil, lequel relève d’un titre consacré aux Successions.
Bien que l’essentiel du contenu de l’ancien article 207-1 ait été repris par le législateur en 2001, des modifications ont été apportées aux fins de renforcer le caractère successoral de cette créance alimentaire.
Dans le droit fil de cette évolution, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modernisé le vocabulaire de l’article 767, en remplaçant le terme « hérédité » par le mot « succession ».
Malgré ce changement de vocable, la nature de la pension comme créance alimentaire a été maintenue.
==>Nature
Le droit à pension alimentaire est d’abord et avant tout un droit de nature alimentaire.
Ce caractère est ancré dans le principe de solidarité familiale, visant à assurer la subsistance du conjoint survivant qui se trouve dans le besoin après le décès de son partenaire.
La pension alimentaire susceptible d’être octroyée au conjoint survivant est destinée à couvrir ses besoins essentiels de la vie quotidienne, comme l’alimentation, le logement, et les soins médicaux.
À cet égard, ce droit découle directement du devoir de secours qui existe entre les époux pendant la vie conjugale et se prolonge après le décès au travers de cette créance alimentaire contre la succession.
==>Caractères
Outre sa nature alimentaire, la créance instituée à l’article 767 du Code civil présente un caractère successoral marqué.
Ce caractère successoral se manifeste par le fait que la créance alimentaire est inscrite au passif de la succession, de sorte qu’elle doit être supportée par l’ensemble des héritiers à proportion de la quote-part qui leur revient.
Concrètement, cela signifie que la pension alimentaire doit être prélevée sur l’actif successoral, avant la répartition des biens du défunt entre les héritiers. La créance alimentaire prend alors une dimension patrimoniale, influençant la composition de la masse successorale à partager.
1. Les conditions d’ouverture du droit à pension alimentaire
a. Les conditions tenant au créancier
Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que pour se prévaloir du droit à pension alimentaire il faut justifier :
- D’une part, de la qualité de conjoint successible
- D’autre part, d’un état de besoin
==>La qualité de conjoint successible
L’article 767 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit à pension alimentaire est le « conjoint successible ».
Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès.
À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés.
Par ailleurs, parce que le droit à pension alimentaire consiste, non pas en un droit successoral, mais en un droit de créance, il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité.
Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité.
==>L’état de besoin
Pour être fondé à se prévaloir du droit à pension alimentaire, le conjoint survivant doit justifier être « dans le besoin » dit l’article 767, al. 1er du Code civil.
Autrement dit, il ne doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir seul à sa subsistance.
Cette impossibilité devra résulter de l’insuffisance des ressources personnelles du conjoint survivant (revenus du travail ou revenus du capital) quant à couvrir tout ou partie de ses besoins.
À cet égard, les besoins ne se limitent pas à l’alimentation ; ils s’étendent au logement, à l’habillement ou encore aux soins médicaux.
S’agissant du moment de l’appréciation du besoin, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 mars 1994 qu’il y a lieu de se situer au jour de l’ouverture de la succession, soit à la date du décès du défunt (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
==>L’indifférence de l’existence de manquements graves
La question s’est posée de savoir si en cas de manquement grave par le conjoint survivant à ses obligations envers le de cujus, il pouvait être déchu de son droit à pension alimentaire.
On pourrait le penser si l’on se reporte à l’article 207, al. 2e du Code civil qui prévoit que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »
Reste que cette disposition ne s’applique pas au devoir de secours entre époux. Or la créance alimentaire instituée à l’article 767 du Code civil n’en est que le prolongement.
Il en résulte que quand bien même le conjoint survivant aurait manqué gravement à ses obligations envers le défunt, il ne saurait être privé de son droit à pension.
La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 17 janvier 1995 aux termes duquel elle a jugé que « lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; que, cependant, cette faculté ne s’étend pas, sauf l’exception prévue par l’article 303, alinéa 2, du Code civil, au devoir de secours entre époux, dont l’obligation alimentaire pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation » (Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995, n°92-21.599).
Quid alors en cas de manquement grave aux obligations auxquelles est tenu le conjoint survivant envers les héritiers ?
Un tel manquement ne saurait là encore conduire à le déchoir de son droit à pension dans la mesure où ce ne sont pas les héritiers qui sont personnellement débiteurs de ce droit, mais la succession.
b. Les conditions tenant au débiteur
Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que le débiteur du droit à pension alimentaire n’est autre que la succession.
Pour rappel, ce texte prévoit que « la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin ».
La conséquence en est que les héritiers ne peuvent être obligés à régler une pension alimentaire au conjoint survivant que dans la limite de l’actif successoral ; ils ne sauraient répondre de cette dette sur leur patrimoine personnel.
Aussi, l’ouverture du droit à pension alimentaire dépend directement de la consistance de l’actif successoral net, soit déduction faite du passif successoral.
En cas d’absence de biens au décès du défunt, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’octroi d’aucune pension alimentaire.
À l’inverse, en présence d’éléments d’actifs, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 janvier 2019 que leur nature importait peu. Il est notamment indifférence que cet actif soit essentiellement constitué de droits indivis non mobilisables immédiatement (Cass. 1ère civ. 30 janv. 2019, n°18-13.526).
2. Le régime du droit à pension alimentaire
==>Délai pour exercer le droit à pension
- Fixation d’un délai
- L’article 767, al. 1er du Code civil prévoit que le délai imparti au conjoint survivant pour faire valoir son droit à pension alimentaire est d’un an.
- Ce délai commence à courir :
- Soit à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint.
- Soit, pour le cas où les héritiers auraient déjà versé des subsides au conjoint survivant à partir « du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint ».
- Prolongation du délai
- L’article 767, al. 1er prévoit que le délai pour exercer le droit à pension alimentaire se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
- Autrement dit, tant que le partage de la succession n’est pas réalisé, le conjoint survivant est autorisé à se prévaloir de son droit à pension.
- Le délai d’un an est donc prolongé autant que dure la situation d’indivision, sauf à ce que le conjoint survivant ne soit pas partie à cette indivision.
- Si l’indivision successorale ne concerne que les autres héritiers, alors la prolongation du délai d’un an n’a pas lieu de jouer.
- Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les dispositions de l’article 767 du Code civil selon lesquelles, en cas d’indivision, le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-71.840).
==>Modalités du droit à pension
- Absence d’imputation
- Parce que le droit à pension alimentaire institué au profit du conjoint survivant constitue une créance contre la succession, il ne vient pas en déduction de ses droits successoraux, il s’ajoute à eux.
- Autrement dit, le droit à pension s’additionne à la quote-part revenant à ce dernier.
- Il en résulte que le conjoint survivant est fondé à faire valoir sa créance d’aliments peu importe sa vocation légale, sauf à ce qu’il soit attributaire de la totalité de la succession en pleine propriété.
- La raison en est que le droit à pension ne peut être prélevé que sur la succession.
- Or lorsque celle-ci est recueillie dans son intégralité par le conjoint survivant, il n’y a plus rien à prélever, sinon sur sa propre part.
- Forme de la pension
- La pension alimentaire octroyée au conjoint survivant ne peut prendre qu’une seule forme : celle d’une rente versée périodiquement.
- Si le législateur avait, dans un premier temps, envisagé qu’elle puisse prendre la forme d’un capital, il a finalement abandonné cette idée.
- Montant de la pension
- Le montant de la pension est déterminé en fonction :
- D’une part, des besoins du conjoint survivant
- D’autre part, de ses ressources personnelles
- Le montant de la pension est déterminé en fonction :
==>La réalisation du droit à pension
L’article 767, al. 2e du Code civil prévoit expressément que la pension alimentaire est prélevée sur la succession.
Il en résulte deux principales conséquences :
- Première conséquence
- Le montant du droit à pension ne saurait excéder le montant de l’actif successoral net, lequel constitue l’assiette de ce droit.
- Cela signifie que :
- D’une part, les créanciers successoraux seront payés avant le conjoint survivant
- D’autre part, en cas d’absence d’actif successoral après désintéressement des créanciers, le conjoint survivant ne pourra faire valoir aucun droit à pension.
- Deuxième conséquence
- Le conjoint survivant n’est autorisé à poursuivre son droit à pension que sur les seuls biens composant la succession.
- La dette de pension n’est donc pas exécutoire sur le patrimoine personnel des héritiers.
- Troisième conséquence
- Parce que la pension alimentaire est prélevée sur la succession, elle est supportée, dit l’article 767, al. 2e du Code civil, par tous les héritiers à due proportion de la quote-part qui leur revient.
- Le texte précise que, dans l’hypothèse où la part revenant aux héritiers ab intestat serait insuffisante quant à couvrir le droit à pension, celui-ci doit alors être supporté par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
- Il est toutefois admis que le prémourant puisse décider que tel ou tel legs serait acquitté de préférence aux autres.
==>La révision du droit à pension
La question s’est posée de savoir si la pension alimentaire pouvait faire l’objet d’une révision, à la baisse ou à la hausse, en cas de modification de la situation du conjoint survivant.
Faute de réponse apportée par les textes, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 mars 1994 que la « pension est seulement susceptible d’être diminuée ou supprimée, dans le cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).
Il se déduit de cette décision que, en cas de diminution des ressources du conjoint survivant ou d’augmentation de ses besoins, la pension ne peut faire l’objet d’aucune augmentation.
- M. Grimaldi, Droit des successions, Lexisnexis, éd. 2017, p.166. ?
- F. Terré, Y. Lequette et S. Gaudemet, Droit civil – Les successions – Les libéralités, éd. Dalloz, 2014, n°158, p. 169. ?
- M. Grimaldi, Droit des successions, Lexisnexis, éd. 2017, n°189, p.147. ?
- M. Grimaldi, Droit des successions, Lexisnexis, éd. 2017, n°198, p.158. ?
- F. Zénati et Th. Revet, Les biens, éd. PUF, 2008, n°244 ?